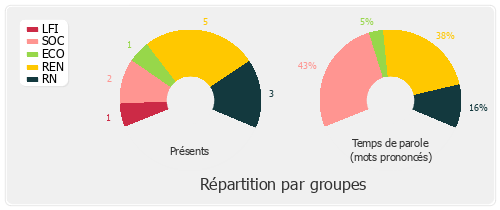Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire
Réunion du jeudi 13 juillet 2023 à 9h05
La réunion
Jeudi 13 juillet 2023
La séance est ouverte à neuf heures cinq.
(Présidence de M. Frédéric Descrozaille, président de la commission)
La commission entend lors de sa table ronde sur l'histoire des politiques publiques en matière de pesticides en France et en Europe :
– M. Jean-Noël Jouzel, sociologue (en visioconférence) ;
– M. Hervé Durand, délégué ministériel pour les alternatives aux produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales, Conseil Général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

Mes chers collègues, nous poursuivons les auditions de cette commission d'enquête. Nous sommes actuellement dans la phase d'acculturation, qui consiste à bâtir un cadre commun. Avant de prétendre dresser un bilan et d'émettre un jugement, nous souhaitons construire le cadre de connaissance et le langage communs sur un sujet particulièrement complexe. Nous vous demanderons donc de faire preuve de pédagogie dans vos interventions.
Nous recevons aujourd'hui Hervé Durand. Monsieur, votre expérience et votre parcours sont les bienvenus pour nous aider dans cette démarche. Au cours de votre carrière, vous avez exercé à plusieurs reprises des responsabilités relatives à la protection des cultures et aux produits phytosanitaires. Celles-ci vous ont également conduit à vous occuper du glyphosate et vous êtes aujourd'hui délégué ministériel pour les alternatives aux produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales. Vous êtes ingénieur des Ponts, des eaux et des forêts, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Vous avez également eu une expérience internationale, au moment de l'élargissement de l'Union aux pays de l'Europe centrale et orientale. Nous allons vous demander de porter un regard rétrospectif sur les différentes politiques publiques conduites en la matière, sans hésiter à nous faire faire part d'éléments comparatifs avec d'autres pays.
Nous auditionnons par ailleurs par visioconférence M. Jean-Noël Jouzel. Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur l'acceptation par la société des enjeux liés aux pesticides. Vous pourrez sans aucun doute nous éclairer sur ces questions, en abordant peut-être la distinction entre danger et risque et la question de l'acceptabilité du danger, qui est essentielle sur le sujet qui nous occupe.
Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure », après avoir activé votre micro.
(MM. Jean-Noël Jouzel et Hervé Durand prêtent serment).
Le sujet dont vous vous êtes saisis est d'une extrême complexité, comme vous l'avez souligné. Il faut d'abord avoir conscience que le secteur agricole est engagé depuis longtemps dans de profondes transformations, qui vont devoir encore plus s'accélérer. Ce secteur n'a pas cessé d'évoluer. On ne peut pas comprendre le sujet des produits phytosanitaires si l'on ne mesure pas à quel point ils ont contribué à l'essor et au développement de notre agriculture.
Ces produits sont apparus il y a longtemps : on en parlait déjà en 1800. Mais leur utilisation a connu une formidable accélération après la Deuxième Guerre mondiale. Les résultats enregistrés ont été notables pour la protection des cultures. Il faut avoir à l'esprit qu'un agriculteur est confronté à de multiples aléas, de toutes natures. Il y a évidemment l'aléa climatique, comme on le constate encore en ce moment. Par ailleurs, à partir des semis et tout au long de leur développement, les productions végétales sont soumises à de multiples bioagresseurs. Les produits phytosanitaires ont ainsi apporté une sécurité incroyable dans la régularité des rendements, en permettant aux agriculteurs de s'exonérer d'un grand nombre d'aléas. Si l'on veut bien mesurer ce changement, il suffit de s'intéresser à ce qu'étaient les famines au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ces aléas sont encore très présents à l'échelle de la planète : il suffit de voir les ravages des criquets en Afrique. On ne peut donc pas parler des produits phytosanitaires sans concevoir la nécessité de la protection des cultures.
Aujourd'hui, les produits phytosanitaires sont devenus une question sociétale : ils ne concernent plus que les agriculteurs., En effet, on a observé au fur et à mesure de la montée en puissance de leur utilisation, des impacts négatifs de ces produits sur l'environnement et la santé, conduisant certains acteurs à s'interroger et à demander un certain nombre de changements.
Dans ce contexte, nous avons beaucoup mis l'accent sur des mesures incitatives, visant à faire en sorte que les agriculteurs utilisent moins ces produits. Il faut bien reconnaître qu'elles n'ont pas toujours conduit aux résultats espérés. On a quand même obtenu des résultats très positifs, comme le développement de l'agriculture biologique, qui a montré que l'on pouvait se passer des produits phytosanitaires. Les politiques publiques menées ces dernières années ont essentiellement reposé sur l'encadrement réglementaire de l'utilisation de ces produits, qui a fortement fait évoluer les pratiques. Le nombre de substances actives autorisées au niveau communautaire n'a fait que diminuer. Aujourd'hui, un peu moins de 500 substances actives sont autorisées, dont 250 sont en cours de réévaluation. On a ainsi un rétrécissement considérable de l'éventail des possibilités.
Il faut avoir conscience que les produits phytosanitaires ont permis de développer des pratiques agricoles extrêmement simples à mettre en œuvre, à un moment où le secteur a connu une forte diminution du nombre d'actifs. Ces pratiques ont eu pour conséquence inattendue d'éloigner les producteurs de l'agronomie et de la réflexion sur les systèmes de production.
Aujourd'hui, en raison du changement climatique et d'interrogations quant à la durabilité de notre secteur, nous devons reprendre le travail sur notre manière de concevoir les systèmes de production. Il y a maintenant un lien entre la protection de cultures et la manière de penser nos systèmes de production. Cela doit nous conduit à développer une approche positive : en dépit des difficultés, il est possible de réussir. Il faut allonger la rotation des cultures, favoriser leur diversité, mais aussi réfléchir à des environnements différents. Nous avons passé beaucoup de temps à lutter contre le vivant, il faut apprendre à se servir du vivant, de manière positive. Je pense par exemple aux haies, aux auxiliaires.
À titre d'exemple, le colza est une culture importante dans notre pays. L'insecticide phosmet, qui permettait de lutter contre les altises du colza, a été interdit. Ces altises viennent piquer les premiers pédoncules du colza et font mourir le plan. Nous avons travaillé avec les instituts techniques et les producteurs pour trouver une parade, que nous avons trouvée : nous semons le colza plus tôt, pour qu'il soit plus développé et plus résistant lorsque les altises arrivent, en septembre.
Autre exemple dans le secteur de la betterave, où sévit un virus transmis par les pucerons. Le retrait des néonicotinoïdes a entraîné des conséquences massives sur la baisse de la production de sucre, du fait de ce virus. Les sélectionneurs travaillent aujourd'hui pour identifier des lignées de betteraves qui ont une odeur qui ne plaît pas aux pucerons. L'idée consisterait donc à sélectionner des variétés de betterave qui « embarquent » ce gène d'odeur qui sert de répulsif.
Je vous invite à regarder un indicateur assez simple dans un premier temps : celui des quantités de substances actives utilisées dans notre pays. Au passage, je souligne que nous sommes le seul pays de l'Europe à publier des données aussi détaillées sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Elles sont disponibles à la fois aux niveaux national, régional et départemental.
Nous avons enregistré des avancées incontestables : les données pour 2020, 2021 et 2022 témoignent de la plus faible utilisation de produits phytosanitaires à ce jour. Ce n'est sans doute pas suffisant mais, de fait, la consommation de produits phytosanitaires n'augmente pas. En 2022, nous avons même enregistré une réduction de 30 % de l'utilisation du glyphosate. Surtout, nous assistons à une réduction très importante de l'utilisation des produits et des substances les plus préoccupantes. Ces données sont utiles car elles donnent une idée de ce qui a pu être fait, de ce qui reste à faire mais aussi du fait que nous ne sommes pas restés inactifs.
La pression réglementaire ne fléchit pas. Le problème auquel nous sommes confrontés est le suivant : la stratégie de réduction de l'emploi des produits phytosanitaires est plus subie que partagée par les acteurs. Il s'agit là d'une difficulté majeure : dans un domaine particulièrement sensible, les politiques publiques n'ont pas réussi à totalement convaincre les acteurs. Cela incite à réfléchir pour la suite.
Par ailleurs, vous le verrez sans doute lors de vos prochaines auditions, en matière de publication des données, de stratégies développées, nous nous singularisons en Europe. En tant que fonctionnaire d'État, je l'affirme : nous n'avons à pas à rougir du travail collectif que nous produisons en France, nous sommes plutôt en avance en Europe. Il importe aujourd'hui de partager ce travail avec nos partenaires européens et de renforcer l'harmonisation des actions menées au niveau communautaire. À défaut, nous créons des distorsions de concurrence préjudiciables pour les producteurs. Nous devons aussi répondre à la question posée par la concurrence des pays tiers. Nous pouvons certes multiplier les exigences applicables aux producteurs nationaux mais nous devons veiller à ne pas induire des importations supplémentaires de produits qui ne répondent pas à nos normes. Dans cet esprit, nous avons ainsi déclenché une nouvelle fois la clause de sauvegarde sur les cerises cette année.
En conclusion, les travaux que vous menez sont importants car ils donnent du sens au domaine assez large de la protection des cultures. Aujourd'hui, nous cherchons clairement à réduire notre dépendance à l'utilisation des produits phytosanitaires : nous essayons de construire des alternatives. Vous devez prendre conscience du fait que nous ne sommes plus dans une situation de type « un problème, une solution phytosanitaire ». Cette vision sera de moins en moins vraie à l'avenir. Il nous faut aujourd'hui élargir la palette des solutions offertes aux producteurs, ce qui passe par des investissements significatifs, pour développer l'ensemble des leviers que sont mula génétique, le biocontrôle, les solutions mécaniques, la reconception de système.
Nos objectifs consistent donc bien à réduire notre dépendance et diminuer les quantités de produits phytosanitaires, à réduire les impacts négatifs sur la santé et l'environnement et à ouvrir des voies d'avenir intelligentes, en mobilisant des leviers qui avaient été un peu été sous-estimés jusqu'à présent. Ce chemin n'est pas complètement utopique : certains de ces leviers sont déjà à l'œuvre sur le terrain. Désormais, la massification des bonnes idées et des bonnes pratiques est l'un des enjeux principaux.

Je vous remercie pour la clarté et la lisibilité de votre intervention. Je cède à présent la parole à M. Jouzel.
Mon exposé portera sur l'historique les politiques de contrôle des pesticides, qui recoupera, avec un point de vue différent, un certain nombre d'éléments évoqués par M. Durand. Les pesticides sont devenus un indispensable vecteur de réassurance des rendements agricoles en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même s'ils étaient très utilisés depuis la fin du XIXème siècle. À l'époque, les substances employées étaient naturelles. Après 1945, les progrès de la chimie de synthèse ont permis de démultiplier le nombre de produits pour protéger les cultures contre les ravageurs. Chaque décennie a amené sa nouvelle famille de produits : les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, les nicotinoïdes, les néonicotinoïdes, etc.
Dès les années 1980, la France est de facto très dépendante des pesticides : à cette époque, plus de 500 substances actives sont autorisées et contenues dans plus de 3 000 préparations commerciales. Les pesticides sont devenus un élément central de la « révolution silencieuse » : l'immense mouvement de l'agriculture française vers une agriculture plus productiviste, à partir des décennies qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. Cette évolution est allée de pair avec l'agrandissement des surfaces agricoles, le remembrement, la mécanisation et l'utilisation croissante de matières fertilisantes. Les pesticides constituent donc un ensemble de ce tout.
Cela conduit à une augmentation spectaculaire des rendements dans la deuxième partie du XXème siècle : ils ont été multipliés par quatre pour le blé et par six pour le maïs, par exemple. L'utilisation massive des pesticides a aussi été associée à une transformation des conditions de travail et de vie sur les exploitations agricoles. Les pesticides représentent une assurance mais aussi un confort de travail par rapport au désherbage mécanique, par exemple. Leur utilisation a permis de dégager du temps et des revenus ; elle a permis à une fraction des agriculteurs de bénéficier d'une forme de « moyennisation » de leurs conditions par rapport au reste de la société, avec l'accès aux vacances, à la société de consommation, etc.
Les pesticides font donc partie d'un tout économique, technique et social. Certains collègues l'ont qualifié de « verrouillage sociotechnique » : une fois que les pesticides sont là, ils font partie d'un tout dont il est difficile de sortir. Les politiques publiques ont visé, depuis la massification de l'usage des pesticides au milieu du XXème siècle, à en contrôler les effets. Les pesticides sont en effet des produits dangereux, conçus pour endommager des organismes vivants. On a donc cherché à en maitriser les risques pour permettre leur diffusion massive en agriculture, sans commettre trop de dégâts.
On a d'abord essayé de maîtriser les risques de ces produits dangereux en jouant sur la dernière variable de l'équation : la limitation des expositions aux pesticides. Celle-ci s'est caractérisée par de multiples tentatives de définir leurs conditions d'utilisation par les agriculteurs, afin de protéger des effets indésirables la santé humaine des travailleurs, des riverains et des consommateurs, mais aussi l'environnement.
Cette philosophie « d'usage contrôlé » ou « safe use » est au cœur du principal instrument de politique publique que sont les autorisations de mise sur le marché (AMM). En France, les pesticides y sont soumis depuis 1943. Cette préoccupation est donc très ancienne. Les modalités d'AMM ont largement été revues en 1972 pour donner une place plus importante à l'évaluation des risques des pesticides.
Au cœur de cette évaluation de risque, on trouve la question de la définition de bonnes pratiques agricoles, avec notamment le port de vêtements de protection. Les politiques publiques de contrôle des dangers des pesticides ont en effet surtout visé la protection de la population la plus exposée, c'est-à-dire les agriculteurs.
La mise en œuvre de la politique d'usage contrôlée des pesticides est longtemps passée par des acteurs institutionnels spécifiques au monde agricole. Par exemple, les politiques de protection de la main-d'œuvre agricole contre les risques professionnels ont largement été administrées par des institutions relevant de l'agriculture. Ainsi, le régime de protection sociale agricole est spécifique : il est géré par la mutualité sociale agricole (MSA), qui dispose de sa propre branche « accidents du travail et maladies professionnelles », mais aussi de sa propre médecine du travail et son propre corps d'ingénieurs en prévention. En outre, jusqu'en 2009, il existait une inspection du travail agricole à part, qui était rattachée au ministère de l'agriculture. C'est par ce biais que les politiques d'usage contrôlé des pesticides ont été mises en œuvre des années 1950 jusqu'à une date récente.
Ceci s'est traduit par exemple par l'établissement de tableaux de maladies professionnelles particulières, portant mention des effets indésirables, par la mise en œuvre d'un réseau de toxicovigilance visant à repérer les effets indésirables des pesticides sur la main-d'œuvre agricole.
Ces dispositifs ont eu le mérite de rendre visibles certains effets des pesticides sur la main-d'œuvre agricole, mais ils sont restés centrés sur la prévention, l'identification et la réparation des intoxications aigües produites par des expositions accidentelles. Ils offrent toujours très peu de moyens pour repérer, prévenir et réparer les effets chroniques d'exposition de long terme aux pesticides.
Au cours des vingt ou trente dernières années, des préoccupations portées notamment par des mouvements sociaux assez hétérogènes – associations de victimes, associations environnementalistes, collectifs de riverains, syndicats d'apiculteurs – ont mis en lumière les préoccupations relatives aux effets indésirables de ces pesticides, lesquels semblent être insuffisamment contrôlés par les politiques en vigueur.
Parmi ces effets qui ont échappé à la politique d'usage contrôlé, on peut citer les effets des pesticides néonicotinoïdes sur la santé des abeilles, qui font l'objet d'affaires importantes dès la fin des années 1990, mais aussi la pollution des eaux et de l'air. On peut évidemment penser aussi à la question du coût sanitaire des expositions professionnelles aux pesticides, avec notamment le développement de diverses maladies chroniques. Depuis les années 1990, des études épidémiologiques multiples indiquent qu'il s'agit là d'un facteur de risque pour des pathologies comme les cancers du sang, le cancer de la prostate, les maladies neurovégétatives, les troubles respiratoires et les troubles de la reproduction. On peut enfin citer les effets des pesticides sur les riverains des parcelles agricoles, même si l'on a moins de données en épidémiologie sur ce sujet.
Ces nouvelles données scientifiques et ces mouvements sociaux ont mis l'accent sur des défaillances notables dans la politique d'usage contrôlé des pesticides. Manifestement, des produits ont atteint le marché, qui avaient des effets indésirables sur la santé humaine et sur l'environnement.
Au cours du dernier quart de siècle, depuis que les indésirables de l'usage massif de ces produits en agriculture ont été rendus plus visibles, deux évolutions ont contribué à l'évolution des politiques publiques de contrôle des pesticides. Ces politiques ont d'abord été européanisées. L'un des effets de la construction du marché commun a ainsi été l'harmonisation des pratiques d'évaluation des risques, s'agissant notamment des pesticides. La directive 91/414/CEE a ainsi harmonisé l'évaluation des risques des substances actives des pesticides et le règlement 1107/2009, qui s'y est substitué, a renforcé l'harmonisation des pratiques d'évaluation des risques des préparations commerciales. Les États conservent la main sur les autorisations de mise sur le marché mais selon des modalités d'évaluation des risques très encadrées par l'Europe, notamment à partir des lignes directrices édictées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa).
Cette européanisation de l'évaluation des risques n'a pas modifié la philosophie de l'usage contrôlé qui, selon les termes du règlement 1107/2009, vise à « fixer des niveaux de sécurité en matière d'exposition et à définir des modalités d'un emploi inoffensif ». L'idée demeure la même : on peut définir les bonnes règles par le biais des étiquettes qui vont permettre aux agriculteurs d'utiliser les produits dangereux avec un niveau de risque contrôlé pour eux-mêmes, leurs salariés, les riverains et les consommateurs de produits agricoles, ainsi que pour la faune et la flore adjacentes.
Deuxième dynamique à l'œuvre, l'espace politique évolue fortement, en France notamment. Cela s'explique en partie par la montée de contestations sociales portées par une grande variété d'acteurs très mobilisés. Mais au-delà, on assiste à une « tectonique des plaques institutionnelles », qui procède d'une forme d'érosion des prérogatives du ministère de l'agriculture en matière de contrôle des pesticides. En 2006, l'évaluation des risques des préparations commerciales a ainsi été transférée à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation (Afssa). En 2009, l'inspection du travail agricole a été fusionnée avec l'inspection générale du régime général, au sein ministère du travail.
À partir de la fin de la première décennie des années 2000, nous avons également vu l'émergence des mouvements sociaux mais aussi d'autres acteurs jusque-là en retrait, qui sont venus s'intéresser à la question des pesticides, comme le ministère de la santé, le ministère de l'environnement et le ministère du travail. Ces institutions ont été la cheville ouvrière de demandes d'expertises scientifiques sur ce sujet, qui ont entrainé la multiplication de rapports d'experts depuis une quinzaine d'années. Ces rapports mettent tous en avant, d'une manière ou d'une autre, le danger des pesticides pour la santé et l'environnement. En 2016, le transfert des autorisations de mise sur le marché à l'Anses a parachevé cette évolution. En résumé, il existe des concurrences institutionnelles de plus en plus marquées quant à la mesure des risques des pesticides et la manière de les contrôler.
Je souhaite conclure mon propos en évoquant l'évolution des politiques de contrôle des pesticides. Incontestablement, ces produits sont plus strictement contrôlés qu'il y a trente ou quarante ans, notamment sous l'effet de l'harmonisation européenne. Cela a conduit à durcir les conditions d'accès au marché des pesticides et notamment à réduire le nombre de substances actives sur le marché européen.
De nouvelles mesures de gestion du risque ont été introduites en France, comme les bandes enherbées pour protéger les cours d'eau, les délais de réentrée pour protéger les travailleurs agricoles qui retournent travailler dans des parcelles traitées, ainsi que, plus récemment, les zones de non-traitement. La succession des plans Écophyto témoigne également du souci institutionnel pour favoriser une déprise et une sortie de la dépendance de l'agriculture française aux produits phytosanitaires.
Néanmoins, en dépit de ces changements importants, les politiques publiques de contrôle des pesticides sont toujours marquées par la prééminence d'une philosophie d'usage contrôlé, qui repose sur l'idée qu'un agriculteur correctement formé et informé des dangers des pesticides doit avoir les moyens de les utiliser de telle manière que les effets dangereux ne l'atteindront pas.
En matière de santé au travail, cela se manifeste notamment par le poids substantiel du vêtement de protection dans l'évaluation des risques, à travers l'attribution de très forts coefficients de protection, alors même que de nombreuses questions se posent sur l'efficacité de la protection permise par les combinaisons et les gants lors de l'exposition aux pesticides. Il en va de même des mesures de gestion des risques pour la protection des riverains et des cours d'eau. C'est toujours sur les épaules des exploitants utilisateurs de produits que repose l'essentiel des mesures de prévention des risques liés aux pesticides.
Cela pose de nombreuses questions qu'il est souvent difficile d'aborder car les données, notamment académiques, manquent en matière de mesure de l'exposition aux pesticides. Cependant, celles dont nous disposons nous enjoignent à réfléchir sur l'effectivité des mesures de prévention en place.
Dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres, il ne faut pas tout attendre de la science, qui n'aura pas réponse à tout. Il convient donc de procéder à des choix politiques et je me félicite que votre commission d'enquête s'en préoccupe.

Je vous remercie pour la clarté et la pédagogie de vos exposés. Je me permettrai deux remarques. M. Durand, vous avez évoqué les phénomènes de concurrence déloyale intra et extracommunautaire. Les intervenants que nous avons reçus hier ont également mis en lumière les phénomènes de changement dans la structure des exploitations agricoles. Leur agrandissement et leur céréalisation ont fortement augmenté la dépendance à la phytopharmacie. Par ailleurs, dans le cadre des politiques publiques, il me semble bon de rappeler l'existence du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, qui matérialise un devoir de réparation des victimes, en impliquant les firmes phytopharmaceutiques.
J'en arrive aux questions. Vous semblez dire qu'aujourd'hui deux facteurs d'évolution majeurs sont à l'œuvre : celui du marché – la demande des consommateurs et de la société – et d'autre part l'évolution des conditions règlementaires, avec les critères de mise sur le marché et le retrait de certaines molécules. Finalement, est-ce cela ne revient pas à admettre que le continuum recherche, conseil et développement n'a sans doute pas produit tout son potentiel lors de la dernière décennie ?
Ensuite, vous avez brièvement évoqué l'historique des liens entre les directives européennes et les politiques publiques conduites en France. À partir de quel moment vous semble-t-il que la France a été en avance ou en retard de phase ? Quel regard portez-vous sur l'articulation entre ces politiques françaises et européennes ?
Enfin, quel ministère a autorité en la matière, quel est le donneur d'ordre principal ? S'agit-il du ministère de la santé, de celui de l'écologie, de l'agriculture ? L'Inrae a lancé un programme zéro pesticide 2050. D'autres think tanks ont travaillé dans le même sens. Mais depuis quelques années, cet horizon d'une moindre dépendance aux produits phytosanitaires semble être remis en cause. Existe-t-il aujourd'hui un horizon politique clair en matière de réduction des pesticides ? À l'inverse, sommes-nous confrontés à une distorsion de ces horizons, un déphasage ?
Le sujet dont on parle mobilise des compétences partagées entre les ministères. Au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, nous travaillons d'arrache-pied sur ces questions. Je pense que la question n'est pas tant qui domine, mais comment être efficace, ce qui nécessite une mobilisation concertée de l'ensemble des acteurs, qui ont tous leur légitimité. Dans le domaine de la santé, les données sur la qualité des eaux témoignent d'un travail considérable réalisé. Ainsi, en 2021, 85 % des eaux distribuées sur le territoire national étaient totalement conformes. Le ministère de la transition écologique œuvre également dans ce dossier. De même, les aspects liés au travail sont essentiels.
Nous sommes plutôt en avance de phase en Europe. La négociation du règlement sur l'usage durable des pesticides (SUR) constitue naturellement un sujet d'importance. Trois États membres se sont détachés dans les discussions : l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Ces trois pays donnent le sentiment de vouloir aller de l'avant. La question est désormais la suivante : allons-nous réussir à nous entendre sur une vision commune, sur un niveau de réduction de l'utilisation de ces produits ? Ceci est fondamental pour harmoniser les politiques et pour nous mobiliser sur la recherche d'alternatives.
Vous avez évoqué en outre le continuum conseil – recherche – développement. Avons-nous failli ? Il est certain que nous n'avons su apporter toutes les réponses attendues. J'espère que vous pourrez auditionner des agriculteurs. En effet, la vie quotidienne sur une exploitation est compliquée aujourd'hui. À qui s'adresser sur ces questions ? Nous devons recréer un continuum. En France, nous sommes allés jusqu'au bout d'une certaine logique et nous avons tranché, en séparant le conseil et la vente des produits phytopharmaceutiques. Le bilan que l'on peut en faire aujourd'hui est plutôt contrasté : nous n'avons pas complètement réglé le problème, dans la mesure où la question de l'accompagnement des exploitants au quotidien demeure patente.
Nous ne devons pas perdre de vue la nécessité d'investir et de consacrer d'importantes sommes d'argent pour mettre au point des alternatives sérieuses et crédibles. Quelle est la vision à terme ? Cherche-t-on à supprimer les produits phytosanitaires ? À l'heure actuelle, la logique consiste à réduire les impacts et les quantités utilisés, mais il n'est pas question de les supprimer totalement. Nous cherchons à mobiliser les leviers disponibles pour crédibiliser des alternatives sérieuses.
L'histoire du glyphosate est à ce titre très instructive. La France est le premier État membre à avoir mobilisé l'évaluation comparative. Celle-ci est particulièrement intéressante : grâce à la mobilisation de l'Inrae et des instituts techniques, nous avons passé en revue les différents usages du glyphosate. En étudiant chacun de ses usages, nous avons cherché à définir des alternatives à la fois crédibles sur le plan économique et efficaces. Certaines ont ainsi pu être trouvées, ce qui nous a permis de réduire les usages du glyphosate. Aujourd'hui, un agriculteur qui laboure ses terres ne peut pas l'utiliser. En revanche, un agriculteur engagé dans des techniques de conservation des sols et de couvert permanent peut les utiliser car il n'existe pas d'alternatives.
L'horizon politique a été rattrapé en quelque sorte. Aujourd'hui, moins de 500 substances actives sont autorisées au niveau communautaire et 250 sont en cours de réévaluation. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour agir, c'est-à-dire pour construire les solutions qui devront être proposées aux agriculteurs demain. Nous ne pourrons y arriver qu'en faisant le lien avec tout le programme d'adaptation au changement climatique. Il s'agit, là aussi, d'un continuum.
Vous avez évoqué le fonds d'indemnisation, qui a été créé pour les victimes des pesticides en 2020. Il ne concerne que les travailleurs ou leur progéniture : c'est un choix politique. Ce fonds est souvent comparé au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mais il est en réalité bien plus modeste dans sa portée. Ainsi, il ne prévoit pas de réparation intégrale du préjudice, mais une réparation forfaitaire, qui est prévue par la législation sur la réparation des maladies professionnelles. En outre, le financement de ce fonds reste en grande partie à la charge des exploitants eux-mêmes.
Le continuum recherche-développement est structurant en agriculture depuis le début du XXème siècle. Mais pendant des décennies, il s'agissait essentiellement de convertir les agriculteurs à une agriculture plus efficace, plus intensive et plus productive. Cette agriculture était particulièrement consommatrice d'intrants chimiques, en particulier de pesticides. Il est difficile d'emmener toute cette machine dans le sens inverse aujourd'hui. Nous ne pouvons que le constater, à la lumière des résultats pour le moins modestes des plans Écophyto. Il faut naturellement convaincre les agriculteurs du bien-fondé des alternatives mais ils doivent aussi se trouver dans un univers de choix réels, ni trop onéreux, ni trop complexes à mettre en œuvre.
S'agissant de notre position par rapport à nos voisins européens, je ne suis pas spécialiste mais il me semble que nous ne sommes pas les plus mauvais. Cependant, nous restons parmi les plus gros utilisateurs de produits phytosanitaires, même s'il est difficile d'établir de comparaisons normées, compte tenu de l'hétérogénéité des surfaces agricoles.
Je connais mieux la situation des États-Unis, en particulier de la Californie. Je ne prétends pas que la situation dans cet État est idéale. Cependant, en matière de contrôle des pesticides, certains choix effectués là-bas font paraître les nôtres plus timides. Par exemple, les zones de protection pour les riverains sont au maximum de 20 mètres en France, mais elles peuvent aller au-delà de 200 mètres en Californie, pour la protection de personnes sensibles. L'univers y est différent, de même que les modalités de traitement et d'épandage. Qui plus est, les délais de réentrée sont au maximum de 48 heures en France entre le moment où l'on épand les produits les plus toxiques et celui où l'on peut revenir sur la parcelle. En Californie, ils peuvent durer jusqu'à quatre semaines. Nous n'avons donc pas à rougir, mais il ne s'agit pas non plus de nous donner un satisfecit en nous comparant à pires que nous.
M. le rapporteur, vous avez ensuite demandé qui dominait. Pour ma part, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un des ministères qui ont été cités. Aujourd'hui, dans le domaine de l'évaluation et de la gestion des pesticides, l'acteur central est l'Anses. Cet état de fait est le fruit d'une tectonique des plaques institutionnelle, qui a vu les administrations centrales se départir d'un certain nombre de prérogatives en matière d'évaluation et de gestion des risques en faveur des agences de sécurité sanitaire apparues lors du dernier quart de siècle.
En l'espèce, l'Anses est chargée de l'évaluation des risques des préparations commerciales, de leur autorisation de mise sur le marché, ainsi que la phytopharmacovigilance. Cet acteur est sans doute le plus en prise sur le sujet et le plus à même de faire évoluer la réglementation européenne, notamment les lignes directrices de l'Efsa, produit des négociations entre les agences européennes.
S'agissant de l'horizon, je partage les propos de M. Durand : nous n'avons plus tellement le choix.

Je vous remercie pour la clarté de vos présentations. M. Durand, puisque nous en sommes au stade de l'acculturation et de la mise au point de la finalité de la commission d'enquête, devons-nous nous partir du prérequis qu'il faut absolument sortir des produits phytopharmaceutiques, ou au moins en réduire l'usage ? Tous les produits le méritent-ils ? L'arsenic de sodium servait à lutter contre les maladies de dépérissement de la vigne, mais il a finalement été interdit au début des années 2000. Cette interdiction n'a pas fait l'objet de débats : mon père l'employait mais il n'était pas très rassuré par les indications présentes sur les bidons. N'existe-t-il pas des produits phytopharmaceutiques qui ne posent pas de problème ?
Pardonnez-moi ce parallèle peut-être un peu naïf, mais certains médicaments à destination des humains sont des produits de synthèse, dont l'utilisation raisonnée ne fait pas débat. Naturellement, il ne s'agit pas de dire que le glyphosate est un produit anodin pour l'environnement. Cependant, il ne semble pas y avoir consensus sur les risques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR) associés. Par conséquent, ne sommes-nous pas en train de forcer la fin du glyphosate sans réelle justification ? Il est question des alternatives, qu'elles soient mécaniques ou chimiques. Pour remplacer le glyphosate, on utilise, pour combattre les mauvaises herbes, un petit germinatif, le Pledge, qui est quant à lui classé CMR. Dans le cas d'espèce, pour diminuer l'utilisation d'un produit qui n'est pas classé CMR, on en vient à utiliser une alternative CMR qui est en outre moins efficace, plus coûteuse et plus compliquée à l'emploi.
Enfin, la question de la mesure de la quantité est effectivement essentielle. Nous ne pouvons pas nous contenter de la notion de tonnage. Cela posera problème quand on voit qu'on abandonne un produit utilisé à raison de 200 grammes à l'hectare pour le souffre, dont il faut 6 kilogrammes à l'hectare.

Je vous remercie pour vos interventions. M. Durand, vous avez évoqué le nombre de substances autorisées en Europe. Pouvez-vous nous fournir des éléments complémentaires sur les différences entre les pays de l'Union, mais également sur ce qui se fait à l'échelle mondiale ?
Je m'interroge également sur les quantités. Pendant longtemps, le diméthoate a été utilisé pour le traitement des cerises avant d'être interdit en 2016. Aujourd'hui, les produits alternatifs utilisés pour les cerises sont plus moins efficaces et il en faut plus. J'émets donc quelques doutes sur l'indicateur relatif à la quantité.
Vous avez parlé de pesticides de synthèse et parfois de pesticides naturels. Pouvez-vous bien préciser ce dont on parle, quand il s'agit de réduire les quantités, quand on évoque les impacts sur la santé et l'environnement ?
Ensuite, je m'interroge sur la pertinence de la Californie comme point de comparaison avec la France. Les territoires sont très différents : en France, les maisons sont au milieu des terres agricoles, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où les organisations géographiques sont totalement différentes.
En tant que sous-directeur de la qualité et de la production des végétaux, j'étais le fonctionnaire d'État qui a proposé l'interdiction de l'arsenic de soude et qui a été chargé de sa mise en œuvre. Il est faux de dire que cet épisode n'a pas engendré de débats : il s'agit d'un des rares exemples où l'on a procédé à l'interdiction des stocks avec un délai réduit à zéro. Nous avons récupéré les produits chez les viticulteurs et les avons stockés dans des mines, dans l'est de la France.
Est-ce la fin des produits phytosanitaires ? Pour l'instant, notre stratégie est de réduire notre dépendance aux produits phytosanitaires et d'élargir la palette des solutions offertes aux producteurs. Cela ne signifie pas à ce stade la fin des produits phytosanitaires. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas continuer comme ça. De nouveaux équilibres doivent être trouvés, pour économiser sur ces produits chimiques de synthèse. Dans le cas de la viticulture, à quoi cela sert-il de désherber intégralement l'inter-rang chaque année ? Pourquoi n'arrivons-nous pas promouvoir l'enherbement systématique des vignobles ? Est-il nécessaire de désherber chimiquement dans un verger de culture pérenne chaque année ?
La consommation de ces produits chimiques doit être plus frugale. Le changement climatique va nous conduire à faire face à de nouveaux bioagresseurs. Et nous aurons certainement besoin d'avoir un certain nombre de produits phytosanitaires pour agir. Il faut donc trouver de nouveaux équilibres, qui passent cependant nécessairement par l'élargissement des alternatives.
S'agissant du glyphosate, nous avons été pragmatiques et le resserrement des utilisations et usages de ce produit a des conséquences pratiques : une diminution de 30 % de son utilisation en 2022. Ce résultat est assez notable. Par ailleurs, il faut savoir utiliser le glyphosate à bon escient. Par exemple, il ne me semble pas opportun de l'utiliser sur un sol nu. À ce titre, quand on discute avec les personnes qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols, l'usage du glyphosate à très faible dose est assez stratégique pour détruire à un certain moment les couverts, avec des impacts assez faibles sur l'environnement.
Il n'existe pas de bons indicateurs. Il est donc nécessaire de s'appuyer sur une panoplie d'indicateurs. De fait, l'indicateur sur les quantités est particulièrement dangereux à manier. En effet, l'industrie s'est adaptée et a proposé des produits moins pondéreux à l'utilisation. Cependant, cet indicateur est le plus simple à recueillir et permet malgré tout d'effectuer des comparaisons.
En matière d'indicateurs, nous disposons également du Nodu (nombre de doses unités), qui permet d'avoir une appréciation sur les surfaces traitées. Malheureusement, cet indicateur n'est pas toujours facilement facile à appréhender quand on a entre 80 et 100 millions d'hectares de surface agricole. Un autre indicateur, plus simple à expliquer, est l'indice de fréquence de traitement (IFT), qui parle aux agriculteurs et montre les efforts fournis. En résumé, il importe surtout de considérer différents indicateurs pour avoir une idée aussi précise que possible.
S'agissant de l'exemple de la cerise, il est effectivement juste de relever que dans certains cas, l'alternative à un produit implique de plus grandes quantités ou une augmentation du nombre des substances actives. Dans ces circonstances, le bénéfice de l'opération est discutable. Cette année, pour la cerise, le début de campagne s'est plutôt bien déroulé, avant un basculement en seconde partie de campagne, avec des montées d'infestation. Désormais, la situation est telle qu'en cas de forte infestation, nous n'arrivons plus à contrôler. Nous travaillons donc pour résoudre ces problèmes. À titre d'exemple, nous cherchons à comprendre pourquoi les filets ne se développent pas plus. Dans nos travaux, nous nous attachons à combiner différents leviers : les parasitoïdes, les insectes stériles, les substances chimiques. Cependant, il faut élargir considérablement le spectre et essayer de réduire la pression des ravageurs.
Lorsque l'on parle de produits phytosanitaires au sens large, on mélange beaucoup de choses : des produits chimiques de synthèse et des produits naturels. Dans les indicateurs, nous nous appliquons à distinguer les produits chimiques de synthèse des autres produits, qui sont utilisables en agriculture biologique. Mais il ne suffit pas pour un produit de ne pas être de synthèse pour ne pas être dangereux. De fait, les produits qui ne sont pas de synthèse peuvent aussi être dangereux. Mais il existe quand même un gradient : les phrases de classement de risque appliquées aux produits dits de synthèse sont différentes de celles des produits dits naturels. En résumé, il faut avoir une vision d'ensemble et ne pas se concentrer uniquement sur les produits de synthèse. On en revient toujours à la même question : comment assurer la production des cultures sans nous embarquer dans de futurs problèmes ? Par exemple, les résidus de cuivre dans le sol, en augmentation, constituent une préoccupation.
Au moment de l'interdiction de l'arsenic de soude, on s'est rendu compte que les étiquettes des bidons comportaient une erreur d'indication sur la cancérogénicité du produit. Cette affaire révèle aussi un certain désordre réglementaire, dont on peut espérer qu'il a été résolu, vingt-deux ans après l'interdiction du produit. Il n'en demeure pas moins que des produits ont pu être utilisés pendant des décennies sans que les moyens d'identifier leurs effets néfastes soient clairement indiqués à leurs utilisateurs. Je parlais un peu plus tôt des vêtements de protection, qui demeurent centraux dans la manière dont on contrôle les risques pour les agriculteurs. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les bidons portaient la mention « Portez des vêtements de protection appropriés », sans autre précision.
Depuis cette période, un important travail réglementaire a été effectué pour fournir lesdites précisions sur les vêtements de protection appropriés. Cependant, la philosophie demeure la même : en portant des combinaisons ou des gants, il est possible de se protéger efficacement. Pourtant, encore une fois, l'efficacité, la portabilité et l'adaptation de ces vêtements de protection demeurent plus que jamais questionnées.
Ensuite, le cas du glyphosate est intéressant, dans la mesure où il illustre les limites de la science. Le glyphosate est la substance active de l'herbicide le plus vendu au monde, le Roundup, que le centre international sur de recherche le cancer a classé comme cancérogène probable en 2015. Il a été ensuite contredit par l'écrasante majorité des agences réglementaires en charge de l'évaluation des pesticides. Dans cette affaire, l'épidémiologie fournit très peu de réponses quant à la question de savoir si le glyphosate est cancérogène pour les travailleurs qui l'emploient. L'épidémiologie donne très peu de réponses, en particulier à l'échelle d'une substance active en particulier, pour déterminer les effets cancérogènes. Quoi qu'il en soit, il ne faut donc pas tout attendre de la science. Nous n'aurons peut-être jamais la réponse à la question du bilan de l'exposition au glyphosate en matière de cancer.
Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il n'est pas dangereux. L'arsenic de soude est un minéral très dangereux. Cependant, il existe effectivement un gradient. Un pesticide a de toute manière pour fonction de faire du mal au vivant.
Enfin, les situations de l'agriculture française et de l'agriculture californienne ne sont évidemment pas identiques. Cependant, l'agriculture californienne est également hétérogène : elle ne se limite pas à sa grande vallée centrale dévolue à l'arboriculture intensive. D'autres espaces agricoles sont plus enchâssés dans des zones de résidence. Malgré tout, je le redis : les délais de réentrée sont beaucoup plus longs en Californie qu'ils ne le sont en France, on ne voit pas très bien comment cela s'explique, et cela devrait donner matière à réflexion à votre commission.

M. Durand, vous avez posé une question centrale : pourquoi les élus de la nation se saisissent-ils de cette question ? Nous nous saisissons de cette question car malgré de nombreuses politiques incitatives, le contexte reste particulièrement sensible. Les multiples blocages actuels, notamment dans certaines filières agricoles, sont prégnants. Nous espérons, avec cette commission, jouer notre rôle d'évaluation des politiques publiques, pour répondre aux enjeux essentiels qui sont devant nous.
Ma première question concerne le contrôle des substances actives. Vous avez rappelé tout à l'heure l'échelon communautaire, dont l'objectif clef consiste à réduire le nombre de substances autorisées. Vous avez indiqué un peu plus tôt que la France est plutôt en avance dans sa volonté de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Mais notre pays est-il visionnaire dans la recherche et le développement d'alternatives à l'échelon communautaire ?
Ensuite, vous nous avez fourni quelques éléments concernant les indicateurs sur les quantités de substances actives, en distinguant les échelons départemental, régional et national. Qui alimente ces données à chacun de ces échelons ? Comment ces chiffres sont-ils collectés ? À côté de la filière agricole, pouvez-vous nous dire quels autres secteurs sont également consommateurs de ces substances actives ? Je pense particulièrement aux collectivités locales.

Je me permets de rappeler que j'ai été corapporteur d'une mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Notre rapport permettait de rappeler quelques fondamentaux, notamment l'usage de ces produits dans les différentes techniques culturales. Nous avons conduit des expériences en comparant un sol travaillé en agriculture de conservation de sols (ACS), c'est-à-dire très peu travaillé mais qui utilise une fois par an du glyphosate, à un sol fréquemment travaillé en agriculture biologique. Les résultats montrent – nous ne pouvons que le reconnaître – qu'il vaut mieux s'engager dans l'ACS. Par conséquent, quand cela est possible, cette agriculture doit être développée. En outre, puisqu'elle utilise un couvert végétal plus important, elle fixe plus le carbone, contribuant ainsi à la neutralité carbone. C'est une des raisons pour lesquelles nous avions proposé d'interdire le glyphosate sur les terrains nus mais aussi dans l'inter-rang des vignes. En effet, laisser un inter-rang enherbé participe à la biodiversité et contribue à fixer le carbone.
Sur la question des cerises, le véritable problème n'est pas l'interdiction du diméthoate mais la suppression du phosmet le 1er novembre 2022, sans solution crédible et malgré les avertissements du monde agricole. Dans ma circonscription, il existe un verger exploratoire, très sophistiqué. Mais le coût d'installation des filets à l'hectare est de 98 000 euros. Par ailleurs, si une partie de la saison a été bonne, cela se passe moins bien depuis dix jours. En deux jours, tout a été infesté.
Je souhaite en outre aborder un autre sujet, en tant que chimiste. On débat beaucoup aujourd'hui de la différence entre produits de synthèse, produits naturels et produits artificiels. En synthèse, nous reproduisons aussi les molécules qui existent dans le principe actif naturel, mais elles sont concentrées. Par conséquent, son utilisation doit être plus contrôlée.
Sur un autre sujet, je vous avoue que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée dans certaines plaines de la Californie ne me fait pas rêver. Avez-vous d'autres exemples intéressants à mentionner ? Je rappelle que le Sri Lanka est à ce jour le seul pays au monde à avoir interdit le glyphosate. De notre côté, nous sommes le seul grand pays d'Europe doté d'une stratégie de diminution de l'usage des glyphosates. Les autres pays, y compris certains donneurs de leçons, n'ont rien mis en place en matière agricole.
M. Durand, vous avez un peu évoqué les politiques de recherche. Pensez-vous que l'on fait suffisamment en matière de recherche ? Je m'interroge également sur la question de l'éducation. Que se passe-t-il actuellement dans les lycées agricoles ? Comment préparons-nous nos futurs agriculteurs ? Comment les accompagnons-nous ? Les lycées agricoles disposent-ils d'une véritable stratégie en matière de produits phytosanitaires ? Ce sujet me semble aussi essentiel à aborder au sein de notre commission.

En tant qu'agricultrice, je souhaite que nos détracteurs entendent les exposés qui ont été tenus ce matin. Je partage vos propos au sujet du continuum et des leviers pour la transition écologique. Mais je m'interroge également. Il y a cinq ans, un essai a été effectué avec des herbineuses, qui permettent d'éliminer les adventices, par exemple entre deux rangs de maïs. Nous avons effectué trois passages, ce qui signifie trois fois le coût humain, trois fois le coût en gazole et trois tassements de terrain. Je m'interroge donc sur les bienfaits de cette technique en matière d'agronomie.
Dernièrement, nous avons fait l'inverse, à l'aide d'un matériel de haute technologie, rempli de capteurs, pour réussir à doser au plus juste l'apport de produits phytosanitaires destinés à lutter contre les adventices. L'idée consiste à repérer en amont ces adventices et à utiliser moins de produits phytosanitaires. Cependant, il faut continuer à proposer une production dont le coût est acceptable et soutenable par la société.
Je reviens de la réunion l'Efsa à Parme et de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. Les informations que j'ai recueillies étaient assez dramatiques quant au possible manque de protéines dont nous pourrions souffrir au cours des prochaines années. Pouvez-vous nous faire part de votre avis à ce sujet ?

Durant cette audition, nous nous sommes surtout consacrés à la question des politiques publiques en matière de réduction de l'utilisation des pesticides en France et en Europe. Je m'interroge sur la politique de production et le commerce de ces mêmes pesticides en Europe, tant il est vrai que cet élément est essentiel pour la compréhension du problème.
Je m'interroge également sur l'accompagnement des agriculteurs lorsqu'ils diminuent leur utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que sur l'information fournie aux consommateurs, avec l'éclosion de nouveaux labels et l'étiquetage des produits.
En quoi la réduction de l'utilisation des pesticides dans les politiques publiques est-elle dépendante des investissements publics ? Quelles sommes ont été dépensées depuis la Deuxième Guerre mondiale pour appuyer l'utilisation de nouveaux produits afin de sécuriser notre production agricole ? Quels sont les coûts estimés pour la réparation et l'accompagnement des agriculteurs ? Je rappelle qu'il faudrait près de 105 milliards d'euros pour dépolluer les eaux souterraines des pesticides.

Messieurs, je me permets de vous poser une dernière question à chacun. M. Durand, vous avez indiqué que la stratégie était plus subie que partagée. Pensez-vous que cela est également le cas de la part des administrations centrales ? M. Jouzel, vivons-nous dans une société qui supporte de plus en plus mal de ne pas savoir ? Quelle est la tolérance à la méconnaissance ? En effet, notre perception du risque est intrinsèquement liée à cette question.
S'agissant des questions financières, je tiens à souligner le très bon rapport produit par les inspections des finances, de la transition écologique et de l'agriculture sur le programme Écophyto. On constate que de grandes sommes d'argent sont consacrées à ces actions.
L'accompagnement est clairement un sujet central. Nous devons retrouver le chemin des fermes, repartir au contact, pour expliciter le sens des transformations sur lesquelles nous voulons nous engager mais aussi pour remettre du liant. C'est la raison pour laquelle il nous faut investir dans la recherche.
Nous sommes encouragés par la révolution du numérique et l'automatisation. Ces progrès sont potentiellement transférables, le problème principal étant le coût. Mais face à ces enjeux, il nous faut identifier ce qu'il est possible de faire, étudier les conditions de transfert et les conséquences de ces transferts. Ce qui apparaît aujourd'hui comme un handicap sera peut-être un axe de performance à l'avenir. Quoi qu'il en soit, il est essentiel d'accélérer le tempo. Nous nous y sommes attachés dans le cadre du plan de relance mais l'effort doit être poursuivi et accéléré.
S'agissant des lycées agricoles, l'objectif de formation ne doit pas être perdu de vue. Un grand nombre de nos lycées sont désormais convertis au bio ou à la certification haute valeur environnementale (HVE). Ces questions sont donc très présentes dans la formation mais, tout comme nous, les enseignants et les lycéens sont aussi dépendants des alternatives disponibles.
Mme Thomin, il existe effectivement un problème d'articulation avec le niveau européen. Une partie des programmes de l'Inrae sont soutenus au niveau européen. Actuellement, nous cherchons à combler le manque existant en matière de construction d'alternatives. Il convient donc d'aller chercher les moyens mis à disposition au niveau européen, par exemple dans le cadre de la stratégie « De la fourche à la fourchette », ou des actions du commissaire chargé de la transition écologique.
S'agissant des données, nous utilisons la base nationale de la vente de produits phytosanitaires. Ceux qui s'acquittent de la redevance pour pollution diffuse effectuent une déclaration, qui permet d'enregistrer les données. L'Office français de la biodiversité gère cette base, qui est active depuis 2009 et constitue une mine d'informations.
Les collectivités sont assez exemplaires sur les produits phytosanitaires. Depuis la loi Labbé, elles ont pris une longueur d'avance. Elles agissent aussi beaucoup pour le développement des alternatives. En conclusion, je souhaite vous confirmer ma disponibilité et celle de mon ministère pour vous fournir tous les éléments dont vous auriez besoin dans vos travaux.
Je profite de vos questions pour rappeler les deux constats sur lesquels je vous invite à réfléchir. Naturellement, l'agriculture californienne n'est pas identique à la nôtre. Cependant, cet exemple est assez inspirant en matière de protection des populations riveraines mais aussi des travailleurs de l'agriculture. Cela me permet de rappeler que ces travailleurs restent, de très loin, la population la plus exposée et donc probablement la plus en danger. Les données épidémiologiques montrent sans contestation possible que c'est dans cette population que les pesticides font le plus de dégâts en matière de pathologies chroniques. Des tableaux de maladies professionnelles ont été créés depuis dix ans, un fonds d'indemnisation a été mis en place, les vêtements de protection sont en cours de normalisation. On pourrait avoir l'impression que le problème est maintenant bien géré et que les risques professionnels liés aux pesticides sont bien prévenus, mais cela n'est pas le cas. Je pense que cela devrait figurer parmi vos priorités.
La société supporte-t-elle de moins en moins de ne pas savoir ? Il est exact que nos connaissances sont limitées. De plus en plus de données scientifiques sont disponibles sur les dégâts causés par les pesticides. Mais de vastes champs restent encore largement inconnus en matière de santé humaine et d'effets sur la biodiversité.
Il ne faut pas tout attendre de la science : on ne saura pas tout. Il ne faut pas s'abriter derrière un slogan de type « More science is needed » car nous n'aurons pas toutes les réponses à de nombreuses questions, notamment sur les coûts sanitaires de l'exposition aux pesticides. Il faut agir avant.

Nous vous remercions. M. Fugit, je souligne la grande qualité des travaux de la mission d'information sur les glyphosates. Nous aurons à cœur de nous en inspirer et de l'auditionner.

Je vous renouvelle nos remerciements pour votre disponibilité et la qualité de nos échanges. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Puis la commission entend M. Stéphane Pesce, directeur de recherche, animateur de l'équipe écotoxicologie microbienne aquatique (EMA) à l'Inrae, sur les conclusions de l'expertise collective Inrae/Ifremer de 2022 sur l'impact des pesticides sur la biodiversité et les services écosystémiques.

Mes chers collègues, nous reprenons nos auditions en accueillant M. Stéphane Pesce, directeur de recherche à l'Inrae. Monsieur, nous allons vous demander de nous restituer l'expertise scientifique collective réalisée en 2022 sur la question des pesticides et de la biodiversité. J'insiste sur notre besoin de pédagogie : faites comme si nous ne connaissions pas grand-chose ou rien. Nous sommes actuellement dans une phase de construction d'un cadre commun d'acculturation, de vocabulaire technique et de repères, avant de passer à la phase d'enquête proprement dite.
Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure », après avoir activé votre micro.
(M. Stéphane Pesce prête serment).
Je suis devant vous en tant que l'un des pilotes scientifiques de l'expertise scientifique collective sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. J'ai piloté cette expertise avec deux collègues de l'Inrae et de l'Ifremer. Cette expertise a été demandée par les ministères de la transition écologique, de l'agriculture et de l'enseignement supérieur dans le cadre du plan Écophyto.
Quarante-six experts scientifiques de la recherche publique ont été mobilisés, dix-neuf instituts et universités ont été représentés. Ce travail a duré deux ans (2020-2022) et plus de 4 500 références ont été citées dans le rapport final de 1 400 pages. Je serai donc devant vous aujourd'hui le porte-parole de ces scientifiques et suis chargé de vous présenter les principales conclusions de notre travail.
Cette étude portait sur les produits phytopharmaceutiques au sens large : nous avons pris en considération les pesticides de synthèse autorisés et interdits, les produits de biocontrôle et les produits phytopharmaceutiques minéraux comme le cuivre. En complément, nous nous sommes également intéressés aux produits de transformation, c'est-à-dire les produits qui sont formés à partir des substances actives initiales, ainsi qu'aux adjuvants et coformulants présents dans les formules commerciales.
Nous nous sommes intéressés à la contamination et aux impacts le long du continuum terre-mer, en incluant les sols, les milieux aquatiques continentaux (eaux de surfaces et sédiments), mais également le milieu martin. L'objectif était de produire à la fin un état des lieux des connaissances sur l'impact de cette contamination sur la biodiversité structurelle – les espèces présentes ou absentes – mais également la biodiversité fonctionnelle – le fonctionnement des écosystèmes, le rôle écologique des organismes présents dans l'environnement – en allant jusqu'aux services écosystémiques, c'est-à-dire aux avantages de cet écosystème dont nous tirons parti.
En plus de notre étude, deux autres expertises scientifiques collectives de ce type ont eu lieu. La première, menée par l'Inserm, concernait les effets des pesticides sur la santé humaine. La seconde, portée par l'Inrae, s'intéressait à la protection des cultures à travers l'augmentation de la diversité végétale des espèces agricoles. En complément, la prospective « Agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050 » a rendu ses conclusions il y a quelques mois. Le programme prioritaire de recherche (PPR) « Cultiver et Protéger Autrement » est quant à lui en cours.
Le premier enseignement de notre étude est le suivant : tous les compartiments de l'environnement sont contaminés par des produits phytopharmaceutiques issus principalement de l'activité agricole et généralement en mélange. À la suite de la mise en œuvre de la loi Labbé, la tendance est à la diminution de l'usage des produits phytopharmaceutiques pour les produits non agricoles. Par conséquent, la part de l'agriculture a fortement augmenté ces dernières années dans les produits phytosanitaires.
La contamination est majoritairement agricole mais elle n'épargne pas les zones non agricoles, y compris des zones très éloignées des sources. On retrouve par exemple ces produits dans des fonds marins situés à des milliers de kilomètres des zones où ils sont utilisés. Des mélanges de produits phytopharmaceutiques sont présents dans tous les compartiments environnementaux, y compris dans les organismes biologiques. Pour les produits historiques identifiés comme les plus préoccupants et interdits depuis de très nombreuses années pour certains, la tendance est à la baisse des concentrations dans l'environnement.
En revanche, nous pâtissons d'un véritable manque de données pour de nombreux produits phytopharmaceutiques, notamment les substances mises sur le marché récemment, tous les produits en biocontrôle, et pour les produits de transformation. Certaines substances actives donnent ainsi lieu à plusieurs dizaines ou centaines de produits de transformation. Or ces produits sont parfois plus rémanents que la substance initiale, et parfois plus toxiques. Cependant nous n'étudions que quelques dizaines de produits de transformation, alors qu'il y en a plusieurs centaines dans l'environnement.
Il faut également mentionner l'importance du phénomène de « pseudo-persistance » pour les phytopharmaceutiques les plus utilisés. Désormais, la durée de vie des substances est relativement courte, mais les substances utilisées de manière quasi permanente et en grande quantité sont toujours présentes dans l'environnement car on en apporte continuellement.
Pour le grand public, la biodiversité est liée à la présence ou l'absence des espèces. Les PPP contribuent au déclin de la biodiversité à travers la combinaison d'effets directs et indirects. Le déclin de la biodiversité est réel mais il est multi-causal. La pollution par les produits phytopharmaceutiques s'inscrit dans le cadre plus large de la pollution chimique en général. À cette pollution chimique s'ajoutent de nombreux stress environnementaux : le changement climatique, la perte des habitats, l'apparition d'espèces invasives, les maladies. L'IPBES ou plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui est à peu près l'équivalent du Giec pour la biodiversité, estime dans son dernier rapport que la pollution chimique est le troisième ou quatrième facteur responsable du déclin de la diversité et de la dégradation des écosystèmes, à peu près au même niveau que le changement climatique. La cause principale est liée aux changements d'utilisation des terres et des mers. Encore une fois, les phytopharmaceutiques ne sont qu'une partie des polluants chimiques que l'on retrouve dans l'environnement.
On constate une hétérogénéité des connaissances mais les conclusions les plus robustes concernent les espaces agricoles, qu'il s'agisse des milieux terrestres ou aquatiques. En revanche, en milieu marin, très peu de travaux s'intéressent à l'impact des produits phytopharmaceutiques.
Dans les espaces agricoles, l'abondance de données permet d'effectuer des analyses à larges échelles spatiales ou temporelles. Cependant, ces analyses concernent surtout des pesticides de synthèse et principalement des pesticides historiques, parfois interdits aujourd'hui. Par ailleurs, de nombreux travaux ont porté sur les impacts du cuivre utilisé en agriculture biologique. Un manque de connaissances doit néanmoins être déploré concernant le biocontrôle et les territoires d'outre-mer, au-delà de la problématique du chlordécone.
Sur la base des connaissances scientifiques, il est indéniable que les produits phytopharmaceutiques sont une des causes majeures du déclin de certaines populations, en particulier tous les invertébrés terrestres, comme les vers de terre, les carabes et les coccinelles. Les invertébrés aquatiques sont également touchés dans les territoires agricoles, de même que les oiseaux. Les effets ne sont pas les mêmes selon le mode de vie et l'alimentation de ces oiseaux.
Il existe également des suspicions très fortes sur les amphibiens et les chauves-souris, même s'il est difficile d'isoler la part relative des produits phytopharmaceutiques par rapport aux autres stress environnementaux, notamment en raison du nombre d'études limité.
Historiquement, les effets étaient très marqués lorsque l'on utilisait des substances très toxiques, à forte concentration et très rémanentes – ils étaient fréquemment létaux. Les effets sont aujourd'hui plus insidieux et chroniques. La science met de plus en plus en évidence des effets sublétaux, sur le long terme. Il peut exister par exemple des immunodéficiences (les organismes seront plus vulnérables à certaines maladies) ou des déficiences comportementales (les abeilles n'arrivent plus à retrouver leur ruche, les oiseaux prennent du retard dans leur migration), des dysfonctionnements en matière de reproduction. Ces effets ne sont pas forcément visibles de manière simple mais les conséquences de long terme sont réelles, entraînant un déclin des populations.
À ces effets directs liés à la toxicité des substances, il convient d'ajouter les effets indirects. Parmi ceux-ci, on observe par exemple des diminutions de ressources alimentaires ou la dégradation des habitats. Pour ma démonstration, je vais utiliser l'exemple des oiseaux, qui est à la fois parlant et pédagogique. Les oiseaux granivores sont plutôt intoxiqués directement, lorsqu'ils avalent des semences traitées et qui contiennent des produits toxiques. L'effet sur les granivores peut également être indirect, en cas de baisse de la disponibilité des graines adventices.
La situation est inverse chez les oiseaux insectivores : il y a peu d'effets directs, à part s'ils ingèrent des proies contaminées. Le plus souvent, les effets sont liés à une perte de ressources : si les insectes sont très touchés par la présence de phytopharmaceutiques, le garde-manger de ces oiseaux se vide. Une étude trop récente pour avoir été prise en compte dans notre expertise a porté sur l'observation des oiseaux pendant plus de trente ans, sur 20 000 sites à l'échelle européenne. Ces effets indirects ont été démontrés scientifiquement et l'on constate un fort impact sur le déclin de ces populations.
À présent, je souhaite évoquer la question des fonctions écosystémiques, c'est-à-dire le rôle écologique de ces organismes dans le milieu. Une première fonction importante consiste à fournir des habitats et des biotopes pour les organismes. Par exemple, la végétation remplit ce rôle, en servant d'habitat et de refuge pour différents organismes. Si elle est impactée par les herbicides ou par le cuivre, une dégradation, voire une perte de ces habitats peut survenir. La notion de zone refuge est essentielle : les impacts sont moindres dans les régions où il existe une diversité d'habitats, où les organismes peuvent aller se réfugier lorsque la pression chimique est forte et ensuite recoloniser le milieu quand cette pression diminue. Ces zones refuge constituent donc des réservoirs de biodiversité que nous devons protéger, au même titre que la connectivité de ces zones avec les écosystèmes. Or si les produits phytopharmaceutiques sont présents partout, il n'existe plus de zones refuge, mais uniquement des zones tampon.
Une autre fonction porte sur la dégradation de la matière organique. L'hiver, les feuilles mortes envahissent nos écosystèmes terrestres et aquatiques. Ces ressources sont importantes pour les écosystèmes à cette période de l'année : la matière organique dégradée sert de base énergétique grâce à l'activité des micro-organismes et de certains invertébrés qui vont s'en nourrir pour produire de la biomasse, qui sera elle-même consommée par les autres organismes. Cette décomposition de matière organique est très impactée par les insecticides, les fongicides et le cuivre. Dans certaines rivières situées en zone agricole, ces substances sont fréquemment présentes et entraînent une inhibition parfois complète de la dégradation des feuilles, qui ne servent plus de ressource alimentaire pour l'écosystème rivière, lequel, de ce fait, dysfonctionne. Les microorganismes ne sont pas très considérés en matière de biodiversité mais leur relai écologique est primordial. Il est donc important de tenir compte de cette biodiversité fonctionnelle.
Une autre fonction essentielle consiste à conférer à l'écosystème une résistance aux perturbations. De plus en plus de travaux sont menés sur les effets concomitants des produits phytopharmaceutiques et du dérèglement climatique, non seulement par le changement des températures mais aussi par la multiplication des évènements extrêmes : fortes précipitations, épisodes de sécheresse. Dans 80 % des cas, les travaux mettent en évidence que les effets des stress pris individuellement sont accrus lorsqu'on les mélange. Par ailleurs, la communauté scientifique a également besoin d'innovations conceptuelles et méthodologiques pour aborder cette question du lien entre changement climatique et pression chimique de manière plus globale que ce que nous faisons pour le moment. Il sera sans doute nécessaire de faire appel à la modélisation pour pouvoir passer un cap en termes de connaissances.
Une autre vulnérabilité concerne celle des parasites et agents pathogènes. De plus en plus de travaux soulignent que certains produits phytopharmaceutiques, en particulier les insecticides néonicotinoïdes, fragilisent les populations d'abeilles, d'oiseaux ou de chauves-souris, qui deviennent plus vulnérables lorsqu'elles sont soumises à des pressions biologiques comme des maladies ou des virus. Les effets sont sublétaux mais entraînent néanmoins des conséquences sur les populations.
Si l'on va plus loin, en dépassant cette fonction écologique, il est possible d'aller jusqu'aux services écosystémiques. En matière de santé environnementale, trois grands services sont étudiés : la production végétale cultivée, la lutte naturelle contre les ravageurs et la pollinisation. La production végétale cultivée est plutôt favorisée par l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mais la lutte naturelle contre les ravageurs et la pollinisation subissent les effets négatifs de la contamination par ces mêmes produits.
La notion de service écosystémique est assez récente dans la sphère scientifique et il importe de créer des passerelles entre les chercheurs. Elle permet de prendre des décisions car elle prend en considération les effets négatifs comme positifs pour établir un choix in fine. Certains services sont quasi ignorés, comme les services en lien avec la qualité des sols. Les experts que vous auditionnerez la semaine prochaine seront certainement plus précis que moi dans ce domaine.
Dans cette expertise, nous nous sommes également intéressés aux leviers d'action. Il est possible de continuer à utiliser les substances, en choisissant les moins dangereuses et surtout en adaptant les pratiques pour limiter les transferts. Parmi les substances les moins dangereuses, il est souvent question du biocontrôle. Vraisemblablement, l'utilisation du biocontrôle est bénéfique, mais avons besoin de connaissances pour nous en assurer : à ce stade, nous ne sommes pas capables de fournir des réponses robustes. La communauté scientifique est bien consciente de la nécessité de travailler sur ces substances et de ne pas se contenter de son origine naturelle.
La phase d'application est importante. Les agriculteurs connaissent la nécessité de s'adapter aux conditions météorologiques et d'adopter une utilisation raisonnée. La gestion du sol est également essentielle : le sol est le premier récepteur.
Notre expertise s'attache également à mettre en lumière la nécessaire réflexion à l'échelle du paysage, au-delà de la parcelle. L'utilisation des produits phytopharmaceutiques doit ainsi être pensée au sein d'un paysage et essayer de faire en sorte que ce paysage soit aussi diversifié que possible, en contenant des zones tampons et des zones refuge permettant aux organismes d'aller se réfugier si besoin avant de revenir dans le milieu. À l'échelle d'un paysage, différents acteurs interviennent, avec des attentes et des prérogatives distinctes.
La zone tampon permet d'éviter les transferts et d'épargner le milieu aquatique, qui est le vecteur de cette contamination. Il faut également penser en termes de zones refuge, de biodiversité et de multiplicité d'habitats. Il n'existe pas de solution miracle. Seule une combinaison de leviers permet d'améliorer les impacts. Il importe donc de pas raisonner uniquement en quantités de substances utilisées, mais en impacts. Les premiers plans Écophyto ont surtout raisonné en quantités, mais nous nous orientons de plus en plus vers les notions de risque et d'impact. Les Suisses disposent d'une longue expertise en la matière.
Le dernier levier est constitué par la réglementation. Dans la littérature scientifique internationale, il apparaît que les objectifs de la réglementation européenne sont vus comme suffisamment protecteurs et ambitieux. De fait, de nombreux substances et produits phytopharmaceutiques sont interdits en Europe mais encore utilisés dans d'autres parties du monde. Cette réglementation est en effet très exigeante mais elle nécessite, pour être appliquée, la production d'un grand nombre de données. Les objectifs sont ainsi ambitieux, mais les routines des procédures d'évaluation des risques et les critères de détermination des risques sont encore largement perfectibles.
Il est donc également nécessaire de faire appel aux savoirs non académiques et aux sciences humaines et sociales pour aider à la prise de décision. La réglementation ne permet pas d'éviter complètement la contamination du milieu, ni de protéger la biodiversité à hauteur des objectifs affichés.
Pour y remédier, la littérature scientifique propose plusieurs pistes. Il s'agit d'abord de pistes réglementaires, comme de faire réaliser les études par des laboratoires indépendants et non par les firmes qui commercialisent les produits phytopharmaceutiques elles-mêmes. Tous les résultats des tests doivent être publiés pour permettre aux scientifiques d'y accéder, ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle. Il faut également renforcer les suivis post autorisation. En France, le dispositif de phytopharmacovigilance permet de suivre le devenir et les impacts des substances une fois qu'elles sont présentes dans le milieu. Porté par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), ce dispositif constitue une spécificité et un point fort de la France.
Il faut également se concentrer sur le passage de la connaissance scientifique à la prise de décision. Bien souvent, les scientifiques produisent de nombreux rapports dont les recommandations ne sont pas toujours appliquées, pour diverses raisons. Sans doute convient-il de revoir le processus, afin d'y apporter une plus grande souplesse. Enfin, les scientifiques doivent également faire l'effort de normaliser leurs approches ; de développer de nouveaux tests sur d'autres types d'espèces pour être plus représentatifs de la biodiversité et de sa complexité ; et enfin d'essayer de nouvelles méthodes et de nouveaux concepts pour aborder les questions de multi-stress.

Je vous remercie pour la clarté de votre propos. Vous avez eu l'intelligence de resituer cette étude parmi d'autres. Je souhaite vous poser trois questions. La première porte sur une question de vocabulaire. Vous avez évoqué la biodiversité fonctionnelle mais quelles sont les autres qualités que l'on attribue à la biodiversité, par contraste ?
Ensuite, vous avez mentionné la question des quantités et des instruments de mesure, pour plaider en faveur d'un accent à mettre sur l'étude des impacts. En 2014, quand j'avais rendu mon rapport au Premier ministre, ceux qui voulaient que cela continue comme avant tenaient le même discours, afin de ne pas diminuer les quantités. Est-ce l'un ou l'autre ? Il semble qu'il serait pertinent de combiner les deux approches.
Enfin, je propose à tous mes collègues de feuilleter La fabrique de l'agronomie, une formidable somme produite par des agronomes de la génération des années 1980. Il y est indiqué qu'un des prochains bouleversements consistera à passer de l'approche « parcelle » et de l'approche « exploitation » à l'approche territoriale, que vous avez esquissée dans votre présentation. Ceci est assez perturbant puisque celui qui décide, in fine, c'est l'agriculteur. La chaîne du continuum recherche-développement-conseil mise de fait sur la responsabilité de l'agriculteur. Cependant, de votre côté, vous nous indiquez que le véritable impact sur la biodiversité relève d'une approche territoriale. Comment pourrons-nous articuler, en termes méthodologiques, un agriculteur décideur qui tient compte de ses parcelles et de son exploitation à une mosaïque paysagère, dont le décideur n'est pas le même ? Nous avons besoin de défricher cette question fondamentale.
La biodiversité est constituée par l'ensemble des organismes et écosystèmes que l'on retrouve dans l'environnement. Elle peut être abordée sous différents angles. De manière assez classique, on peut l'envisager comme le nombre d'espèces présentes sur un territoire d'étude. Cependant, certaines espèces ont une valeur patrimoniale qui vient masquer le véritable contenu de la biodiversité. Quand on parle biodiversité, le grand public imagine tout de suite un panda ou un ours blanc, mais jamais une bactérie ou un champignon. Nous militons pour que ce grand public et les décideurs prennent conscience que les espèces ont un rôle à jouer dans leur environnement. Il existe heureusement la redondance fonctionnelle : généralement, les grandes fonctions ne sont pas uniquement assurées par une seule espèce. Cela permet aux écosystèmes de se maintenir même si des espèces disparaissent.
Il existe une liste de fonctions écologiques essentielles. En matière de sols, une fonction importante concerne tous les organismes qui contribuent à structurer un sol, limiter son érosion et le rendre fertile. Cette fonction est précisément assurée par un ensemble d'organismes, dont les plantes, les microbes, les vers de terre. Il importe donc de prendre en compte la diversité de la biodiversité, et notamment le rôle plus invisible des microorganismes.
S'agissant de l'évaluation, il s'agit de mesurer à la fois les quantités et les impacts. La mesure par la quantité est utile, en particulier pour les substances connues, dont on connaît la toxicité. Cependant, compte tenu du nombre de substances actives, de produits de transformation et d'organismes potentiellement exposés, on ne sera jamais capable de mesurer précisément le risque de toutes les substances individuellement. C'est ici que les mesures d'impact prennent tout leur sens.
Il faut donc combiner les deux approches. Quand les preuves d'un impact marqué d'une substance sont robustes et irréfutables, on peut raisonner en quantités et en autorisation. Sur le long terme, il est en revanche important de disposer d'indicateurs se fondant sur les impacts. L'évolution des plans Écophyto va dans le sens de cette combinaison.
Vous avez évoqué le changement d'échelle. Les enjeux ne sont pas les mêmes, compte tenu de la diversité des acteurs sur un territoire et donc de leurs attentes. Des pistes sont testées en ce moment, notamment des « jeux sérieux », formes de jeux de rôle, où l'on réunit autour de la table les différents acteurs en les faisant échanger leurs rôles. S'il ne s'agit pas d'une solution miracle, elle permet néanmoins de discerner les points bloquants et d'identifier les leviers potentiels, afin que les gens arrivent à se retrouver autour d'une vision commune. Dans certains cas, les vocabulaires ne sont pas communs et les indicateurs sont différents. En résumé, notre travail collectif met bien évidence la nécessité de passer à ce changement d'échelle.

M. Durand a évoqué les indicateurs de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT) mais je pense qu'ils ne prouvent rien. Un traitement en cuivre compte un pour une dose et un traitement avec un produit chimique de type CMR en pleine dose compte aussi pour un. L'indicateur ne permet donc pas d'obtenir des résultats concluants.
Compte tenu des différents scandales qui éclatent parfois dans la presse, ne pensez-vous pas que l'emballement politico-médiatique dépasse le strict cadre de la science ? J'ai un exemple précis en tête, sur le chlorothalonil, dont on a retrouvé des traces dans l'eau potable. N'est-il pas problématique de pointer immédiatement l'agriculture ? Je rappelle que cette substance se retrouve également dans les peintures pour bateaux. Je m'interroge également sur les seuils de toxicité : ne nous sommes-nous pas emballés trop rapidement en sachant que les quantités retrouvées dans les eaux potables étaient particulièrement infimes ?
Il m'est difficile de vous répondre, puisque ces sujets dépassent mon cadre d'expertise. Vos questions concernent plutôt l'expertise de l'Inserm. Cependant, nos études montrent effectivement que certaines substances sont utilisées au-delà du secteur agricole. Les conclusions les plus robustes sur les impacts des produits phytopharmaceutiques ont cependant lieu dans les zones agricoles.
Ensuite, les indicateurs d'impact dont je parle sont fondés sur l'étude des organismes biologiques dans le milieu. Certains travaux, notamment ceux de l'Office français pour biodiversité (OFB) visent à développer des indicateurs de diagnostic d'impact, dont certains sur les produits phytopharmaceutiques, fondés sur l'étude des organismes présents dans le milieu. Des travaux sont développés pour étudier la présence des substances toxiques au sein des organismes. Une méthode consiste par exemple à encager dans une rivière des petites crevettes pendant un certain temps pour voir si elles contiennent des traces de produits phytopharmaceutiques dans leurs corps. Ce type d'indicateurs est ainsi utilisé dans le cadre de la directive européenne sur l'eau. Il s'agit donc de donner plus de poids aux indicateurs biologiques.

Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez indiqué que le déclin de la biodiversité était multi causal. Vous souligniez ainsi que la pollution chimique était une cause de même rang que le changement climatique. Vous évoquiez non seulement les pesticides mais également l'ensemble des pollutions chimiques. Est-il possible de hiérarchiser les pollutions chimiques, pour voir la part des utilisations par secteur, dont celle de l'agriculture ?
Par ailleurs, on ne trouve que ce que l'on cherche. Qu'en est-il de l'effet cocktail ? Enfin, certaines molécules sont interdites chez nous mais autorisées dans d'autres pays. Comme on sait que rien ne se perd, que rien ne se crée mais que tout se transforme à l'échelle de la planète, que pensez-vous de cette situation, notamment en lien avec le cycle de l'eau ?
S'agissant de la multi-pollution, il est clair que les produits phytopharmaceutiques ne sont pas les seuls que l'on retrouve dans les milieux, y compris les milieux aquatiques et dans les zones agricoles. En tant que chercheur en écotoxicologie aquatique, je m'intéresse depuis très longtemps aux contaminations dans les zones viticoles. Ainsi, j'ai beaucoup travaillé dans le Beaujolais. Pendant de nombreuses années, on ne regardait que le cuivre, les pesticides et les herbicides. Depuis quelques années, nous nous sommes intéressés aux résidus de médicament. Dans les petits cours d'eau agricoles, nous avons ainsi retrouvé ces résidus, avec parfois des concentrations supérieures à celles des produits phytopharmaceutiques. Ces résultats nous ont surpris : on les retrouve partout.
Il existe donc des « cocktails » de produits phytopharmaceutiques, y compris dans les zones agricoles, qui comprennent différents types de substances. Ces mélanges sont encore plus diversifiés dans les zones urbanisées et industrielles. Il est clair que les produits phytopharmaceutiques ne sont pas les seuls responsables et qu'ils n'interviennent jamais seuls.
Vous avez ajouté que l'on ne trouve que ce que l'on cherche. Je partage votre point de vue. La chimie environnementale a accompli d'immenses progrès au cours des vingt dernières années en matière d'identification et de quantification des substances. Depuis quelques années, on pratique des approches non ciblées qui permettent d'identifier de nouveaux produits de transformation, sans a priori de ciblage. Ces méthodes sont pour le moment expérimentales, mais elles progressent beaucoup, au même titre que le développement des échantillonneurs passifs.
Auparavant, le suivi réglementaire de la qualité de l'eau était fondé sur des échantillonnages ponctuels : un calendrier était établi à l'Agence de l'eau et le préleveur se rendait sur place sans tenir compte des conditions météorologiques, des débits ou des pratiques. Les échantillonneurs passifs sont placés dans les cours d'eau, ces systèmes restent plusieurs semaines, pour avoir une vision plus exhaustive et ne pas passer à côté de pics de contamination très brefs.
On devrait ainsi être en mesure de trouver de plus en plus, assez rapidement. Mais pour les substances qui sont bien mesurées, on a constaté en quinze ans que les concentrations avaient diminué de dix, cent voire mille fois. C'est la raison pour laquelle il importe d'étudier aussi le sujet sous l'angle des impacts. On a amélioré la qualité chimique du milieu mais avons-nous amélioré sa qualité écologique ? C'est autre question.

Certaines molécules sont interdites chez nous mais autorisées dans d'autres pays. Que pensez-vous de cette situation ?
Les transports par l'atmosphère et les couloirs aériens ne sont pas neutres. Des suivis commencent à se mettre en place pour tracer des produits dans l'atmosphère, même s'il reste encore des limites méthodologiques. L'existence de décalages de réglementation en fonction des zones géographiques peut poser problème. Mais si tous les pays européens respectaient la réglementation communautaire, un grand nombre de problèmes seraient déjà résolus à notre échelle. Plus c'est près, plus c'est problématique.

Vous avez évoqué la réflexion à l'échelle du paysage, qui me semble être centrale dans nos travaux. Pourriez-vous nous rappeler l'importance de la maîtrise du cycle de l'eau et de sa qualité ? Quel peut-être l'impact de l'usage des produits phytosanitaires sur nos biens communs, la diversité de nos productions et de notre économie locale ? Je suis députée du fond de la rade de Brest et nos ostréiculteurs et conchyliculteurs sont sensibles au débat que nous portons aujourd'hui. Quel est l'état de la réflexion sur la difficulté de cohabitation de différentes filières de production ?
Pouvez-vous nous donner de plus amples indications concernant les usages des produits de biocontrôle et les risques pressentis ? Vous avez souligné que la connaissance était actuellement insuffisante dans ce domaine. Pouvez-vous davantage développer ?
La loi européenne sur la restauration de la nature a été adoptée hier mais elle exclut les terres agricoles des objectifs de restauration des écosystèmes. La contrainte des indicateurs a été supprimée dans l'évaluation de ces écosystèmes. Quelles sont les conséquences de cette exclusion ?
Je ne peux répondre à vos deux premières questions, qui ne relèvent pas de mon champ scientifique. S'agissant de votre dernier point, il est difficile de définir la notion de terre agricole en tant qu'écosystème : où commence et s'arrête l'écosystème ? Cette précision est nécessaire. Une parcelle agricole peut quand même être considérée comme un vecteur de biodiversité. D'autres terres seront des sols nus à part la plante que l'on y fait pousser. Il importe donc de bien cerner les définitions de terre agricole et d'écosystème. Les parcelles sont très diverses et certaines sont des écosystèmes en elles-mêmes. Tout dépend des pratiques et des rotations des cultures. En résumé, la réflexion doit être menée au niveau du paysage.

Pouvez-vous revenir sur l'effet cocktail ? Essayons de raisonner en termes de quantité. Si un mono résidu est en quantité équivalente à plusieurs résidus, la nuisance au milieu est-elle identique ?
Il existe trois types d'interactions entre les substances que l'on teste en mélanges. L'hypothèse la plus souvent testée et assez souvent vérifiée est l'hypothèse d'additivité : quand deux substances sont mélangées, leurs effets s'additionnent. Cet effet est assez courant et on l'observe surtout quand les substances ont des modes d'action assez similaires. Si deux herbicides sont de la même famille, avec le même mode d'action, leur association aura un effet additif, que l'on mesure en unités toxiques et non en quantité. Dans certains cas, il existe des effets synergiques, c'est-à-dire des effets démultipliés. Les mécanismes peuvent être variés et sont assez complexes. À l'inverse, les effets cocktails peuvent donner un résultat plus faible que la somme des parties.
La communauté scientifique travaille sur ces différentes interactions pour essayer de comprendre dans quels cas elles se produisent et dans quels cas elles ne se produisent pas. Nous ne serons jamais en mesure de tester tous les mélanges possibles qui interviennent dans l'environnement, ne serait-ce que pour les substances actives. La communauté scientifique essaye de travailler sur des approches de modélisation, sur la base des effets décrits et des structures moléculaires des substances. Les pistes creusées actuellement visent à trouver des moyens techniques et opérationnels pour prédire les effets cocktail sans devoir les tester. Cette question est extrêmement complexe et je sais qu'elle m'accompagnera malheureusement tout au long de ma carrière.

Vous avez indiqué au début de votre intervention que la pollution chimique était le troisième ou quatrième facteur responsable du déclin de la diversité et de la dégradation des écosystèmes. Pouvez-vous me rappeler ce qui occupe la première et la deuxième place ?
Ensuite, vous avez évoqué les zones de refuge et des zones de transfert pour les animaux. Pourriez-vous développer ce que vous avez dit concernant le biotope de ces refuges ? Par ailleurs, je vous rejoins au sujet de l'approche territoriale. Quelle action doit, selon vous, être menée pour que les acteurs du territoire prennent conscience du travail à conduire ? Il s'agit en effet de prendre conscience des différentes approches que vous avez évoquées et auxquelles j'ajouterais l'approche à la parcelle industrielle de la ville voisine. Comment pourrions-nous faire le lien entre tous les acteurs en coresponsabilité pour la biodiversité de demain ?
Les différents facteurs sont ceux de l'IPBES. Le classement varie selon les écosystèmes que l'on considère. Dans l'écosystème terrestre, le premier facteur de dégradation de la biodiversité est le changement d'utilisation des terres, le deuxième est l'exploitation directe des ressources (surpêche, surchasse), devant le changement climatique et la pollution exæquo. Viennent ensuite les espèces exotiques envahissantes qui colonisent les milieux et prennent la place des espèces naturelles. Dans le milieu marin, la surpêche est en première position.
À la suite de l'expertise réalisée en 2005, de nombreux travaux ont concerné la mise en place de zones tampon, soit des zones tampon enherbées – en amont des milieux aquatiques, sous forme de prairies – soit des zones humides, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Ces zones tampons servent à limiter les écoulements et les transferts, afin qu'ils n'aillent pas jusqu'aux milieux aquatiques.
Cependant, ces zones tampons deviennent souvent à leur tour contaminées. Nous ne pouvons donc pas nous contenter de zones tampon, qui ne constituent pas des réservoirs de biodiversité. Les espèces qui y sont présentes témoignent surtout de leur adaptation à la contamination, qui a un rôle important dans la biodégradation, laquelle est également une fonction écologique. En résumé, les zones tampon ne permettent pas aux espèces sensibles de survivre. C'est la raison pour laquelle il faut également prendre en compte d'autres zones qui jouent un rôle de biotope et d'habitat naturel, pour servir de réservoir de biodiversité.
Je vous ai parlé un peu plus tôt d'une étude récente sur le déclin des populations d'oiseaux. Un des paramètres pris en considération dans l'étude a précisément été l'évolution des zones forestières. L'augmentation des zones forestières s'avère avoir un impact positif sur la biodiversité des oiseaux, qui contrebalance l'effet négatif de l'utilisation d'intrants à proximité.
Une des pistes consiste à travailler par l'entrée des services écosystémiques : tout le monde doit prendre conscience que la biodiversité joue un rôle pour le bon fonctionnement de l'écosystème mais aussi pour notre bien-être, y compris pour notre productivité agricole. Si l'on arrive à contrebalancer l'utilisation de substances problématiques par des pratiques plus vertueuses qui permettent de favoriser le rôle naturel de la biodiversité, la sensibilisation sera meilleure. L'avantage de cette approche par les services écosystémiques est de permettre aux scientifiques qui l'emploient d'obtenir des données chiffrées, notamment des données financières. Cela permet par exemple de chiffrer en milliards de dollars le coût de la perte des pollinisateurs naturels. Certes, certains pays asiatiques travaillent actuellement à la fabrication de robots pollinisateurs qui pourraient pallier les pertes des insectes.
Cette approche de services écosystémiques essaye toujours d'établir une balance entre les aspects négatifs et positifs, pour permettre de trancher à l'aide de données chiffrées. Cependant, cette sphère de la recherche est vraiment spécifique et concerne surtout les économistes et les anthropologues. De notre côté, nous évoluons plutôt dans le domaine de la science environnementale. Lors de notre étude, nous avons pu constater qu'il était parfois difficile de se comprendre et de se parler. Il existe donc un réel besoin de décloisonner la recherche et de sortir des silos. Cependant, nous progressons.
Le plan Écophyto permet de son côté de financer les recherches. Après cette audition, je dois me rendre La Défense pour participer au conseil scientifique et d'orientation d'Écophyto, afin de discuter des recherches qu'il faudrait financer. Ce comité scientifique présente ainsi l'intérêt d'associer différents chercheurs : des chimistes, des écologues, des économistes, des agronomes. C'est en réunissant tout le monde autour de la table que l'on peut identifier les enjeux et produire un discours commun.

Nous évoluons dans un contexte de dérèglement climatique. Ces derniers mois, nous avons beaucoup débattu du risque incendie dans le domaine des politiques publiques. Au niveau des collectivités locales, le plan de prévention et de lutte contre le risque incendie est ainsi mis en place et comporte de nouvelles obligations préfectorales, notamment dans les zones à risque. Parmi celles-ci figure l'obligation de débroussaillage. Comment s'articulent cette politique publique avec les zones refuge et les zones tampon ? Ces plans incendie sont-ils en adéquation avec vos préconisations ?
Votre remarque est très pertinente. Selon le problème abordé, les solutions peuvent parfois être antinomiques. En effet, de nombreux travaux envisagent de remettre des haies et d'essayer de laisser pousser la végétation naturelle, en évitant le plus possible les débroussaillages. En réalité, tout est question de priorisation dans l'approche des risques : le risque incendie est-il plus important que le risque chimique ? Cette question ne peut être abordée d'un bloc sur le plan national, mais territoire par territoire, en fonction de leurs spécificités. Je ne suis pas spécialiste du risque incendie, mais j'imagine qu'il n'est pas le même selon les endroits où l'on se trouve. Il en va de même pour le risque chimique.
La réglementation pose des problèmes, car elle ne peut se permettre de fonctionner au cas par cas. Le bon sens doit alors guider les actions, en trouvant un compromis entre ce qu'il est possible de mettre en place et ce qu'il faudrait faire dans l'idéal.

Une étude internationale sur la biodiversité a été publiée le 15 mai dernier et a fait grand bruit. Elle parlait notamment des populations d'insectes et d'oiseaux. Ses conclusions sont-elles semblables à celles de votre expertise ?
Depuis longtemps, l'Inrae promeut l'idée de soutenir la biodiversité par la taille des parcelles, mais cette idée n'a pas été retenue par le ministère de l'agriculture. La taille des parcelles aurait ainsi pu constituer un indicateur dans le cadre de la PAC : des parcelles de quatre hectares jouent un rôle positif dans la mosaïque paysagère, du fait de leur simple séquencement. Que pensez-vous de cette proposition ?
Ensuite, un grand débat s'annonce au sein de notre commission sur les sujets du carbone, de la biodiversité et de la chimie, autour de l'agriculture de conservation. Notre commission devra examiner cette question. Étant issu de l'agriculture biologique, je les aborde avec une grande humilité. Quelles sont vos pistes de réflexion sur ce sujet ?
Enfin, vous avez peu développé l'idée que la biodiversité est d'abord à la poursuite de la fertilité et donc de la productivité. Pouvez-vous évoquer vos convictions en la matière, ainsi que le lien entre la dégradation de la biodiversité et le risque santé, dans une approche de santé environnementale ? Quelles ont été les conclusions de votre expertise en la matière ?
Le travail publié le 15 mai va dans le même sens que nos conclusions. Notre travail a été réalisé par des chercheurs français mais il s'est fondé sur la littérature internationale. Certains de nos collègues pensent d'ailleurs que nous aurions pu aller encore plus loin dans nos conclusions mais nous avons voulu être certains des affirmations que nous mettions en avant. Un livre de 150 pages a d'ailleurs été édité gratuitement sous format PDF à destination du grand public et je vous invite à le consulter.
Vous m'interrogez sur la taille et la diversité des parcelles : plus le paysage sera diversifié en termes de parcelles et de culture, mieux la biodiversité se portera. S'agissant de l'agriculture de conservation, je vous invite à convier des spécialistes, notamment ceux de l'Inrae, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet.
Vous avez évoqué la biodiversité au service de la productivité. Un des grands absents en termes de suivi réglementaire et de suivi des impacts sur les services écosystémiques est le sol. La directive cadre sur l'eau est certes nettement en avance, mais au-delà, très peu de travaux scientifiques ont porté jusqu'à présent sur les services écosystémiques rendus par le sol, y compris en termes de fertilité. Les spécialistes que vous auditionnerez la semaine prochaine pourront certainement vous éclairer sur ce sujet.
Les liens entre biodiversité et santé sont très prégnants, surtout dans l'approche « Une seule santé » ou « One Health ». Santé humaine, santé animale et santé environnementale sont, de fait, liées. Mais cette approche n'est pas encore très abordée du point de vue des produits phytopharmaceutiques. Pour le moment, les connaissances scientifiques sur les liens entre santé et environnement au niveau phytopharmaceutique se limitent aux quantités de résidus que l'on retrouve dans les aliments ou l'eau potable. Le lien avec la biodiversité en tant que telle est encore peu abordé. Plus l'on réduit la biodiversité, plus les risques de zoonose sont importants.

Vous nous avez éclairés sur l'approche profane du mot biodiversité, qui se fonde sur l'emblème de la disparition de certaines espèces, surtout quand elles sont de grande taille. Vous nous avez décrit la biodiversité sous un angle plus subtil et plus complet, en évoquant les notions de fonction écosystémique et de qualité écologique.
En termes de méthode scientifique, l'appréhension de cette diversité – je pense à la recherche sur les microbiotes dont on découvre l'étendue depuis la diminution des coûts de séquençage – n'entraine-t-elle pas un changement de paradigme ? Jusqu'à présent, l'approche chimique très mécanique prévalait, au travers de modèles de causalité. Nous passons désormais à des approches plus empiriques, qui permettent une appréhension de la biodiversité pour juger de la qualité écologique des écosystèmes et des fonctions remplies.
D'immenses progrès sont intervenus en écologie, à travers le développement des approches fondées sur le séquençage et l'étude de l'ADN environnemental. Il est désormais beaucoup plus simple d'observer les microorganismes, qui sont au cœur de mes recherches depuis ma thèse. Quand j'ai commencé, nous avions du mal à mettre en lumière le rôle de ces microorganismes invisibles. Désormais, leur caractère essentiel est clairement démontré : tous les organismes vivants ont une flore microbienne, au même titre que l'environnement. Quand j'étais jeune docteur, il me fallait deux mois pour séquencer six bactéries. Aujourd'hui, on peut séquencer 10 000 échantillons en deux jours, pour le même prix.
À cette flore microbienne s'ajoute également le rôle d'autres organismes, comme les vers de terre ou les pollinisateurs. Les développements méthodologiques nous permettent de mesurer des phénomènes que nous n'arrivions pas à mesurer il y a encore dix ans, et donc de dépasser la simple présence ou absence d'oiseaux emblématiques. Aujourd'hui, nous sommes capables de quantifier l'invisible et de placer des indicateurs sur des microorganismes : il est de plus en plus possible d'établir un lien entre telle espèce et tel rôle écologique. Nous sommes aussi capables de mesurer les fonctions des activités biologiques sur le terrain, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques années. Le champ des indicateurs potentiels, qu'ils soient biologiques ou chimiques ne cesse donc de croître.
Aujourd'hui, nous sommes encore au stade des recherches durant lequel chaque laboratoire développe son propre protocole ou effectue un focus sur tel ou tel sujet particulier. Les données sont nombreuses, mais pour pouvoir les rendre robustes et en tirer des conclusions, elles doivent être reproduites et reproductibles, grâce à des études fiables conduites sur la durée. L'idée consiste donc, à un moment donné, à utiliser les mêmes méthodes et indicateurs, de manière coordonnée. C'est le passage classique du développement en laboratoire à une application à plus large échelle, pas nécessairement dans un contexte réglementaire. Par exemple, les approches sur le séquençage sont encore en constante évolution, y compris sur la manière d'acquérir les données et de les traiter. Il n'est donc pas encore possible de comparer tous les résultats.
La séance s'achève à douze heures vingt.
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Françoise Buffet, M. Frédéric Descrozaille, M. Grégoire de Fournas, M. Jean-Luc Fugit, Mme Marine Hamelet, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Mathilde Hignet, M. Timothée Houssin, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Pochon, M. Dominique Potier, Mme Mélanie Thomin
Excusés. – M. André Chassaigne, Mme Claire Pitollat, M. Michel Sala