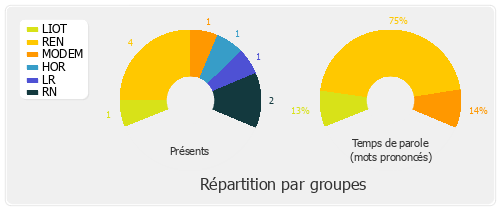Commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer
Réunion du jeudi 1er février 2024 à 14h00
La réunion
Commission d'enquête SUR la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer
Jeudi 1er février 2024
La séance est ouverte à quatorze heures
Présidence de M. Mansour Kamardine, président
La commission procède à l'audition ouverte à la presse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC groupe 2) : M. Gonéri Le Cozannet, direction risques et prévention, Unité risques côtiers et changement climatique, Bureau de recherches géologiques et minières(BRGM) et Mme Annamaria Lammel, professeur émérite à l'Université Paris 8, directrice de recherche au laboratoire Paragraphe (EA 3898).

Nous ouvrons les travaux de notre commission d'enquête par une série d'auditions sur les éclairages scientifiques concernant les risques naturels majeurs dans les outre-mer et l'impact du dérèglement climatique.
Nous auditionnons tout d'abord deux membres du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.
Cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et son enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Elle fera également l'objet d'un compte rendu.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(Mme Annamaria Lammel et M. Gonéri Le Cozannet prêtent successivement serment.)
Nous vous avons communiqué des documents et de premières réponses écrites à votre questionnaire.
Tout d'abord, nous ne sommes pas membres du Giec : les membres du Giec, ce sont les États. Nous sommes des coauteurs du sixième rapport du Giec.
Le mandat du Giec est d'évaluer l'information scientifique, technique, sociale et économique pertinente pour comprendre le changement climatique, ses impacts potentiels et les moyens de s'y adapter et de l'atténuer. Son rôle est d'être exhaustif, objectif, transparent, rigoureux, robuste et non prescriptif.
Je peux en témoigner, aucune phrase du rapport n'a été écrite par un seul auteur : chaque phrase a été rerédigée quatre, cinq ou six fois par des groupes d'auteurs, appuyés par des auteurs contributeurs. Dans notre groupe, il y avait 270 coauteurs du Giec, spécialistes, soutenus par 720 autres scientifiques. Parmi les milliers de pages du rapport, chaque mot est pesé.
Les rapports du Giec s'adressent aux États ; on trouve dans le rapport un résumé aux décideurs qui est relu et approuvé ligne par ligne par les gouvernements. Comme les destinataires sont les États dans leurs négociations internationales, le texte ne contient pas nécessairement l'information très précise sur les territoires ou les départements d'outre-mer français que vous nous demandez dans votre questionnaire. L'objet d'étude est plus large : il s'agit de grandes régions. Vous verrez donc que, dans nos réponses, nous présentons la manière dont les aléas cycloniques, les pluies intenses, l'élévation du niveau de la mer ou les vagues de chaleur évoluent, mais à l'échelle de ces grandes régions. Vous aurez des informations plus précises par Météo France ou l'IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace).
L'objet du groupe II du Giec est d'évaluer les risques du changement climatique.
Le risque, c'est d'abord l'aléa. Vagues de chaleur, ressources en eau, inondations et impacts en cascade des perturbations du cycle de l'eau, de l'élévation du niveau de la mer, des vagues de chaleur : ces aléas s'aggravent à chaque incrément supplémentaire de changement climatique. Par exemple, un degré de réchauffement climatique entraîne 7 % d'eau supplémentaire dans l'atmosphère, qui a tendance à retomber sous forme de pluies intenses.
Mais le rapport du Giec évalue également la vulnérabilité des personnes et des écosystèmes exposés, ainsi que leur exposition. Ces paramètres sont en train de s'aggraver à l'échelle globale – pression croissante sur les terres, expansion urbaine. On estime que 3 à 4 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables, c'est-à-dire où l'accès à l'eau et à l'électricité peut être fortement compromis, ou sans les infrastructures médicales permettant de faire face à des vagues de chaleur massives. Cela concerne évidemment les pays du Sud, mais également les personnes marginalisées dans les pays du Nord et dans les outre-mer. De plus, les alertes concernant la biodiversité sont très fortes : on estime que, sur 8 millions d'espèces, 1 million est en danger d'extinction.
La réponse aux risques peut être l'atténuation du changement climatique, sa limitation aux niveaux les plus bas possible, pour que l'adaptation reste faisable. Mais on observe aussi beaucoup de maladaptation : il s'agit de toutes les mesures qui, guidées ou non par l'intention de réduire les risques, conduisent finalement à les aggraver. Typiquement, face aux vagues de chaleur, la climatisation est une solution d'adaptation, mais elle devient de la maladaptation si elle est massifiée et dépend de moyens de production d'énergie non décarbonés. Se posent enfin les problèmes des limites à l'adaptation et des financements.
Merci de nous donner la possibilité de présenter à nouveau les derniers résultats du Giec, et même d'aller un peu plus loin, car il y a eu depuis beaucoup de recherches scientifiques qui peuvent être utiles dans le cadre de cette audition.
Malgré les efforts d'adaptation et d'atténuation, les impacts du changement climatique concernant les personnes, les écosystèmes et les infrastructures deviennent de plus en plus importants. Le Giec a élaboré différents scénarios, en fonction desquels les conséquences des catastrophes climatiques sont plus ou moins marquées.
Les territoires d'outre-mer sont extrêmement vulnérables. Par exemple, sur l'île d'Ouvéa, où j'ai eu l'occasion de travailler, on peut déjà envisager le déplacement de la population.
Comme l'a dit mon collègue, on observe souvent des formes d'adaptation néfastes que l'on peut qualifier de maladaptations, un concept très important pour le Giec. Par exemple, il ne faut pas construire un mur pour protéger la population de la montée des eaux, un problème qui se pose à Ouvéa et dans toute la région du Pacifique.
Il s'agit aussi d'une question de gestion. J'ai été auteur principal, dans les deux derniers rapports, du chapitre sur la prise de décision. Les deux fois, nous avons opté pour une gestion itérative des risques. C'est un concept très important. Comment décider de la manière de se protéger de catastrophes climatiques dans cinq ans ? Entre-temps, de nombreux éléments peuvent intervenir. Cette gestion itérative des risques relève de l'approche actuelle des systèmes complexes, c'est-à-dire qui fonctionnent en interaction, sans que l'on puisse en isoler des éléments.
Un autre concept très important est celui de nexus. Par exemple, les questions de l'eau, du climat, de l'énergie et de l'alimentation sont liées. Si les littoraux disparaissent, cela va provoquer des problèmes au niveau de la nutrition, de la pêche, etc. Beaucoup d'études essayent de relier les recherches scientifiques concernant la biodiversité, le changement climatique et l'énergie – question primordiale.
En outre, les systèmes sont rétroactifs. On ne peut donc pas prévoir comment ils vont évoluer et on peut même s'attendre à des points de basculement qui remettront en question les décisions traditionnelles. Dans ce contexte, on envisage une adaptation transformative au lieu de petites solutions qui ne mènent nulle part – on voit que les émissions de gaz à effet de serre continuent et, en France, on évoque un plan d'adaptation à 4 degrés Celsius, ce qui signifie que toutes les petites îles des territoires d'outre-mer vont disparaître, que la mer va détruire les terres par la salinisation, comme elle le fait déjà en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. L'adaptation transformative, elle, permet de modifier les systèmes afin de sauver la vie sur terre – car c'est presque de cela qu'il s'agit.
Le Giec préconise aussi des décisions multiacteurs. Il n'est pas suffisant que le gouvernement décide : il faut intégrer à la prise de décision les scientifiques – au moins leur demander d'y contribuer –, mais aussi les populations. C'est très important pour la gestion des risques et des catastrophes naturelles en général.
Dans les territoires d'outre-mer, il y a une population d'origine autochtone ainsi que des communautés locales. C'est désormais presque une obligation d'intégrer leurs connaissances et de les faire participer à la décision. Les Iaai et les Faga vivent sur l'île d'Ouvéa depuis trois mille ans. Tous les efforts sont nécessaires pour faire face à des catastrophes naturelles qui peuvent se renforcer mutuellement.

La constitution de notre commission d'enquête est passée par un vote de l'Assemblée. C'est une procédure spécifique, qui signifie que l'Assemblée dans son ensemble souhaite mettre en avant un problème qui lui semble important.
Le réchauffement climatique en tant que tel, mais aussi les risques naturels qui lui préexistent, soulèvent la question de la préparation des territoires ultramarins : ces territoires sont éloignés de l'Hexagone, ils sont souvent isolés et l'insularité en est une caractéristique permanente, même en Guyane, bordée par une sorte de mer végétale là où elle ne l'est pas par la mer tout court. Cela entraîne des défis d'anticipation des risques et de logistique. Notre République doit-elle compléter son dispositif pour se préparer à d'éventuelles catastrophes naturelles ?
Vous l'avez dit, c'est dans ces territoires que les conséquences du réchauffement peuvent être les plus grandes. Vous avez cité la pluie. Les autres risques naturels s'aggravent-ils, eux aussi ?
Considérez-vous que l'activité humaine actuelle est une cause d'aggravation ? En aménageant le territoire, en le transformant pour l'adapter aux contraintes de la vie humaine, dansons-nous sur un volcan ou bien sommes-nous suffisamment précautionneux ?
Enfin, des pratiques traditionnelles, habituelles, vous paraissent-elles permettre de mieux gérer ces évolutions et d'anticiper des risques ? Devrions-nous nous en inspirer ?
Dans les outre-mer français, on observe une augmentation de l'intensité des cyclones, mais une baisse de leur fréquence. Les vents sont plus forts, donc déclenchent plus facilement le système « Cat nat », mais sont peut-être un peu moins nombreux.
Les submersions marines surviennent par des épisodes de houle australe à La Réunion ou en Polynésie, ou pendant des cyclones, mais aussi selon un nouveau mode : les submersions chroniques à marée haute, en lien avec l'élévation du niveau de la mer. Celui-ci a augmenté de 20 centimètres par rapport à 1900, augmentera encore de 20 centimètres dans les trente ou quarante prochaines années, et l'on sait que l'on dépassera 2 mètres – sans doute bien après 2100, mais cela viendra tôt ou tard. L'étude GuyaClimat a mis en évidence le lien entre un épisode survenu à Cayenne en 2020 et l'élévation du niveau de la mer. Ce n'est pas une catastrophe, mais cela crée des nuisances. Ainsi, à Pointe-à-Pitre, des événements qui ne sont pas tous liés à l'élévation du niveau de la mer, mais qui viennent aussi de problèmes de gestion de l'eau et de questions hydrogéologiques, entraînent une accumulation des eaux usées. Les submersions marines sont une urgence, citée dans le rapport du Giec.
En ce qui concerne les sécheresses, il est difficile de parler spécifiquement de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais le rapport du Giec permet clairement d'attribuer au changement climatique la sécheresse qui a affecté les Caraïbes, notamment à l'Ouest, entre 2013 et 2016.
L'augmentation des précipitations et celle des sécheresses ont la même raison physique : une atmosphère plus chaude demande plus d'eau dans l'atmosphère, donc l'eau disponible augmente la quantité d'eau présente dans l'atmosphère, qui a tendance à retomber sous forme de pluies intenses ; mais quand il n'y a plus d'eau sur les sols, ils s'assèchent plus vite.
Enfin, on oublie toujours, parce qu'ils n'entraînent pas de catastrophes naturelles, le risque que représentent les extrêmes de chaleur, y compris les vagues de chaleur marines, à l'origine de la mortalité de masse des coraux. On estime qu'à 2 degrés de réchauffement climatique, en 2050, on perd 99 % de la couverture corallienne actuelle. Voilà pourquoi on insiste sur 1,5 degré.
S'y ajoute l'acidification des océans, qui se poursuit.
Les extrêmes de chaleur sont un risque pour la santé humaine. La partie réalisée par Météo France de l'étude GuyaClimat alerte : les seuils de température et d'humidité dangereux pour la vie humaine risquent d'être dépassés de plus en plus souvent. Une difficulté est due au fait que la prévision d'une plus forte chaleur va de pair avec celle d'une moindre humidité, ce qui ne permet pas d'apporter une réponse définitive pour la Guyane. Mais quand on regarde une carte globale, on voit que la région Amazonie est vraiment un hot spot s'agissant de ces dépassements.
Les séismes et les volcans ne font pas vraiment partie du sujet. Simplement, si vous avez le malheur de connaître un séisme dans un contexte de sécheresse ou de cyclone, les deux se cumulent. C'est plutôt un problème de vulnérabilité.
L'activité humaine est-elle une cause d'aggravation ? Bien sûr ; d'abord par les émissions de gaz à effet de serre, ensuite par l'occupation des sols. Il est important d'appliquer les réglementations paracycloniques. La loi ZAN (zéro artificialisation nette) va plutôt dans le bon sens pour limiter les pressions sur les terres.
Les cinq causes majeures de l'effondrement actuel des écosystèmes sont la pollution (nitrates, phosphates, pesticides, etc.), la fragmentation et la destruction de l'habitat, le changement climatique, la surexploitation des écosystèmes – par exemple, par la pêche au chalut – et les espèces invasives. Tous ces facteurs sont dus aux hommes ; ce sont eux qui ont introduit les espèces invasives, par exemple. Cela aggrave les pertes de biodiversité et les risques naturels. Or le rapport du Giec et l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) mettent en évidence le fait que nous dépendons très fortement des écosystèmes.
On peut apprendre beaucoup des populations locales, puisqu'elles ont été suffisamment capables de gérer leur milieu et ses ressources pour survivre pendant des milliers d'années. En Guyane française, les populations autochtones essayent de sauver les tortues marines, qui sont en voie de disparition. En Nouvelle-Calédonie, la population kanak se considère comme descendant des plantes et des animaux, avec lesquels elle a une relation très forte. Il existe les tribus de la terre et les tribus de la mer, et, pour celles-ci, leur terre est la mer. Les jeunes participent beaucoup à la replantation des forêts, très vulnérables face aux feux, lesquels sont dus aux tentatives de chasser les espèces invasives introduites par la population européenne – le problème est que tout est lié. Il est très utile d'intégrer les populations autochtones dans les analyses de la situation et l'établissement des objectifs. Cela peut même être un levier pour des décisions couronnées de succès. On parle désormais de coconstruction des connaissances avec ces populations.

Je suis député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, îles surtout connues en France en raison du cyclone Irma, en 2017. Les territoires ultramarins sont géographiquement très dispersés, et les risques naturels auxquels ils sont exposés sont très divers. Une hiérarchisation des risques est-elle possible ? Ou bien tout est-il urgent ? Quel niveau de peur devons-nous avoir ?
Ce n'est pas une question facile !
Le rapport du Giec insiste plutôt sur l'urgence en matière de gestion de l'eau, de sécheresse, de pluies intenses, d'extrêmes de température. La montée du niveau des mers est en revanche progressive.
Chaque phénomène, surtout s'il est très intense, peut en entraîner d'autres, en cascade : des mouvements de terrain, par exemple. Ceux-ci ne sont pas vraiment évalués dans le rapport du Giec. Nous manquons d'informations à leur sujet ; il y a des études à faire. C'est pourtant certainement un sujet important, si l'on pense à la route des mamelles en Guadeloupe, par exemple.
Il est difficile de comprendre le caractère graduel du changement climatique : certains événements sont peu fréquents, mais très destructeurs quand ils surviennent. Vous citiez le cyclone Irma. À l'inverse, les îles Tuamotu n'en ont pas connu depuis 1983 : cela deviendra une question urgente le jour où il arrivera… Sera-t-on prêt ? Il y a eu des efforts pour construire des abris. Je précise que je n'ai aucune information particulière sur le rôle du changement climatique dans la survenue d'Irma. De la même façon, les submersions marines ne posent pas problème jusqu'au jour où il y a une catastrophe, qui coûte des milliards d'euros.
Si je devais tenter d'établir une hiérarchie, je citerai donc les risques clés cités dans le rapport du Giec : vagues de chaleur, sécheresses, pluies intenses, risques pour la biodiversité, risques en cascade qui en découlent. Nous sous-estimons notre dépendance vis-à-vis des écosystèmes et des bénéfices qu'ils nous apportent quant à la qualité de l'eau, à nos moyens de subsistance, au tourisme même : la santé des écosystèmes est une urgence.

Je suis présidente du Comité national du trait de côte, qui rassemble l'ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs pour parler d'un sujet que vous n'avez pas cité : l'érosion côtière. Je regrette que l'adaptation ait pris beaucoup de retard. Vous avez parlé de formes d'adaptation néfastes : pouvez-vous développer, notamment en lien avec l'érosion ?
Sur nos littoraux, nous devons tout réinventer : une nouvelle économie, une nouvelle urbanisation, un nouveau tourisme. Vous avez aussi abordé l'idée d'adaptation transformative. Pouvez-vous aller plus loin ?
Enfin, la culture du risque est-elle suffisamment développée ? Peut-elle permettre une meilleure réactivité des populations ?
Un exemple de maladaptation est cité dans le résumé aux décideurs du rapport du Giec : pour répondre à l'élévation du niveau des mers, on peut être tenté d'artificialiser les côtes, en installant des digues un peu partout. Cela détruirait tous les écosystèmes intertidaux et ne fonctionnerait pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de digues : il y a évidemment des endroits où la protection est indispensable. Mais il faut les construire avec suffisamment de discernement pour préserver les écosystèmes.
La maladaptation ne concerne pas seulement les actions qui visent à réduire les risques ; elle désigne aussi des aménagements peu favorables. Les vagues de chaleur posent ainsi un problème d'urbanisme : il faut favoriser la végétation, réaménager l'espace public de façon à limiter la chaleur urbaine. On ne le fait pas partout aujourd'hui : je pourrais vous citer des villes où la seule préoccupation lorsqu'on réaménage une rue est de dégager davantage de places de parking.
J'ai travaillé quinze ans sur l'érosion, mais je ne l'ai pas citée parce que ce n'est pas un risque clef identifié par le rapport du Giec. Celui-ci met en avant les submersions marines, dont l'impact et le coût sont bien supérieurs. Cela ne veut pas dire qu'elle est négligeable ! Mais l'élévation du niveau de la mer généralisera les problèmes d'érosion vers 2050 et au-delà ; les problèmes de submersions marines, c'est tout de suite.
S'agissant de l'adaptation transformationnelle, les meilleurs exemples concernent le nexus « eau, alimentation, agriculture ». Aujourd'hui, l'agriculture exerce sur les écosystèmes des pressions qui ne sont pas tenables à long terme, par l'utilisation de nitrates, de phosphates et autres pesticides. Elle est également responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc agir sur la demande – c'est souvent de cette façon que l'on arrive à une adaptation transformationnelle ; en l'occurrence, cela veut dire agir sur l'alimentation, notamment sur la consommation de viande.
En ce qui concerne le trait de côte, je n'ai pas d'exemple frappant d'adaptation transformationnelle à vous proposer. Il y a même un débat sur son existence même : dans la littérature scientifique, certains considèrent que, sur les côtes, il n'y a jamais eu que des transformations incrémentales. Pourtant, en Europe, nous avons vraiment transformé nos côtes, en construisant des digues par exemple.
L'adaptation transformationnelle est devant nous ; on en voit les prémices dans la transformation de nos systèmes énergétiques et de nos systèmes d'alimentation : nous essayons de manger de plus en plus de légumes, on crée de la viande artificielle. Les avancées sont déjà bien réelles. Mais ces transformations doivent être conscientes et appuyées par les décideurs. C'est de cette façon que nous provoquerons des changements fondamentaux – on peut l'espérer pour la production d'énergie, par exemple.
Le terme d'adaptation transformative a aussi un autre sens : il désigne aussi le moment où des gens doivent quitter le lieu où ils vivent parce qu'il est devenu inhabitable. Ils vont alors commencer une vie complètement différente.

J'étais ce matin au colloque « Les outre-mer aux avant-postes » organisé par le journal Le Point à l'Institut océanographique. Gérald Darmanin y a parlé de Mayotte, mais aussi d'Ouvéa et de Miquelon – qu'il va falloir déménager.
Sait-on estimer la perte d'autonomie alimentaire d'un territoire provoquée par le changement climatique ? C'est là un des enjeux majeurs pour les économies ultramarines. Quelles sont notamment les répercussions de la salinisation ?
L'une des solutions envisagées pour résoudre la crise de l'eau à Mayotte est la construction de la troisième retenue collinaire. Est-ce, à votre sens, une réponse adaptée aux changements entraînés par le réchauffement climatique ?
La relocalisation du village de Miquelon est souvent citée comme un exemple de transformation pour le littoral, je n'ai étonnamment pas pensé à le dire. Une thèse vient d'être soutenue sur ce sujet, celle de Xenia Philippenko. C'est à ce stade un projet.
Il y a une solution dont nous aurons besoin et qui va se développer, notamment en Méditerranée : celle de la désalinisation. Le Giec lance néanmoins deux alertes à ce sujet. D'une part, que faire des saumures ? Elles risquent d'abîmer les milieux naturels. D'autre part, quelle est la source d'énergie utilisée pour désaliniser l'eau ? Est-elle décarbonée ? Pour que la désalinisation ne soit pas une maladaptation, elle doit être décarbonée et veiller à la préservation des écosystèmes. Les décisions prises dans l'urgence et qui dérogent aux réglementations environnementales ne sont souvent pas les bonnes.
Quant à la retenue collinaire, le Giec ne s'y oppose pas – il n'est, de toute façon, pas prescriptif. Mais il souligne que la quantité d'eau reçue est limitée, et que la création de nouveaux sites de stockage peut aggraver la dépendance à l'eau. Il y aura plus de stockages d'eau, c'est clair, et il faut résoudre la crise à Mayotte. Mais la demande en eau doit être gérée de façon à être soutenable y compris pendant des périodes de sécheresse qui peuvent durer plusieurs années. Une approche globale, qui intègre notamment la demande en eau, est donc indispensable.
J'en viens à la salinisation. Elle a des effets dans les territoires outre-mer : on connaît des intrusions salines dans les aquifères en Polynésie, d'autant plus que l'eau est utilisée comme ressource et pompée ; il existe aussi des exemples en Guadeloupe. Je ne suis pas certain, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, que cela pose déjà des problèmes à des cultures vivrières sur ces sites.
En revanche, il y a de la littérature scientifique sur le fait que les territoires d'outre-mer comme les États insulaires sont dépendants de l'extérieur – je vous renvoie au chapitre 15 du sixième rapport du Giec. Pour demeurer habitables, ces sites doivent rester connectés à l'extérieur. Le Giec examine cinq scénarios socio-économiques : deux compromettent potentiellement ce type d'échanges : les SSP3 et SSP4 (Shared Socio-Economic Pathways), où l'on constate notamment une augmentation des inégalités entre régions. Dans les SSP1 et SSP5, il continue d'y avoir beaucoup d'échanges internationaux ; la question est celle de leur réalisme. Beaucoup de gens contestent ces scénarios, les considèrent comme virtuels et estiment qu'il faudrait estimer de façon claire la trajectoire de la sobriété. En ignorant cette question, on crée un besoin en capture atmosphérique du CO2 qui est dément dès les années 2030 ou 2040. Au vu de la faiblesse de l'action en faveur de l'atténuation du changement climatique, il faudrait certainement se pencher sur d'autres scénarios, y compris certains où les échanges internationaux seraient fortement compromis – ce qui pourrait poser problème à ces territoires.

À Mayotte, nous avons assisté à la naissance d'un volcan, qui a provoqué une subsidence importante. Quels sont les risques ?
Il y a une équipe de géodésistes qui s'intéresse à ces mouvements. C'est très clair : la partie Ouest de l'île a connu un affaissement de 20 centimètres en deux ans, la partie Est étant moins touchée. En l'espace de deux ans, il s'est ainsi passé à Mayotte ce qui va se passer dans tous les autres territoires d'outre-mer dans les trente prochaines années : une élévation du niveau marin de 20 centimètres.
Je ne connais pas ce terrain de façon précise mais les leçons qui seront tirées de ces événements seront très intéressantes, notamment quant à l'accessibilité des infrastructures – routes, aéroports, etc.

Le rapport du Giec fait-il apparaître des écarts de préparation entre les territoires ? Je suppose que oui. Quelles en seront les conséquences ? On parle de déménagements de villes, de cultures inondées. Cela signifie aussi qu'il y aura des mouvements de population. S'ils sont mal préparés, brusques, ils pourraient affecter même les territoires les mieux préparés.
Il existe, malheureusement pas partout, des services climatiques à même de lancer des alertes précoces en cas de catastrophe. Les situations des territoires d'outre-mer à cet égard sont diverses. Les services météorologiques y sont moins développés et nous disposons de peu d'informations sur leur climat passé. Il est donc difficile d'établir des comparaisons. De plus, les chiffres dont nous disposons sont souvent à une échelle globale, trop importante pour identifier des problèmes locaux. On l'a vu en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Il existe donc de grandes inégalités de préparation vis-à-vis de futures catastrophes.
Le rapport du Giec lance une alerte : on observe déjà des retards dans l'adaptation. Les États le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes. La planification commence, mais l'action tarde.
Cette impréparation entraînera des morts, des pertes économiques, voire pire. La quantification exacte est difficile. On peut dire, par exemple, que 1,7 milliard de personnes dans le monde seront exposées à des températures létales en 2050. Le nombre de morts est bien plus incertain, car tout dépendra de l'adaptation.
Certaines régions peuvent devenir presque inhabitables, ce qui déclenche des mouvements de population. Le rapport du Giec insiste sur le fait que les migrations se font le plus souvent à l'intérieur d'une même région, ou entre pays d'une même région. Les mouvements internationaux sont fortement contraints par les politiques des États. Il souligne aussi que la pire forme de maladaptation, ce sont les déplacements involontaires, forcés, par exemple sous l'effet d'une catastrophe. Le rapport comporte toute une section consacrée aux conflits : le réchauffement climatique favorise les conflits armés, en augmentant les tensions, mais entraîne surtout des conflits sociaux, pas forcément violents. On peut le voir à propos de la gestion de l'eau : tant que celle-ci se concentrera essentiellement sur l'offre, et qu'il n'y aura pas davantage de concertation à propos de la demande, on favorisera les conflits. C'est d'autant plus vrai que la motivation des gens qui s'opposent à une adaptation très orientée vers l'offre, vers la technologie, c'est la faiblesse de l'action des gouvernements en faveur du climat. Je vous renvoie au chapitre 18 du rapport du Giec, qui prévoit une augmentation de ces conflits.

À La Réunion, nous venons d'être touchés par un cyclone. Ceux-ci sont moins fréquents ces dernières années, mais les pluies sont très intenses, même si cela n'a pas été le cas cette fois-ci. Depuis une dizaine de jours, nous constatons une accentuation des pluies, due au phénomène El Niño, notamment dans la partie Ouest de l'île.
Vous avez évoqué le rôle central de la biodiversité. Nous connaissons une invasion d'espèces exotiques, qui détruisent notre biodiversité : est-il encore possible de retourner la situation ?
Il est de plus en plus souvent question de la canicule marine, qui affecte la biodiversité marine. Le Giec s'est-il penché sur ce sujet ?
Comment notre île peut-elle participer à la lutte contre le changement climatique ?
Les phénomènes météorologiques que vous évoquez constituent un risque pour la santé, voire pour la vie. Le rapport du Giec a identifié environ 350 risques de base, regroupés en douze grandes catégories, dont la santé. L'augmentation des températures provoque en effet une augmentation de la mortalité ; l'élévation du niveau de la mer entraîne des déplacements de population. Il faut donc s'intéresser à l'adaptation pour faire face à ces risques, de famine, de guerre pour l'eau, etc.
En ce qui concerne les canicules marines, le rapport du Giec porte surtout sur le phénomène El Niño de 2016, qui a concerné la région qui va des Maldives à l'Ouest du Pacifique, ainsi que sur la Méditerranée. Je n'ai pas en tête d'éléments concernant l'océan Indien. Les conséquences des canicules marines sont partout les mêmes : au-delà d'une température de 31 degrés, les coraux disparaissent, par exemple.
S'agissant des invasions d'espèces exotiques et des maladies, il y a une alerte notamment à propos de la dengue. Cela ne concerne d'ailleurs pas les seuls outre-mer, puisque ceux-ci sont bien connectés à la métropole. Les maladies peuvent donc se propager jusqu'en Europe.
Que peut faire La Réunion ? Dès lors qu'il faut atteindre un niveau de zéro émission nette, c'est-à-dire ne pas émettre plus de CO2 que ce que peuvent absorber les écosystèmes et les technologies que nous installerons, tout le monde est concerné : le fait d'être petit à l'échelle du monde n'autorise pas l'inaction. Dans les territoires ultramarins, les enjeux sont complexes et souvent différents de ceux de la métropole, par exemple pour la production d'électricité. Mais en démontrant que l'on est capable d'agir sur un territoire insulaire, on enverrait un message positif à tout le monde. Tous les efforts sont donc positifs.
S'agissant des risques que comportent les interactions entre les régions, et donc des risques de propagation de catastrophes d'une région à l'autre, il y a quatre vecteurs : on vient d'évoquer la transmission humaine, la maladie ; on a évoqué aussi la sécurité alimentaire ; il y a enfin les risques financiers et assurantiels. Nos collègues du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (Cired) travaillent sur ces questions, qui sont source d'inquiétudes : il n'y a pas de projections précises, mais on sait que des submersions marines aggravées par l'élévation du niveau de la mer dans la deuxième partie du XXIe siècle peuvent créer des chocs systémiques aussi sur le système financier.

À l'échelle du changement climatique, les hommes ont la mémoire courte. Et quel que soit le savoir que l'on acquiert, c'est surtout l'expérience qui donne la connaissance profonde des phénomènes. Un jeune qui n'a jamais vu un cyclone a souvent presque envie d'en voir un ; ceux qui l'ont vu une fois prient pour ne pas en voir un autre.
Comment maintenir dans la mémoire vive des populations les dangers que vous nous exposez ? Comment cultiver la culture du risque ? Est-ce le rôle de l'école, des gouvernements, des scientifiques, des médias ?
Jusqu'à présent, nous avons parlé de politiques à mener ; voici une question qui concerne l'individu. Vous avez raison, nos études montrent que les individus ont la mémoire courte pour ce qui est du climat. Nous avons ainsi pu constater que la canicule de 2003 à Paris, qui a entraîné de nombreux décès, avait été vite oubliée. L'hiver, les gens sont moins inquiets du réchauffement climatique et en oublient la réalité et le danger.
L'expérience est importante ; à Paris, on se sent bien mieux protégé qu'à Ouvéa.
La communication est donc essentielle, comme l'éducation dès le plus jeune âge. Il est essentiel de préparer la jeunesse.
L'audition se termine à quinze heures cinq.
La commission procède à l'audition de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) : M. Philippe Charvis, directeur délégué à la science et M. Frédéric Ménard, conseiller scientifique Outre-mer.
L'audition commence à quinze heures dix.

Nous accueillons en visioconférence deux représentants de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), dont le siège est à Marseille.
Établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), l'IRD est placé sous la double tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de celui chargé des affaires étrangères. Son site internet indique qu'il se situe à l'avant-garde de « la science de la durabilité », puisque ses recherches trouvent d'abord leur source dans la confrontation aux problèmes du monde réel, des écosystèmes et des sociétés. Cette commission d'enquête s'intéresse plus particulièrement aux vulnérabilités écologiques et aux risques naturels.
Cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande.
Messieurs, avant de vous laisser la parole pour une intervention liminaire, je vous invite à vous conformer à la prescription de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, selon laquelle les personnes auditionnées par une commission d'enquête doivent prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Philippe Charvis et M. Frédéric Ménard prêtent successivement serment.)
L'IRD, qui a 80 ans cette année, a développé un modèle original de partenariat scientifique, basé sur l'équité. Nous travaillons principalement dans les zones méditerranéenne et intertropicale, comprenant l'outre-mer. L'IRD compte 2 260 agents, répartis dans quatre-vingts unités mixtes de recherche avec des universités françaises, y compris en outre-mer, et d'autres organismes, au premier rang desquels le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; il est également présent dans une cinquantaine de pays du Sud.
Cet organisme développe des recherches interdisciplinaires, avec une approche en science de la durabilité, sur des sujets très variés : comprendre les changements globaux, limiter les risques pour les populations, préserver la biodiversité des écosystèmes tropicaux, gérer les ressources, améliorer la santé des populations, comprendre la dynamique des sociétés.
Je suis le conseiller scientifique pour l'outre-mer auprès de la PDG de l'IRD, Valérie Verdier. L'IRD présente la particularité d'être implanté dans les outre-mer de la zone intertropicale des trois océans. Il existe, depuis plus de soixante-dix ans, des chantiers scientifiques en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Le fort ancrage de l'Institut dans les territoires d'outre-mer se déploie autour de quatre représentations : en Nouvelle-Calédonie, avec compétence sur Wallis-et-Futuna ; en Polynésie française ; à La Réunion, avec compétence sur Mayotte et sur les îles Éparses ; en Guyane française. Environ 200 agents sont affectés dans les territoires d'outre-mer, certains étant mieux lotis que d'autres.
Les territoires d'outre-mer concentrent des enjeux planétaires et des grands défis sociétaux. Ils contribuent très peu aux causes, mais sont fortement vulnérables aux conséquences du changement climatique et aux risques naturels. L'IRD ambitionne d'être un acteur majeur de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les outre-mer. Par la recherche et par le renforcement des capacités, il entend contribuer au développement des sociétés de ces territoires. Il souhaite travailler à la résilience territoriale, en coconstruisant, avec les acteurs locaux, un projet qui réponde aux enjeux liés aux changements planétaires, y compris les risques climatiques et environnementaux.

Souhaitez-vous tenir un propos introductif général avant que nous ne vous posions des questions ?
Le questionnaire que vous nous avez soumis couvre tout à fait les points majeurs de la problématique des risques naturels dans les outre-mer français, qui présente un certain nombre de particularités, parmi lesquelles la vulnérabilité des populations.

Lorsque vous avez évoqué les différentes structures de l'IRD en outre-mer, vous n'avez pas mentionné les Antilles.
Tout à fait. Historiquement, l'IRD a mené des activités scientifiques aux Antilles, mais y est actuellement très peu présent et n'y a pas de représentation. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'activité sur ces territoires – nous travaillons d'ailleurs beaucoup sur les sargasses. Une réflexion est en cours, et nous nous rendrons aux Antilles prochainement, afin d'en discuter avec d'autres organismes nationaux de recherche, comme le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

Votre connaissance des conséquences potentielles des risques associés aux risques naturels est précieuse. Considérez-vous que nos territoires ultramarins sont bien préparés à ces conséquences ? Qu'en est-il de ceux qui les jouxtent ? Il y a probablement des différences entre eux. Sur une zone géographique plus large que notre territoire, comment seraient gérées les conséquences d'un désordre majeur, en termes de mouvements de population, de solidarité, d'intervention des acteurs publics ?
Cette question appelle des réponses différentes selon les aléas et les territoires considérés. De multiples risques sont susceptibles de toucher nos territoires d'outre-mer : le risque sismique peut concerner les Antilles, mais aussi La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie ; le risque volcanique peut menacer La Réunion ou les Antilles ; le risque de tsunami est plus particulièrement susceptible d'atteindre les territoires dans le Pacifique, mais aussi aux Antilles.
Les niveaux de réponse sont donc différents, avec un certain nombre de dispositifs spécifiques. Des observatoires volcanologiques, coordonnés par l'Institut de physique du Globe de Paris (IPGP), sont installés à La Réunion et aux Antilles pour répondre aux phénomènes volcaniques. Le risque sismique se présente différemment aux Antilles, où c'est également l'IPGP qui gère, et dans le Pacifique, où l'IRD est davantage présent, avec des risques associés de tsunami principalement en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Loyauté. Un réseau d'observation est déployé au niveau local, sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, et au niveau régional, à l'échelle du Pacifique, mais ce dispositif demeure insuffisant. En Nouvelle-Calédonie, faute d'une cartographie suffisante des risques comportant un zonage sismique et des données topographiques, il est difficile de cartographier le risque de tsunami et d'avoir une idée plus précise des hauteurs des vagues potentielles. On ne peut pas non plus appliquer de manière fiable les règles de construction parasismiques européennes. Une telle cartographie serait par ailleurs utile pour prévoir des chemins d'évacuation, des zones refuges en cas de tsunami. Si l'IRD est associé aux services territoriaux du risque, il ne dispose pas des mêmes équipements ou ressources humaines que d'autres organismes, comme Météo France, lui permettant de déployer des activités de surveillance et d'alerte.
Les territoires sont-ils prêts ? Oui et non. Oui, si l'on considère l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, par exemple lors du cyclone Belal. Elles ont permis d'éviter une mortalité importante – il y a eu un décès –, mais pas de réduire les problèmes de destruction. Non, parce que nous sommes le plus souvent dans une posture de réaction, au lieu d'adopter une stratégie d'adaptation pour prévenir les risques. Or, la science l'indique clairement, les risques naturels vont augmenter en intensité.
La mise en place d'une politique d'adaptation revêt un caractère urgent, notamment pour les zones littorales. La plupart des territoires outre-mer sont insulaires, hormis la Guyane, que son littoral expose néanmoins à des aléas extrêmement dangereux. Comment aménager ces territoires pour tenir compte des vulnérabilités ? Comment restaurer les milieux naturels, qui, tels les mangroves et les récifs coralliens, jouent souvent un rôle de tampon contre les aléas climatiques ? Des écosystèmes en bonne santé sont des garants dans la lutte contre les aléas climatiques, la science nous le dit aussi.
Elle travaille également beaucoup sur les moyens de développer et d'implémenter des solutions basées sur la nature. Grâce à un PEPR (programme et équipement prioritaire de recherche), piloté notamment par le CNRS et appelé SOLU-BIOD, nous disposons d'un outil important pour mettre en valeur de telles solutions afin de rendre nos territoires plus résilients – par exemple, en traitant la déforestation.
Enfin, nos territoires d'outre-mer s'inscrivent dans des bassins, qu'ils constituent avec d'autres pays ; lorsqu'ils subissent des événements, ceux-ci sont régionaux. Ainsi, le cyclone Belal a également touché l'île Maurice où il a fait bien plus de dégâts qu'à La Réunion. On voit là tout l'intérêt qu'il y aurait à ce que l'IRD construise des partenariats régionaux dans les bassins de nos territoires d'outre-mer de façon à organiser la solidarité. Bien souvent, en effet, nos territoires sont les plus riches de leur zone, chacune présentant des niveaux de développement différents.

Quel retour d'expérience faites-vous sur des événements tels que Belal ou, précédemment, Irma, à la fois sur nos territoires et leur voisinage ?
Le domaine de l'IRD est vraiment celui de la recherche, en coopération, en renforcement de capacités, pas celui de l'alerte comme peut le faire Météo France, qui dispose d'un service vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En revanche, du fait que l'activité de recherche s'effectue en amont, elle permet de fournir des connaissances, des données, des indicateurs et de l'expertise, à des fins d'interprétation. L'enjeu, pour l'IRD, c'est de mieux articuler les informations issues de la recherche afin d'éclairer le décideur et de lui donner les éléments nécessaires à une prise de décision, à un moment tendu mais aussi en amont, pour développer des stratégies d'adaptation permettant de ne pas être en position de réaction, de façon à réduire la dangerosité d'aléas dont l'intensité va croissant.
Il y a deux types de retours d'expérience. D'un point de vue strictement scientifique, nous travaillons à des modélisations numériques par lesquelles nous essayons d'anticiper les phénomènes. Par exemple, s'agissant des cyclones, les données nouvelles enregistrées lors d'un épisode cyclonique servent ensuite à améliorer les modèles. Du point de vue de la gestion de crise, qui est plutôt du ressort des services spécialisés, l'IRD n'est pas en première ligne, mais peut participer aux retours d'expérience. L'exemple récent du cyclone Belal est à cet égard assez emblématique. Même si Météo France, localement en charge de l'observation et de la prévision, a transmis les informations aussi bien à Maurice qu'à La Réunion, les dégâts ont été beaucoup plus importants à Maurice en raison d'un système d'alerte opérationnel très différent. À La Réunion, l'alerte violette, excluant toute sortie, y compris celle des secours, s'est révélée beaucoup plus efficace. Ce retour d'expérience a donc mis en évidence l'importance de la dimension opérationnelle pour limiter les dégâts et les décès.

À l'exception de la journée d'hier, depuis une dizaine de jours, il pleut tous les jours à La Réunion. Ces pluies diluviennes causent davantage de dégâts que le cyclone Belal, et je m'inquiète car le soleil n'est pas annoncé.
J'aimerais connaître le degré d'implication de l'IRD dans les projets des collectivités locales ultramarines. Jouez-vous un rôle de conseil ? Est-il susceptible d'être renforcé ? Les projets ne semblent pas toujours accorder suffisamment d'attention au changement climatique ou à la destruction de la biodiversité. Plutôt que de parler de reconstruction de la biodiversité, mieux vaudrait s'attacher à maintenir ce que nous avons en l'état. Quel est votre point de vue sur ces questions ? L'IRD a-t-il la possibilité, voire l'habitude, d'intervenir ?
L'IRD est un institut de recherche, qui tente de mieux comprendre les processus physiques des aléas naturels, afin de mieux prédire ceux-ci. Les modèles mécanistes visent à améliorer les prévisions, sachant qu'il est impossible d'éliminer toute incertitude. Il existe encore de nombreux verrous, dont la levée exige de donner du temps au travail scientifique ; celui-ci sera d'autant plus efficace qu'il pourra étudier des cas nombreux et variés.
Il importe de pouvoir éclairer les décideurs des politiques publiques locales. Pour ce faire, il convient de renforcer les capacités des services des collectivités territoriales et de l'État en recrutant des scientifiques qui feront le lien avec des équipes de recherche du CNRS, du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et de l'IRD pour travailler sur des projets. Il manque en effet, entre la science et les pouvoirs publics, un maillon de « digestion » de l'information scientifique, ce qui réduit la portée de cette dernière pour les pouvoirs publics et les responsables opérationnels.
L'IRD négocie actuellement avec la région La Réunion un contrat pluriannuel d'objectifs, de moyens et de performance ; nous avons récemment accueilli un élu pour échanger avec lui. Nous nous inscrivons dans une démarche de construction avec la région et notre premier partenaire, l'université, afin de concevoir des programmes répondant aux priorités définies par ces deux acteurs – les sujets ne concernent d'ailleurs pas seulement les risques et touchent, par exemple, aux questions relatives à la santé.
Comme l'a dit Frédéric Ménard, il existe un problème de compétences et de ressources humaines à différents niveaux. Nous employons en permanence des scientifiques dans ces régions. Grâce au dispositif des chaires de professeur junior (CPJ), octroyées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous allons recruter cette année des scientifiques d'un certain niveau – l'un d'entre eux sera titularisé dans un poste de directeur de recherche à l'IRD. Des postes sont ouverts cette année en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, puis à La Réunion, probablement en 2025. Nous souhaitons renforcer les compétences locales, car certains sujets ne peuvent pas se traiter depuis la métropole ; le développement des compétences locales – outre-mer et dans les pays du Sud avec lesquels nous avons signé un partenariat – fait partie de l'éthique de l'IRD.

Votre organisation suppose un haut niveau de coopération avec d'autres institutions scientifiques et universitaires, situées dans les territoires ultramarins français. Un séisme volcanique dans l'île de Montserrat affectera obligatoirement les îles Antigua, Saint-Christophe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de la Guadeloupe. Quelle coopération entretenez-vous avec les universités des Caraïbes ? Porto Rico, possession américaine, possède une université, tout comme la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, deux pays indépendants ; le National Hurricane Center (NHC) de Miami étudie la prévision cyclonique pour toute la zone caribéenne : avez-vous des relations avec ces opérateurs scientifiques ? Si tel n'est pas le cas, envisagez-vous d'en nouer ?
L'IRD n'est pas l'opérateur principal aux Antilles, mais j'ai travaillé, en tant que sismologue, en Martinique. L'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique et celui de Guadeloupe – dont la mission est la surveillance de l'activité sismique et volcanique dans ces deux îles – sont en lien avec tous les observatoires de la région, et l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP) et le CNRS sont plus particulièrement chargés de la coordination avec les acteurs étrangers. La coopération existe donc de façon relativement aboutie, même si des progrès sont possibles.
L'IRD est davantage présent dans le Pacifique où il fait partie d'un réseau international de surveillance des tsunamis : des bouées peuvent détecter ces phénomènes au large des côtes et lancer des alertes – un à deux avertissements sont émis chaque année. La zone du Pacifique est gigantesque et nos moyens sont limités. Il y a lieu de développer des coopérations avec des partenaires en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais également avec les autres pays de la région comme le Vanuatu.
En Nouvelle-Calédonie, l'IRD a lancé avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) un projet de recherche destiné à utiliser la fibre optique des câbles de télécommunication sous-marins pour mesurer différentes choses grâce à des capteurs connectés, par exemple la température de l'eau, ou détecter les tremblements de terre et les tsunamis simplement par la fibre elle-même. Il s'agit d'un projet très intéressant en cours de développement, qui porte notamment sur un câble de télécommunication reliant les îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie au Vanuatu et dont le financement est assuré en grande partie par France 2030.

Les actions de l'IRD dépendent des besoins des territoires ultramarins, mais ces derniers et le Gouvernement fixent-ils à l'Institut des objectifs ? Comment choisissez-vous les actions que vous menez ? Les universités et les collectivités territoriales participent-elles à la définition de vos missions de recherche ?
L'IRD a établi une feuille de route pour l'outre-mer, qui définit nos priorités : le nombre de sujets scientifiques que nous pourrions traiter excédant largement nos moyens, notamment humains, nous effectuons des choix en interne.
Il manque sans doute une coordination entre les différents organismes : l'IRD, le CNRS et le Cirad ont en effet chacun une feuille de route pour l'outre-mer, dont l'élaboration n'a pas été précédée de concertation. En revanche, une réunion se tiendra dans les prochaines semaines au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à laquelle tous les organismes de recherche participeront – Mme Valérie Verdier, notre présidente-directrice générale, y représentera l'IRD. Cette rencontre, qui aura pour thème les outre-mer, donnera lieu à une présentation croisée des différentes feuilles de route, ce qui constituera une sorte de concertation a posteriori. Localement, des interactions très étroites existent entre nos différentes institutions.
La stratégie de l'IRD outre-mer repose sur trois axes. Le premier consiste à décliner la science de la durabilité, laquelle a pour vocation de répondre aux thématiques sociétales des territoires. L'objectif est de coconstruire avec les acteurs locaux des projets de recherche qui répondent aux enjeux locaux. En Nouvelle-Calédonie, nous développons un projet ambitieux, Climat du Pacifique, savoirs locaux et stratégies d'adaptation (Clipssa), financé par l'Agence française de développement (AFD) : Météo France et l'IRD sont, aux côtés d'autres organismes nationaux, les plus investis dans ce programme, dont l'objet est d'améliorer nos outils de prédiction de l'aléa climatique et de déployer des stratégies d'adaptation tenant compte des spécificités des territoires, celles-ci pouvant intégrer les savoirs locaux et traditionnels.
Le deuxième axe cherche à renforcer la politique de site, c'est-à-dire à répondre, avec les acteurs locaux de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR), aux demandes des territoires. Outre-mer, les acteurs pivots de cette politique sont les universités, qui se trouvent elles-mêmes en lien avec les collectivités territoriales, dont la diversité est forte. Comme l'a indiqué Philippe Charvis, nous négocions actuellement un contrat pluriannuel d'objectifs, de moyens et de performance avec La Réunion : cette région ne nous soutient pas dans tous nos projets, elle se concentre sur les programmes liés à ses priorités : si certaines de nos actions entrent dans ce cadre, elle flèche des financements européens sur les projets concernés. Nous essayons de bâtir un tel dialogue de coconstruction dans chacun des territoires.
Troisième axe, les représentantes et les représentants de l'IRD dans les territoires d'outre-mer sont les porte-parole de notre présidente-directrice générale ; ils se trouvent au cœur de toutes les discussions comportant un aspect scientifique, donc en lien avec les collectivités territoriales et les universités. En tant que conseiller scientifique pour l'outre-mer, j'ai bien entendu des interactions avec eux.
Enfin, l'IRD est un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), dont les agents sont des fonctionnaires qui ne peuvent pas être contraints de partir outre-mer ou à l'étranger par la direction de l'Institut. Nous cherchons donc à assurer l'attractivité des outils pour inciter nos agents à travailler là où cela nous paraît utile, mais nous ne pouvons pas imposer à un agent de partir le mois prochain étudier l'aléa sismique aux Antilles.
Dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs, de moyens et de performance entre l'IRD et l'État, nous avons prévu des moyens financiers, certes modestes, pour des programmes prioritaires, comme l'étude du risque sismique en Nouvelle-Calédonie ; ces projets prévoient des affectations dans le territoire concerné. Ce système incitatif, qui existe depuis deux ans, vise à donner la priorité à certains travaux qui nous semblent importants.
L'un des meilleurs moyens d'attirer des chercheurs est de leur proposer des financements pour mener leurs recherches. Plus nous sommes capables de coconstruire des projets financés, plus les chercheurs sont enclins à nous rejoindre, d'autant que les enjeux ultramarins sont importants et passionnants.

Quels sont les principaux risques naturels outre-mer ? Vous avez affirmé que les moyens dont vous disposiez étaient inférieurs à vos besoins : à combien évaluez-vous les moyens nécessaires à l'accompagnement des programmes de recherche et à l'accomplissement de votre mission ? Enfin, de quelle nature doivent être les stratégies d'adaptation destinées à mieux appréhender les risques voire à les prévenir ?
Des événements telluriques – séismes, manifestations volcaniques, tsunamis associés – sont susceptibles de toucher La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. L'activité volcanique peut avoir un impact sur des territoires français même si les volcans ne s'y situent pas ; il y a quelques années, une éruption volcanique remarquable s'est produite au Tonga : bien que ce pays soit situé à plusieurs milliers de kilomètres de la Nouvelle-Calédonie, cette dernière a été affectée par l'événement. Les Antilles sont évidemment exposées à l'aléa volcanique et sismique, mais également au risque de tsunamis.
Nous avons besoin d'observatoires, d'outils de modélisation, de sciences humaines et sociales, de programmes interdisciplinaires. Les observatoires permettent d'effectuer des suivis à long terme, donc de surveiller, de mieux comprendre et d'étudier les processus physiques ; fondamentaux, il importe de les renforcer et de les pérenniser.
Il est de plus en plus nécessaire d'effectuer des descentes d'échelle des modèles climatiques et d'augmenter leur résolution afin qu'ils traitent à la fois du terrestre et du marin, puisque les territoires d'outre-mer sont extrêmement soumis à l'aléa marin. L'objectif est de réaliser des simulations climatiques et atmosphériques à haute résolution, c'est-à-dire à l'échelle des zones économiques exclusives (ZEE).
Enfin, l'analyse des vulnérabilités et la mobilisation des savoirs locaux constituent des aspects des sciences humaines et sociales qui nous sont utiles pour la coconstruction de projets interdisciplinaires.
Il est nécessaire de maintenir les côtes naturelles, en particulier les mangroves et les récifs qui protègent les côtes et dont la dégradation peut se révéler très néfaste.
La température moyenne de l'océan global est très élevée en ce début d'année : les vagues de chaleur marine emportent de nombreuses conséquences sur la biodiversité et sur le rôle joué par l'océan de pompe à carbone – l'océan étant le puits de carbone le plus important à la surface du globe, le dérèglement de cette fonction aurait un fort effet délétère. Les vagues de chaleur marine auront des impacts sur nos territoires.
Le changement du régime des pluies, que Mme Bassire a évoqué, peut entraîner des inondations et des glissements de terrain, risques hydrologiques qu'il convient de surveiller. En outre, certains territoires connaissent un problème de ressource en eau ; les aspects de gestion et de qualité de l'eau ne sont pas à proprement parler des risques naturels, mais le changement climatique affecte le niveau des nappes phréatiques, donc les ressources en eau. Ces problèmes, qui peuvent être localement aigus, rendent nécessaires des évolutions de certaines pratiques, notamment dans le domaine agricole.

Je vous remercie, messieurs, de votre disponibilité et des échanges très riches que nous venons d'avoir. Nous aurions aimé vous écouter davantage, mais d'autres auditions nous attendent. Si vous le jugez utile, vous pouvez nous transmettre une synthèse écrite de vos réponses au questionnaire que M. le rapporteur vous a adressé.
J'allais vous le proposer. Nous vous transmettrons volontiers un texte synthétisant nos propos. Nous avons été très heureux et très honorés de votre invitation, et nous nous tenons à la disposition de la commission d'enquête. Peut-être aurons-nous l'occasion de rencontrer certains d'entre vous dans les territoires d'outre-mer à l'occasion de nos visites régulières.
L'audition s'achève à seize heures cinq.
La commission procède à l'audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Christophe Komorowski, responsable scientifique des Observatoires volcanologiques et sismologiques, et responsable du Service national d'observation en volcanologie (CNRS-INSU), Mme Anne le Friant, directrice adjointe en charge des observatoires, M. Arnaud Lemarchand, directeur adjoint en charge de l'instrumentation et Mme Jordane Corbeau, directrice adjointe, Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP), Université Paris.
L'audition débute à seize heures quinze.

L'IPGP est chargé de la surveillance des quatre volcans actifs français situés outre-mer, ainsi que de leur sismicité régionale et des risques potentiels associés de formation de tsunamis, à travers ses observatoires volcanologiques et sismologiques. Nous sommes donc là au cœur de l'un des risques naturels majeurs que vise notre commission d'enquête. La présence d'un volcan sous-marin au large de Mayotte, mon territoire d'élection, me rend particulièrement sensible à vos activités.
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous donner la parole pour les interventions liminaires qui précéderont nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Christophe Komorowski, Mme Anne Le Friant, Mme Jordane Corbeau et M. Arnaud Lemarchand prêtent successivement serment.)
L'IPGP remplit trois missions : la recherche, l'enseignement et l'observation. Acteur principal de l'observation des risques telluriques en France, il gère plusieurs observatoires en lien étroit avec l'Institut national des sciences de l'univers (Insu) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Dans les outre-mer, l'IPGP gère les trois observatoires volcanologiques et sismologiques, situés en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Il gère également l'Observatoire de l'eau et de l'érosion aux Antilles (Obsera).
Ces quatre observatoires jouent un rôle clef pour étudier, surveiller et détecter les risques telluriques, notamment le volcanisme ou la sismicité dans les outre-mer. Ils ne peuvent fonctionner au mieux que s'ils sont étroitement associés aux travaux de recherche scientifique ainsi qu'au développement des instruments de pointe. L'IPGP est d'ailleurs très bien placé dans les classements internationaux en ce qui concerne le développement d'instruments de pointe dans les sciences de la terre : il occupe la première place en France, la troisième au niveau européen et la dixième dans le classement de Shanghai. Grâce à cette recherche scientifique de haut niveau, il est possible de toujours disposer des dernières avancées scientifiques et instrumentales pour la surveillance opérationnelle des phénomènes telluriques dangereux. L'observation est adossée à la recherche dont elle est indissociable.
Aux quatre observatoires précités s'ajoute une structure nationale hébergée à l'IPGP : le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (Revosima), dédié à la surveillance du quatrième site volcanique actif français en outre-mer, et géré par l'IPGP en partenariat avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le CNRS et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). Ce réseau a été créé grâce au travail interministériel de la délégation interministérielle aux risques majeurs outre-mer (Dirmom) à laquelle a succédé la Mission d'appui aux politiques publiques de prévention des risques naturels majeurs outre-mer (Mappprom). Nous avons pu nous rendre compte à quel point ce travail interministériel était indispensable pour gérer des risques naturels.
Pour conclure cette présentation des missions de l'IPGP, je tiens à insister une nouvelle fois sur un point : l'observation ne peut être efficace qu'en étroite connexion avec la recherche et les développements techniques. Nous accueillons d'ailleurs des chercheurs du Conseil national des astronomes et physiciens (Cnap), un corps dont les missions se répartissent entre recherche scientifique, services d'observation et enseignement. C'est essentiel pour maintenir ce lien et progresser dans l'observation.
Pour ma part, je vais vous donner un aperçu des moyens dont disposent les observatoires sur les plans financier et humain, ainsi qu'en matière d'infrastructures.
Le budget hors salaires s'élève à 1,9 ou 2 millions d'euros par an, constitué à 38 % de fonds récurrents et à 68 % du produit d'appels d'offres compétitifs, nationaux et européens, que nous avons remportés. Nous recevons des financements de la part du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du Fonds européen de développement régional (Feder) et des collectivités territoriales – à hauteur de 150 000 à180 000 euros par an. Les observatoires de Guadeloupe et de Martinique occupent des bâtiments construits par les collectivités territoriales avec l'aide du Feder et de l'État. Celui de Martinique, où travaille notre collègue Jordane Corbeau et qui est sans doute le plus beau du monde, a coûté 9 millions d'euros. La Guadeloupe va bientôt consacrer 1 million à l'extension de son observatoire. Le ministère de l'intérieur et des outre-mer nous accorde une subvention de fonctionnement équivalant à une douzaine d'heures d'hélicoptère de la sécurité civile aux Antilles et à La Réunion. Nous pouvons ainsi bénéficier, en début et en fin d'éruption, de deux heures d'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie. Ce n'est pas automatique : nous devons en faire la demande. Quant au Revosima, qui n'est pas inclus dans le budget susmentionné, il a coûté 17 millions d'euros en sept ans, soit quelque 2,4 millions par an.
Ce budget comporte deux points névralgiques. Le premier est évidemment la part importante qui n'est pas sanctuarisée mais dépend de notre réussite en matière d'appels à projets nationaux, européens et internationaux, ce qui demande beaucoup d'énergie et ne garantit pas une somme identique chaque année. Or les activités d'observation et de surveillance nécessitent un financement récurrent et stable sur plusieurs années. Le deuxième est lié à la nécessité de créer trois postes fonctionnels pour les directeurs ou directrices d'observatoires volcanologiques en outre-mer, afin que l'IPGP puisse recruter rapidement ces personnels en cas de mobilité.
En ce qui concerne les volcans, la France se trouve dans une situation inédite depuis plusieurs siècles avec la réactivation à différents niveaux de quatre zones volcaniques : le Piton de la Fournaise à La Réunion ; la montagne Pelée en Martinique ; la Soufrière en Guadeloupe ; le nouveau volcan qui s'est formé au large de Mayotte. Le stade d'alerte du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) a atteint le niveau jaune pour la Soufrière et la montagne Pelée. Quant au nouveau volcan de Mayotte, il s'inscrit dans une réactivation générale de cette zone volcanique, moins connue que les autres. Enfin, le Piton de la Fournaise connaît deux à cinq éruptions volcaniques par an depuis plus plusieurs années.
La recherche a récemment mis en évidence que l'activité volcanique obéit à des temporalités emboîtées et très variables. L'éruption en surface nécessite trois grands phénomènes : un temps de maturation des zones de stockage des magmas qui se compte en milliers ou centaines de milliers d'années ; un temps d'instabilité de ces zones qui provoque un début de remontée du magma pouvant prendre quelques mois ou quelques dizaines de jours ; dans la dernière phase, la remontée du magma peut se produire en quelques minutes ou quelques heures. Le système reste silencieux pendant une très longue période, puis, une fois qu'il est mûr, il peut se déstabiliser très rapidement. Il faut donc intégrer des sauts de connaissance et de surveillance qui prennent en compte ces différentes échelles de temps à emboîter, y compris dans la réponse de sécurité civile.
Tous les aléas volcaniques concernent les volcans français d'outre-mer. Les éruptions non magmatiques, appelées phréatiques, sont les plus fréquentes : leur probabilité d'occurrence est ainsi d'environ 1 à 2 % chaque année en Guadeloupe et en Martinique. Elles peuvent générer tous les aléas que l'on retrouve dans les éruptions magmatiques hormis l'émission de lave. Particulièrement difficiles à anticiper, elles ont aussi été les plus mortelles au cours de la dernière décennie, ce qui soulève la question du tourisme volcanique et de l'accès aux zones actives comme celles de la Soufrière.
Malgré les progrès réalisés dans la connaissance et la surveillance, les risques volcaniques ont augmenté dernièrement et la tendance va s'accentuer avec les changements globaux. Je parle ici de risques, pas seulement d'aléas, qui augmentent avec la croissance des enjeux exposés et leur plus grande vulnérabilité. En 2015, une étude a classé les régions volcaniques du monde en fonction du pourcentage de la population totale du territoire exposée au risque à une distance de 0 à 30 kilomètres d'un volcan actif. La zone caribéenne est arrivée en tête, ce qui inclut la Guadeloupe et la Martinique. À cette époque, Fani Maoré ne s'était pas encore manifesté au large de Mayotte. Une fois les calculs refaits, Mayotte apparaît comme le territoire le plus exposé aux risques volcaniques en France et probablement dans le monde.
Pour en revenir à ces échelles de temps emboîtées, on sait que 42 % des éruptions traversent leur phase la plus violente, paroxysmale, au cours des vingt-quatre heures qui suivent le début de l'éruption et qu'elles représentent 20 % de la mortalité. Il faut donc développer une stratégie efficace de détection de l'évolution de l'activité volcanique en amont, et une stratégie de gestion de ces éruptions paroxysmales à leur début. Pour les autres éruptions, 70 % de la mortalité se produit dans un laps de temps compris entre une semaine et six mois après le début de l'éruption. Après les premières évacuations, il faut donc gérer le retour éventuel de personnes évacuées. Il faut surtout agir dans la continuité, s'intéresser à toutes les personnes qui vivent en bordure des zones exposées et à celles qui n'ont pas été évacuées mais qui vont être affectées par des dysfonctionnements systémiques.
Je vais vous exposer quelques connaissances clefs sur la sismicité des Petites Antilles, notamment celle des îles de Guadeloupe et de Martinique, classées en zone cinq, la zone française la plus sismique.
Dans ces îles, on enregistre deux types de séismes principaux.
Les séismes de subduction, liés à la tectonique des plaques à grande échelle, ont lieu à environ 30 à 60 kilomètres de profondeur au large de la côte est de ces îles, ou en grande profondeur, à environ 150 kilomètres sous les îles. Ce sont les plus puissants. Dans les catalogues de sismicité historique, on trouve des occurrences, en 1839 et 1843, de séismes qui ont pu atteindre les magnitudes 8 à 8,5. Plus récemment, le catalogue de sismicité instrumental unifié fait état d'un séisme profond sous la Martinique d'une magnitude 7,2 en 2007. Ils peuvent causer des dégâts humains et matériels, mais aussi, en fonction de leur puissance, provoquer des tsunamis.
Deuxième type de séismes : ceux qui se produisent dans la plaque caraïbe et sont liés à la présence de failles plus superficielles entre les îles. Leur profondeur – une quinzaine de kilomètres – et leur magnitude sont plus modérées que celles des séismes de subduction. Ils peuvent néanmoins avoir de lourdes conséquences puisqu'ils se produisent près des côtes, donc des populations. Nous en avons eu un exemple en 2004 : les îles des Saintes, au large de Guadeloupe, ont subi un séisme de magnitude 6,4 qui a détérioré de nombreux bâtiments.
À l'observatoire de Martinique, nous enregistrons entre 900 et 1 400 séismes chaque année autour de la Martinique, dont une dizaine sont ressentis par la population. Dans la zone des Antilles, les observatoires de Guadeloupe et de Martinique enregistrent plus de 2 200 séismes par an. Environ 70 % de cette activité est liée à la dynamique de la zone de subduction : les plaques tectoniques plongent sous la plaque caraïbe, ce qui provoque les séismes les plus puissants et les plus dangereux.
Des modélisations, effectuées à partir des mesures de déformation récentes de la plaque caraïbe montrent que le couplage de l'interface de la subduction est très faible : peu d'accumulations de contraintes tectoniques peuvent être relâchées en un séisme majeur dans le futur. Selon les estimations issues de ces modélisations, un séisme de magnitude 8 se produirait tous les 2 000 ans, ce qui paraît peu. Cela étant, les catalogues de sismicité historique et instrumentale comportent plusieurs mentions de séismes qui ont pu atteindre des magnitudes 7 à 7,8 et ont fortement affecté les populations des îles françaises. Depuis les années 1700, on a enregistré neuf séismes majeurs autour de la Martinique, six au large des côtes est et trois en profondeur sous la Martinique.
Les territoires d'outre-mer sont également concernés par les tsunamis, à des fréquences et des niveaux divers. Ils peuvent être déclenchés par des séismes, des éruptions volcaniques ou des glissements de terrain. En fonction de la localisation de la source, on parle de tsunamis locaux, régionaux ou transocéaniques. Un tsunami local ne mettra que quelques minutes à atteindre les côtes, alors que la vitesse de propagation d'un tsunami transocéanique, comme celui qui a touché Lisbonne en 1755, sera plus lente.
La Guadeloupe et la Martinique font partie des régions où le risque sismique est le plus élevé au niveau national. Un séisme majeur ou un séisme intraplaques pourrait déclencher un tsunami comme en ont connu les îles des Saintes en 2004. L'activité volcanique a aussi provoqué des tsunamis dans cette zone au cours des dernières décennies, notamment lors de l'éruption de la montagne Pelée en 1902 ou lors de l'effondrement du dôme actif de l'île de Montserrat en 2003 – une vague de soixante centimètres avait alors atteint la Guadeloupe. L'augmentation de la démographie et des enjeux exposés à proximité des côtes contribue à une élévation du risque de tsunami, qui peut être en partie réduite grâce à des actions de sensibilisation et des mesures de prévention et de contingences comme celles qui ont été prises aux Antilles.
Le contexte géodynamique de La Réunion est un peu différent : c'est un point chaud à l'intérieur – et non en frontière – d'une plaque, ce qui rend le risque sismique – et de tsunami associé – moins élevé qu'aux Antilles.
À Mayotte, le contexte tectonique se situe en bordure de plaque et en périphérie du Rift est-africain. Compte tenu des nouvelles données acquises, couplées aux enjeux exposés très élevés et vulnérables, le risque sismique – et de tsunami – est plus élevé à Mayotte qu'à La Réunion. Aux contraintes tectoniques s'ajoute l'activité volcanique, ce qui augmenterait la probabilité de l'aléa tsunami. Dans le cadre de la crise sismo-volcanique à Mayotte, nous avions répondu à la demande de l'État et réalisé des simulations numériques concernant les zones affectées telles que les aéroports.
Pour ma part, je présenterai succinctement les réseaux d'observatoires volcanologiques et sismologiques gérés par l'IPGP.
On peut répartir les stations en trois grandes familles : les stations sismologiques bien connues ; les stations géodésiques qui mesurent les déformations permettant d'apprécier si un volcan est en inflation ou déflation ; les stations géochimiques qui caractérisent les fluides des volcans. Ces stations forment des réseaux à différentes échelles spatiales : à l'échelle de l'arc des Antilles, à celle de La Réunion ou de Mayotte, ou à celle d'un volcan – ils sont alors beaucoup plus denses. Qu'ils soient denses ou à grande échelle, ces réseaux sont complexes.
L'IPGP possède une expertise couvrant toute la chaîne d'acquisition des données, du capteur jusqu'à la distribution de ces informations aux centres d'alerte, en utilisant des technologies appropriées à la gestion de crise. À l'échelle de l'arc des Antilles, par exemple, les réseaux collaborent avec le Seismic Research Centre (SRC) de Trinidad-et-Tobago et utilisent des communications satellites. Ce mode de communication non terrestre permet de transmettre les données des stations à un satellite qui les redistribue à trois plateformes de réception en Martinique, en Guadeloupe et à Trinidad-et-Tobago. C'est une façon de disposer de réseaux qui soient les plus résilients possible en cas de catastrophe naturelle. Imaginons que l'un de nos observatoires antillais soit détruit par un séisme, nous pourrions alors utiliser le deuxième, voire faire appel à nos collègues de Trinidad-et-Tobago. En matière d'instruments, l'IPGP développe des capteurs terrestres, sous-marins ou même spatiaux – il a déployé le seul sismomètre installé sur Mars, ce qui vous donne une idée de son expertise.
Tous ces capteurs permettent d'effectuer une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur le mode de la veille instrumentale. Nos collègues d'astreinte traitent en temps réel les données issues de systèmes d'algorithmes et préviennent les observatoires en cas d'activité tellurique quelle qu'elle soit. À partir de cette alerte instrumentale, les collègues informent le plus vite possible – parfois en moins de trente minutes – les autorités locales et les populations, au moyen de produits standardisés tels que des cartes d'intensité sismique ou des bulletins d'activité volcanique.
Toutes ces données sismologiques et de déformation sont envoyées à Paris, au centre de données de l'IPGP, point d'entrée pour les structures nationales et internationales d'alerte, et outil de notre contribution à l'alerte montante. Le système d'alerte aux tsunamis pour la Caraïbe se connecte ainsi en temps réel au centre de l'IPGP pour avoir accès à toutes nos données concernant l'outre-mer. Il en va de même pour le bureau central sismologique français (BCSF) dont la mission est de recueillir les témoignages en cas de séisme et de faciliter leur diffusion. Nous nous sommes concentrés sur les observatoires volcanologiques et sismologiques, mais des observatoires plus globaux participent aussi à la collecte de données.
Je ne voudrais pas terminer ma présentation sans appeler votre attention sur un point fondamental en termes d'instrumentation : toutes nos stations sont à terre, nous n'en avons aucune en mer pour mesurer en temps réel ce qui se passe à proximité des sources des phénomènes et, le cas échéant, pour nous alerter de manière encore plus précoce. Nous devons absolument développer l'instrumentation en mer comme nous essayons de le faire avec l'aide de l'Ifremer au large de Mayotte par le biais du projet de création d'un observatoire sous-marin câblé baptisé Marmor ( Marine advanced geophysical research equipment and Mayotte multidisciplinary observatory for research and response). Doté d'une alimentation sous-marine en énergie, il pourrait transmettre les données en temps réel vers la terre.

Cette commission d'enquête vise à analyser les risques qui menacent le territoire ainsi que les moyens déployés pour prévenir les aléas ou traiter les désordres. Étant accueillis par la commission des finances, il est naturel de rappeler les contingences matérielles qui sous-tendent le fonctionnement de vos institutions. Cette dimension n'est pas anodine et affecte votre capacité à remplir vos missions. Nous prenons ainsi note de vos remarques sur l'instrumentation maritime, notamment.
Vous acquittez-vous d'une fonction de conseil, du moins d'information des autorités locales afin qu'elles puissent bâtir plus efficacement leur plan de réaction aux risques ? Ou rassemblez-vous une information plus en amont, qui sera analysée par d'autres ? Transmettez-vous des données pouvant devenir des éléments de connaissance et d'appropriation pour la population ?
Vous avez évoqué les zones de risques propres aux territoires français d'outre-mer et la coopération avec d'autres pays. Sommes-nous menacés par des désordres qui surviendraient dans d'autres parties du monde ? Vos modèles permettent-ils d'établir la part de la population locale qui serait touchée par ces aléas ?
L'IPGP remplit surtout une mission d'alerte scientifique montante. Il poursuit trois objectifs : améliorer la connaissance sur les phénomènes telluriques menaçants ; détecter leurs changements d'activité et transmettre ces informations aux autorités chargées de la réponse de sécurité civile ; informer l'ensemble des acteurs, y compris la population. L'institut ne mène pas de recherches sur les enjeux exposés et leur vulnérabilité.
Le risque est en effet défini par quatre variables : l'aléa c'est-à-dire l'estimation de la probabilité qu'un phénomène dangereux survienne dans une période et une zone données ; les enjeux exposés à ce phénomène, qu'ils soient humains, d'infrastructure ou systémiques ; la vulnérabilité de ces enjeux ; et la résilience ou la capacité de ces enjeux à résister à l'impact des phénomènes.
L'IPGP fait porter ses efforts sur la connaissance fondamentale et la surveillance de la dynamique de l'aléa. Nous ne réalisons pas de cartes de probabilité d'effondrement des toits en relation avec les retombées de cendres. Pour ces aspects, l'IPGP collabore étroitement avec des experts en géographie physique et des ingénieurs des structures provenant d'organismes spécialisés tels que le BRGM. Nous travaillons donc surtout à quantifier, caractériser et suivre le phénomène dangereux, pour connaître ses capacités d'impact.
Nous transmettons les résultats de la modélisation à la population par différents vecteurs. Mayotte et La Réunion disposent d'un bulletin quotidien de niveau d'activité. Nous transmettons un bulletin hebdomadaire sur la montagne Pelée, un bulletin mensuel sur les quatre zones, ainsi que des rapports annuels. Toutes ces données sont accessibles au grand public sur notre site internet. La localisation de l'ensemble des séismes enregistrés par nos observatoires, validés par un opérateur, est disponible presqu'en temps réel sur le site du BCSF. La population peut ainsi suivre l'évolution de ces phénomènes.
Les territoires d'outre-mer peuvent naturellement être touchés par des événements survenant ailleurs. J'ai cité le séisme de Lisbonne de 1755, qui avait affecté les Petites Antilles, notamment la baie de Fort-de-France. Outre les événements sismiques, des éruptions volcaniques peuvent se produire : une éruption à Saint-Vincent, hors du territoire français, peut affecter les autres îles de l'arc antillais.
La transmission à la population peut être continue ou ponctuelle. Lors de la crise sismo-volcanique qu'a connue Mayotte, nous avons communiqué régulièrement auprès de la population et fourni des simulations numériques, demandées par les autorités, à la préfecture et aux élus.
Les observatoires sont régulièrement sollicités pour participer à la mise à jour des plans Orsec. Cela a été le cas en Martinique l'an dernier pour le plan sur le risque volcanique et cette année, pour le plan sur le risque sismique. Nous rédigeons la partie relative aux connaissances scientifiques, qui est utilisée pour définir la réponse opérationnelle.
Environ 300 000 personnes seront exposées à un volcan actif dans les outre-mer et près de 1 million, plus éloignées, pourront ressentir les effets des éruptions. Les territoires insulaires, petits et rapprochés les uns des autres, sont particulièrement concernés par ces répercussions : l'éruption d'un volcan de l'île de la Dominique ou de Sainte-Lucie aura des effets sur la Martinique et la Guadeloupe.
On touche là au rôle de surveillance que joue la communauté scientifique. S'il y a bien une réponse locale – les observatoires interagissent avec les autorités –, sur le plan national, il manque un lien entre le monde de la recherche et de l'observation d'une part, et les autorités et les gestionnaires de crise, d'autre part. La rotation fréquente de ces derniers a des implications sur la continuité dans les services. De plus, les responsables relèvent souvent de ministères différents. Dans le cas de Mayotte, les discussions interministérielles ont été fondamentales pour construire le Revosima.
Or les observatoires volcanologiques et sismologiques n'ont reçu ni mandat ni moyens suffisants pour jouer ce rôle de surveillance. Ils le remplissent localement, parce qu'un préfet confronté à une éruption a besoin de connaissances scientifiques, mais aucune disposition officielle, cadrée, n'est prévue sur le plan national.

Un séisme de magnitude 8 tous les 2 000 ans, ce n'est pas beaucoup, sauf s'il doit se produire demain. Que faudrait-il faire ?
Dans les années précédentes, nous avons tenté d'élaborer une convention pour la surveillance des aléas telluriques associant plusieurs ministères. Devant les difficultés rencontrées, nous en sommes restés à des conventions bilatérales, avec le ministère de la transition écologique, qui finance l'institut à hauteur de 2 millions depuis 2017, et avec le ministère de l'intérieur, sur les aspects liés à la surveillance.
Non seulement le lien entre les chercheurs et les autorités n'existe pas, mais les informations que nous produisons ont du mal à être intégrées dans les travaux et les prérogatives des autres organismes. Je peux citer l'exemple d'une future thèse utilisant la modélisation par des systèmes multi-agents, qui porte sur des scénarios d'évacuation lors d'éventuelles éruptions de la Soufrière en Guadeloupe. L'étude, qui a mis trois ans à aboutir, est menée avec différentes communautés travaillant sur les systèmes complexes, les mathématiques ou la géographie. Des outils ont été développés ; des scénarios ont été testés. Comment l'information que nous transmettons peut-elle continuer d'évoluer, être mûrie et modifiée dans les services de l'État ? Il faut trouver des relais techniques dans ces structures, qui puissent intégrer cette information.
Outre la rotation des interlocuteurs, un tel relais manque : un effort pédagogique est à chaque fois nécessaire. Nous produisons un grand volume d'informations, qui ne va pas assez loin et ne sert pas assez les différents organismes de l'État chargés de la sécurité civile.
Il est nécessaire d'instaurer entre les chercheurs et les gestionnaires de crise un partenariat stable et pérenne par son financement, qui soit fondé sur des missions claires, avec des mandats, des objectifs pluriannuels, des ressources pouvant être planifiées. Il faut aussi prévoir des astreintes pour les personnels chargés de la surveillance. Actuellement, ces astreintes ne sont pas financées et aucun agent des observatoires n'a pour tâche d'assurer un lien avec les gestionnaires de crise. Si l'on veut améliorer la surveillance, il faut reconnaître ce rôle et le pérenniser, avec un cadre plus général, interministériel.
Actuellement, l'astreinte repose sur le bénévolat de nos collègues, qui se relaient pour mener à bien la veille instrumentale continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Tout cela n'est pas reconnu. Certes, les collègues d'astreinte récupèrent les heures effectuées durant les astreintes mais nous serions bloqués s'ils refusaient d'y participer.

Comment concilier les normes antisismiques et anticycloniques dans la construction ?
Si un tremblement de terre ou un tsunami touche la Martinique, il concernera obligatoirement Sainte-Lucie, la Dominique et la Guadeloupe. Quel niveau de coopération régionale entretient l'IPGP avec les îles non françaises de la Caraïbe ?
Nous avons noué un partenariat avec le SRC pour équiper les îles des Antilles de stations sismologiques et géodésiques. Le SRC et l'IPGP se répartissent le travail de maintenance selon que les îles sont anglophones ou francophones. Ils reçoivent toutes les données, transmises par satellite. Ce partenariat très étroit permet de mutualiser les données et les technologies car les séismes ne s'arrêtent effectivement pas aux frontières.
En volcanologie, nous menons également des échanges réguliers avec le SRC, responsable de la surveillance des îles anglophones.
Les normes de construction ne relèvent pas de notre mission. Pour améliorer la prise en compte sociétale des différents risques, il faut non seulement travailler de manière transversale sur chaque aléa mais aussi déployer une stratégie inter aléas et faire travailler ensemble les communautés afin d'éviter les décisions contradictoires. C'est notamment le cas pour les territoires soumis à plusieurs aléas, dont certains augmenteront probablement d'intensité dans les années à venir. Ces situations demandent un changement de paradigme au niveau national.

Je vous invite à me communiquer une contribution sur la façon dont vous envisagez cette coopération. Elle pourrait alimenter les propositions que fera la commission d'enquête.
Comment se passe la coopération avec un État failli, comme Haïti, où les données sont vraisemblablement difficiles à collecter ?
En Haïti, où les réseaux permanents de l'État sont défaillants, des équipes de recherche de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement ou de l'Université d'État d'Haïti ont pris le relais et développé des réseaux sismologiques citoyens. Ils ont mis à contribution les citoyens volontaires pour accueillir des capteurs sismologiques à bas coût chez eux. Ces derniers participent à la construction des catalogues de sismicité et à l'évolution des connaissances. D'autres équipes de recherche s'attachent à vulgariser l'information sur les différents risques en Haïti, par la distribution de plaquettes informatives en créole, en anglais et en français.

Vous avez dit que Mayotte était la collectivité la plus exposée des outre-mer et peut-être parmi la plus exposée au monde. Combien de séismes y ont été enregistrés dans les dernières années ? Peut-on imaginer que Mayotte soit un jour dotée d'un observatoire permanent ?
Mes propos se rapportaient surtout au risque volcanique. Les séismes sont très bien enregistrés à Mayotte depuis le début de la crise éruptive de 2018, par des réseaux terrestres et des capteurs en mer, qui sont récupérés et redéployés tous les quatre à six mois. Installer des capteurs permanents en mer permettrait d'augmenter notre capacité à enregistrer des signaux en temps réel. On enregistre actuellement à Mayotte 300 à 400 séismes volcano-tectonique par mois et quelques séismes d'origine tectonique, dus aux mouvements entre les plaques. La région est en effet une zone de frontière de plaques, en marge du rift est-africain.
S'agissant des observatoires, la Martinique dispose du deuxième plus ancien au monde, créé après l'éruption catastrophique de la montagne Pelée, en 1902 ; ceux de la Guadeloupe et de La Réunion datent respectivement de 1949 et de 1979. Le but est d'en installer à proximité des sources, ce qui exige une stratégie de développement portant sur des dizaines d'années ainsi que des moyens financiers.
La situation de Mayotte est plus complexe que celle des autres zones volcaniques car plusieurs parties de sa chaîne volcanique d'une cinquantaine de kilomètres présentent des éruptions. Alors qu'à la Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion un seul volcan a été en activité durant les derniers 10 000 ans, à Mayotte, Fani Maoré a surgi à cinquante kilomètres de Grande-Terre et de Petite-Terre. En travaillant sur cette éruption, nous avons découvert entre 100 et 200 points de sortie de magma entre Petite-Terre et le volcan sous-marin. Selon des études récentes, des éruptions ont eu lieu il y a 4 000 ou 5 000 ans à quinze kilomètres à l'est de Petite-Terre, dans la zone dite du fer à cheval. Cette île comporte en outre des cratères volcaniques.
Le réseau de surveillance sismologique et volcanologique de Mayotte doit donc apporter des réponses en matière de surveillance instrumentée et d'anticipation des phénomènes sur trois zones volcaniques avec des passés éruptifs et des comportements différents, et dont une partie est sous-marine. Cette situation complexe requiert une réflexion et une stratégie sur le très long terme.
Il est aussi primordial de développer les formations universitaires scientifiques à Mayotte pour que les Mahorais, une fois formés aux métiers de la recherche ou de la technologie, puissent contribuer à la sécurité de leur territoire. Cela prendra plusieurs décennies. Ces territoires insulaires ne doivent pas se couper des sauts de connaissances réalisés par d'autres communautés, notamment les universités. C'est pourquoi le lien avec l'IPGP est aussi important : l'ancrage dans le tissu universitaire et académique est la clef du succès de nos observatoires.

Outre la contribution spécifique que j'ai demandée, vous pouvez me communiquer tout élément pour compléter vos interventions.
L'audition s'achève à dix-sept heures dix.
La commission procède à Audition, ouverte à la presse, du Centre national de recherche scientifique (CNRS) : MM. Alain Schuhl, directeur général délégué à la science, Stéphane Guillot, directeur-adjoint scientifique de l'Institut national des Sciences de l'Univers du CNRS, Domaine Terre Solide, et Patrick Allard, directeur de recherche CNRS émérite à l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), Thomas Borel, responsable des affaires publiques.
La séance est ouverte à dix-sept heures vingt.

Je vous remercie d'être parmi nous pour échanger autour des questions liées aux risques naturels en outre-mer. Mes chers collègues, nous accueillons désormais plusieurs éminents représentants du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Je note qu'une convention a récemment été signée entre le ministère chargé des outre-mer et le CNRS pour réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique sur les impacts du changement climatique dans les outre-mer. Il s'agit là d'un travail fondamental et urgent. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(M. Alain Schuhl. M. Stéphane Guillot, M. Patrick Allard et M. Thomas Borel prêtent successivement serment.)
La mission que nous a confiée le ministère des outre-mer porte sur une étude de l'impact du changement climatique dans les territoires d'outre-mer. Plus précisément, elle a été confiée à une personne que nous avons embauchée spécialement, qui est localisée sur l'île de La Réunion, qui a réalisé un travail bibliographique très important et qui est maintenant en train de travailler avec les autorités locales – à savoir les autorités territoriales et d'État – pour organiser des consultations et des groupes de travail afin de dresser un état des lieux de ce qui est déjà mis en place. L'opération progresse bien et nous rendrons un travail au mois d'avril, avant de nous pencher sur les bassins antillais et polynésien, ce qui nous permettra de réaliser un état des lieux global. La mission se terminera en septembre 2025.
De manière générale, les impacts du changement climatique correspondent à une augmentation de la température globale du système Terre. Quels que soient les bassins, on constate une augmentation globale des océans Atlantique, Indien ou Pacifique à peu près au même niveau que la Terre, c'est-à-dire entre 1 et 1,5 degré. L'effet est toutefois plus important sur la terre que dans l'océan, ce dernier se réchauffant moins vite. Nous constatons également que cet effet d'augmentation se fait surtout ressentir la nuit, notamment à La Réunion et en Polynésie. Le nombre de nuits anormalement chaudes a en effet triplé lors de ces quarante dernières années. De plus, le réchauffement s'élève à un degré en journée et à deux degrés pendant la nuit.
Une des premières conséquences du réchauffement climatique correspond à l'augmentation du niveau de la mer, qui s'élève à 4 millimètres par an en moyenne. À nouveau, il existe des disparités : l'augmentation est plus rapide dans l'océan Indien, où l'élèvement atteint plutôt 6 millimètres par an, contre 3,5 à 4 millimètres par an au niveau de l'océan Atlantique.
Un des autres effets correspond à l'acidification des océans en raison de l'augmentation du CO2, ce qui entraîne des conséquences directes sur les mangroves et les coraux. De plus, ce phénomène a un impact sur les risques associés, car en cas de tempêtes et de cyclones, les protections naturelles, c'est-à-dire les barrières coralliennes et les mangroves, sont moins efficaces.
L'érosion des côtes représente un autre impact et se marque très fortement au niveau du bassin Caraïbes, qui compte de nombreuses plages. Ce phénomène est un peu moins prégnant à La Réunion, dont les plages sont moins nombreuses, même si la côte connaît tout de même cet effet d'érosion. En outre survient l'effet surcote : au moment des tempêtes ou des cyclones, les vagues sont plus importantes du fait de l'élévation du niveau de la mer et détruisent davantage les côtes.
Par ailleurs, nous commençons à constater une tendance vers la diminution des précipitations annuelles. Concrètement, la période de sécheresse devient plus intense et s'allonge, ce qui crée des problèmes de conservation d'eau. En effet, les îles n'ont pas de réservoir naturel et le système hydrologique est relativement peu développé. La saison des pluies devient également plus intense, mais de manière globale, les quantités d'eau annuelles diminuent de 10 à 15 %.
De plus, nous commençons à entrevoir une diminution du nombre des cyclones au niveau du bassin Caraïbes, mais également une augmentation de leur intensité. Dans l'océan Indien, la zone des cyclones se déplace vers le sud, ce qui impactera de plus en plus Mayotte et La Réunion, qui ne connaissaient pas beaucoup de cyclones jusqu'alors. Ce phénomène n'est pas encore concrètement constaté, car ce ne sont encore que des prévisions fournies par les modélisations réalisées au moyen des modèles globaux et des données locales. Je vous parlerai d'ailleurs de l'acquisition de celles-ci, car elles sont importantes pour la modélisation à l'échelle des îles. En effet, nous parvenons désormais à descendre à une échelle de 1,5 kilomètre, ce qui offre une relativement bonne connaissance de ce qui se passera autour des îles.
A priori, nous nous attendons à une diminution des vents, c'est-à-dire des alizées, au niveau du bassin Caraïbes ; cependant, ils devraient augmenter en intensité au niveau de l'océan Indien, en particulier pendant l'hiver austral, alors qu'ils étaient déjà relativement forts. Concrètement, l'anticyclone des Mascareignes, qui est au large de Madagascar, deviendra plus important et intense, ce qui favorisera les vents locaux.
Le constat n'est donc pas encourageant et nous nous attendons à une augmentation des risques climatiques de manière assez prégnante au niveau des îles. Ces risques sont en effet très exacerbés sur les îles et les phénomènes connus en outre-mer seront beaucoup plus forts dans les trente à cinquante ans à venir.
En Polynésie, un des risques correspond à la montée des eaux, car les îles sont très basses et relativement plates. La Polynésie française était en outre assez peu impactée par les cyclones et nous attendons à en voir davantage dans les trente à cinquante ans à venir. Les autres effets dont j'ai parlé y sont également présents, avec l'augmentation des sécheresses ainsi que de la pluviométrie durant la période de pluie et la diminution d'environ 10 % ou 15 % de la quantité des pluies sur l'ensemble de l'année.
Je vais quant à moi vous parler du risque volcanique, car je suis directeur de recherche CNRS rattaché à l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), mais j'ai été vice-président puis président de l'association internationale de volcanologie. Ma vision dépasse donc celle de l'IPGP et le périmètre de la France.
Actuellement, 850 millions de personnes vivent dans un rayon de moins de 100 kilomètres autour d'un volcan actif. Le risque volcanique a donc une portée mondiale. En France, il est pour le moment cantonné dans les territoires d'outre-mer et concerne environ 1,8 million de personnes, réparties entre La Réunion, les Antilles et Mayotte.
En l'état actuel de nos connaissances, le réchauffement climatique n'accroît pas le risque volcanique. Ce ne sera donc pas le cas dans nos régions, mais ce le sera probablement à certains endroits qui sont recouverts de glace, c'est-à-dire en Islande ou dans les Andes. En effet, le poids des glaciers fondant réduira la pression sur les chambres magmatiques et, lors des épisodes chauds, l'activité volcanique a tendance à être plus soutenue dans ces régions.
L'activité volcanique est donc concentrée dans nos territoires antillais, à La Réunion et à Mayotte, qui sont soumis aux mêmes risques climatiques ainsi qu'aux risques de glissements de terrain et d'inondations. Toutefois, les volcans et les séismes sont associés à des contextes tectoniques différents. En effet, il s'agit par exemple d'un point chaud à La Réunion : un chalumeau souffle de la chaleur et fait remonter des magmas depuis presque le noyau de la Terre. Dans les Antilles, l'affrontement des plaques océaniques – plaque atlantique et plaque caraïbes – crée du stress mécanique qui se traduit par des séismes et, en replongeant dans le manteau, la plaque océanique atlantique fond en partie et engendre des magmas, créant ainsi des volcans. Ce sont des volcans plus explosifs, mais qui entrent en éruption moins souvent, car leur magma est plus visqueux et riche en gaz, contrairement aux magmas de La Réunion qui sont plus fluides et plus classiques, et donc moins dangereux.
Au cours de la dernière décennie, l'activité volcanique s'est accrue, notamment au niveau des volcans français. Laissons de côté le Piton de la Fournaise, qui est toujours très actif, avec trois éruptions par an qui sont prévues dans les deux heures ou les deux jours qui précèdent. La situation est cependant différente dans les Antilles. La Soufrière en Guadeloupe a dormi calmement pendant quinze ans après sa fameuse éruption de 1976-1977, mais depuis 1992, nous assistons à une réactivation notable du volcan avec l'augmentation de l'activité sismique ainsi que des émissions de gaz et l'élargissement des zones chaudes ainsi que des zones de dégazage. Un pic d'énergie a été atteint en avril 2018 avec un séisme de magnitude 4, ce qui a pu laisser penser que nous avions évité de justesse une éruption phréatique. Concrètement, l'observatoire et les autorités préfectorales ont passé le niveau d'alerte de vert à jaune, couleur qui signifie « vigilance ».
À la Martinique, la montagne Pelée dormait encore plus calmement que la Soufrière depuis 90 ans, c'est-à-dire depuis sa dernière éruption en 1929-1932, mais elle a montré des signaux de réactivation dès 2014. Ensuite, une crise s'est accrue entre 2018 et 2023 et a été marquée par des séquences sismiques à faible profondeur, c'est-à-dire entre 0 et 5 kilomètres, et par quelques déformations lentes mais significatives de l'édifice ainsi que par l'apparition de zones dégradées de la végétation sur les flancs sud-ouest, c'est-à-dire dans des zones où il y a eu des éruptions phréatiques dans les siècles passés. Ces phénomènes ont fait craindre une réactivation pouvant aller jusqu'à un terme magmatique.
Nous savons grâce à des travaux récents sur les magmas de La Réunion que le temps de maturation des éruptions, c'est-à-dire le temps compris entre la chambre magmatique et la surface, peut varier entre un et trois ans, ce qui est assez réduit. Nous n'avons en outre aucun enregistrement instrumental de ces séquences de signaux qui précèdent la maturation des éruptions magmatiques. Le niveau d'alerte est d'ailleurs également passé de vert à jaune en Martinique. Certaines discussions portent désormais sur le maintien ou l'abaissement de ce niveau, mais la vigilance reste de mise.
Par ailleurs, vous êtes tous au courant de cette éruption gigantesque, sous-marine et inattendue qui est survenue à Mayotte. La crise sismique a en effet surpris tout le monde et a été extrêmement intense. De plus, la découverte d'un volcan sous-marin de sept kilomètres cubes, formé en quelques mois, a stupéfié tout le monde. Concrètement, c'est la première fois qu'une éruption sous-marine de cette ampleur est enregistrée et observée. La situation se calme du point de vue volcanique, même s'il y existe un gros réservoir de magma sous-jacent, assez profond, avec des relais intermédiaires qui dégazent et produit des émissions sous-marines importantes. L'activité sismique n'y est pas nulle et il existe des risques à bien évaluer dans le cadre du réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (Revosima).
Nos quatre volcans sont en vigilance jaune et je participe au comité de pilotage de Revosima avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), l'IPGP et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Cette structure fonctionne extrêmement bien et rassemble des représentants de l'État – direction générale des outre-mer, ministère de la transition écologique et ministère de l'intérieur. Nous sommes par ailleurs en lien avec la préfecture et nous y travaillons depuis trois ans. Les organismes de recherche sont présents en tant qu'experts et interviennent en appui à la politique publique. Des réunions sont organisées hebdomadairement pour les scientifiques et mensuellement pour le comité de pilotage. Le dispositif fonctionne remarquablement bien et ce modèle pourrait être dupliqué pour l'ensemble des risques naturels sur le territoire, c'est-à-dire en réunissant les experts scientifiques ainsi que les représentants de l'État aux niveaux ministériel et local.
Le risque sismique est non négligeable au niveau des Antilles. En effet, les Caraïbes sont très proches de la zone de subduction, même si aucun séisme très important n'a eu lieu depuis environ 1850. Toutefois, le risque d'un séisme qui engendrerait un tsunami à cet endroit est réel. La vague mesurerait entre un et trois mètres et les îles seraient touchées entre dix et quinze minutes après la survenue du séisme au niveau de la zone de subduction. À La Réunion, un séisme survenu au niveau de la zone indonésienne engendrerait une vague qui prendrait six heures à arriver. Le délai est donc beaucoup plus réduit aux Antilles et nos villes et villages sont tous situés autour de la côte : le risque sur la façade atlantique est donc énorme.
Nous travaillons avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur la mise en place d'un réseau identique à celui qui existe en Méditerranée, à savoir le Centre d'alerte aux tsunamis (CENALT) qui est le réseau de surveillance du domaine méditerranéen et de l'Atlantique Nord-Est. Il permet de donner l'alerte en temps réel pour un séisme qui se produirait sur la côte nord-africaine et qui arriverait dans la région de Nice en une heure ou qui se produirait dans l'Atlantique, comme ce fut le cas à Lisbonne en 1755.
Un tel réseau n'existe pas au niveau des îles, en particulier dans les Caraïbes, même si la France y est associée au réseau américain. Cependant, il n'est pas suffisamment précis en raison de la manière dont il est disposé. Nous commençons donc à travailler avec le CEA, le ministère de la transition écologique et le ministère de l'intérieur au déploiement d'un réseau d'alerte, car les délais sont très courts en cas de problème.

Ces nouvelles montrent que le risque est présent et que ce ne sont pas simplement des vues de l'esprit. Cette commission d'enquête a vocation à étudier l'état des risques et à comprendre si les dispositifs mis en œuvre permettent d'alerter et sont coordonnés de manière suffisamment efficace pour que les effets ne soient pas trop dramatiques sur les populations alentour. Concrètement, nous cherchons à savoir si le système comprend des défauts afin de pouvoir les corriger. Nous pouvons par ailleurs nous réjouir de ce qui est déjà fait et bien fait.
Vous faites partie de la recherche, étant membre du CNRS, même si vous avez certainement une plus grande ouverture et pédagogie à l'égard du public que les autres organismes que nous avons déjà entendus. Dès lors, dansons-nous actuellement sur un volcan ? Avons-nous une réelle lucidité par rapport au risque ? Avons-nous un aménagement et des décisions de normes adéquats ? Êtes-vous en lien avec les personnes qui prennent ces décisions, en dehors de la structure que vous avez décrite et qui semble fonctionner comme il faut ?
Par ailleurs, sommes-nous sur une trajectoire qui permette de prévoir les risques futurs liés au réchauffement climatique ainsi que les risques volcaniques et sismiques ? Comment la coopération avec les territoires alentour, qui auront forcément un effet sur nous s'ils sont touchés, est-elle organisée ? Vous avez en outre parlé d'un système d'alerte et d'une forme de maillage qui permet d'avoir une connaissance des effets du réchauffement climatique à une échelle de 1,5 kilomètre. J'en déduis que ce n'est pas tout à fait le cas en ce qui concerne les risques sismiques et volcaniques. Que faudrait-il pour y parvenir ?
Enfin, nous coopérons avec les Américains et cela ne suffit pas forcément, mais que se passe-t-il lorsque nous sommes face à des États ou des secteurs dans lesquels les conditions de sécurité, d'ordre public ou d'existence d'un État ne sont plus garanties pour mener des recherches ?
Ces questions sont vastes. Au sujet des risques climatiques, certaines choses fonctionnent tout de même bien et ont progressé lors des dernières années. À l'occasion du cyclone Belal à La Réunion, la relation entre Météo-France et la préfecture a été remarquable. Le préfet a décidé d'entrer en vigilance violette la veille, c'est-à-dire de confiner totalement les personnes, et ensuite de lever progressivement la vigilance, qui est passée de violet à rouge, ce qui a permis à la sécurité civile d'intervenir, puis de tout rouvrir. Cette gestion a été tout à fait remarquable, même si quatre personnes sans-abri qui avaient refusé de l'aide sont malheureusement décédées.
L'anticipation est fondamentale dans la gestion des risques, car il est impossible d'empêcher un séisme, une éruption volcanique ou un cyclone. Par conséquent, il faut se prémunir au maximum, notamment par des mesures telles que celles qui ont été prises par M. le préfet et par l'éducation des populations – et je pense que les habitants d'outre-mer sont relativement sensibilisés sur ces questions. En effet, le sujet est abordé à l'école, les populations vivent avec les volcans et les cyclones, etc. Toutefois, il ne faut jamais relâcher l'effort. En outre, nous avons un réel problème avec les touristes, qui ne sont pas sensibilisés et acculturés. Il va donc falloir travailler sur cette question.
Météo-France fonctionne bien, car nous disposons désormais de données à long terme acquises par les observatoires du CNRS depuis quarante ans grâce à des capteurs pour la pluviométrie, les vents, la volcanologie, etc. Nous pouvons ensuite les entrer dans des simulations numériques, ce qui nous permet d'améliorer les modèles et de passer d'un modèle global à un modèle à l'échelle d'une île et de ses alentours, notamment pour mieux comprendre les trajectoires de cyclones.
Dans le cas du cyclone Belal, la trajectoire avait été prévue, mais le cyclone a tourné au dernier moment et les comportements chaotiques sont très difficiles à anticiper. Cependant, la décision de confiner l'île avait été prise. Ensuite, ce cyclone s'est dirigé vers l'île Maurice, qui n'était pas prête et le niveau d'alerte y est passé de 1 à 3 dans la même journée. Par conséquent, les habitants ont paniqué et n'étaient pas confinés. Finalement, il y a eu des morts et des inondations. La prévention est donc très importante et passe par de la sensibilisation, de la pédagogie et de la modélisation de plus en plus fine, tant pour le risque climatique que volcanologique.
Concrètement, toute l'acquisition de cette donnée long terme et le travail de recherche réalisé ensuite permettent de mieux anticiper les processus. Sur le climat, nous devons continuer à acquérir de la donnée et à travailler main dans la main avec Météo-France. Par exemple, nous avons à La Réunion le laboratoire de l'atmosphère et des cyclones (LACy), qui est le laboratoire météorologique associé à l'observatoire de La Réunion et qui travaille avec Météo-France pour les acquisitions de données. En revanche, nous n'avons pas d'observatoire de météorologie dans les Antilles, mais les chercheurs métropolitains effectuent tout de même ce travail.
La situation est plus compliquée pour les risques volcaniques, étant donné qu'on ne touche pas l'atmosphère et qu'on ne peut pas naviguer dans le magma pour faire des mesures in situ. Nous faisons donc de l'échographie et essayons de comprendre la dynamique des processus souterrains grâce à la sismographie et la géodésie. Avec des capteurs à terre et spatiaux, nous savons mesurer les déformations d'un volcan sous la poussée du magma ainsi qu'évaluer les secteurs du volcan qui pourraient éventuellement s'effondrer et engendrer des glissements de terrain dévastateurs. Nous mesurons également les émissions de gaz associées à la remontée du magma, depuis le sol ou depuis un satellite.
À nouveau, la prévention permet la prévision, mais ce n'est pas toujours aussi facile que pour la météo et les constantes de temps ne sont pas les mêmes, ce qui implique un degré d'incertitude nettement supérieur dans la prévision des phénomènes volcaniques par rapport aux phénomènes météorologiques. Un même volcan peut d'ailleurs produire différents types de dynamismes, même si nous avons des classes de volcans. Nous effectuons donc de la modélisation et nous nous penchons sur le passé éruptif du volcan pour en connaître à la fois le comportement habituel, les comportements erratiques, les dépôts, le type de magma émis et les conséquences possibles. Ce travail de documentation historique est un préalable à toute capacité de prévision. De plus, nous devons maintenir des réseaux de surveillance en temps réel avec des capteurs sismiques, géodésiques, géochimiques, etc. Plusieurs méthodologies peuvent être combinées et la vérité ne surgit que d'un travail d'équipe combinant toutes les disciplines.
En ce qui concerne le degré de résolution de nos capacités de prévision, nous avons nettement progressé au cours des deux ou trois dernières décennies dans la compréhension du fonctionnement des volcans et dans les capacités de détection des signaux précurseurs. Les technologies et développements instrumentaux ont en effet permis d'enregistrer d'importants progrès, mais des incertitudes subsistent, car nous n'observons pas directement les phénomènes avant qu'ils se produisent à la surface. Cette incertitude reste d'ailleurs parfois difficile à transmettre tant aux autorités qu'à la population.
Notre expérience des crises volcaniques, notamment vis-à-vis de ce problème d'incertitude et de durée des crises qui peuvent être longues, montre que l'éducation des populations, leur information, le fait de garantir la confiance des populations, la transparence des données entre les scientifiques, les autorités, la population et les médias sont absolument cruciaux. Nous devons donc poursuivre nos efforts dans les territoires d'outre-mer pour renforcer l'éducation et l'information, ce qui permet de mieux gérer la crise et les incertitudes.

Je souhaite que vous reveniez sur l'état du dispositif français. Par ailleurs, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'observatoire météorologique aux Antilles, mais n'est-ce pas nécessaire ou souhaitable ?
En outre, étiez-vous associés aux plans Orsec ? Si oui, existe-t-il un plan Orsec à Mayotte ? J'en réclame une copie depuis plusieurs mois et je ne l'ai pas obtenue. Cependant, mon collègue qui est plus informé que moi sur Mayotte m'indique qu'il existe bel et bien.
Enfin, je voulais revenir sur la question de la sensibilisation et j'ai eu l'occasion d'aborder le sujet à l'occasion d'un premier rapport pour avis en 2021. Beaucoup de choses se font désormais en ligne, mais tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Nous avions imaginé à l'époque la possibilité d'associer des Mahorais, qui n'ont certes pas votre niveau de compétences mais qui pourraient progressivement acquérir un savoir en la matière. Ces personnes seraient présentes sur place, connaîtraient la situation et pourraient transmettre les informations autour d'elles afin de créer un climat de confiance, car elles parlent la langue locale. En effet, la population maîtrise de manière aléatoire le français, notamment les personnes de ma génération, même si j'ai eu beaucoup de chance pour ma part. Il n'est donc pas inintéressant qu'une personne sur place participe à ces programmes et serve de relais vis-à-vis des populations. Est-il aberrant que des Mahorais participent au Revosima ?
Cela a été fait à Mayotte, car nous travaillons beaucoup avec les radios locales et les messages y sont passés à la fois en mahorais et en français. Un bulletin sismologique et volcanologique est en place et toutes les alertes sont systématiquement passées dans les deux langues. J'ai travaillé avec le ministère de l'intérieur sur cette question et nous nous sommes aperçus que le meilleur vecteur correspondait aux radios locales, voire aux télévisions locales. Cette idée de sensibilisation et de programme pédagogique relativement simple me semble constituer une très bonne initiative. Elle a été mise en place par l'IPGP, en particulier à Mayotte, via les travaux de Maud Devès. Nous étions entrés dans une crise importante, car nous ne comprenions pas cette sismicité. Nous avons ensuite compris qu'elle était due au volcan et les populations ont été informées progressivement. La radio avait alors constitué un vecteur important.
Par ailleurs, il existe bel et bien un plan Orsec à Mayotte, car nos équipes ont travaillé à son élaboration. Enfin, en période de crise volcanique, l'évacuation des populations constitue un problème qui se pose à nous, notamment quand les avions ne peuvent pas voler en raison de la production de cendres. À Mayotte, l'évacuation pourrait éventuellement avoir lieu avec des bateaux militaires, mais La Réunion n'est pas située juste à côté. En effet, sans avion, plusieurs jours de mers sont nécessaires pour accéder à Mayotte.
Dans les Antilles, une entraide est possible, comme pendant la crise volcanique de Saint-Martin, entre les îles françaises, hollandaises, etc. En effet, la proximité y est relativement forte, contrairement à Mayotte qui est loin de toute terre. Évacuer Mayotte serait donc probablement compliqué.
Je pense que nous devons évaluer cette question avec nos équipes et Météo-France. Je ne suis cependant pas en mesure de préjuger de la pertinence de le mettre en place. Concrètement, je ne peux pas trancher cette question dans l'immédiat, mais nous allons l'aborder.

Êtes-vous également sollicité sur la transformation et l'évolution du plan Orsec à moyen ou long terme, compte tenu de ce que vous dites à propos de l'aggravation des risques ? Comment faites-vous pour traiter de la donnée dans les secteurs où il est difficile de la récupérer, car les situations sont chaotiques ou certains États ne fonctionnent plus ?
Le plan Orsec a été revu pour les Antilles et le risque volcanique a été réévalué, notamment pour les zones qui seraient impactées par une éruption, car nous avons maintenant une meilleure connaissance de l'historique. Par ailleurs, je vous répondrais non en ce qui concerne le risque climatique et il reste un travail à effectuer. Des travaux ont été réalisés par le BRGM sur les zones d'inondation en lien avec l'augmentation du niveau marin, c'est-à-dire les zones qui seront inondées dans les trente à cinquante ans à venir. Toutefois, je ne suis pas en mesure de vous répondre de façon globale.
Le message sur l'historique est fondamental : pour comprendre le futur, il faut comprendre le passé. L'acquisition de la donnée long terme est un paramètre fondamental pour comprendre l'évolution du système, car nous pouvons comprendre les processus, ce qui nous permet de mieux anticiper l'avenir, qu'il s'agisse des volcans, des séismes ou du changement climatique. Pour les volcans, nous observons l'évolution du système sur plusieurs dizaines de milliers d'années afin d'évaluer la récurrence des grandes phases éruptives. Nous sommes ensuite capables d'extrapoler cette étude pour prévoir ce qu'il pourrait se passer dans vingt ou trente ans en termes de tendances. En effet, les données acquises sont rentrées dans des simulations numériques de très haut niveau qui permettent d'anticiper ou de mieux comprendre ce que sera le futur. Nous avons donc besoin de personnes pour réaliser ces observations à long terme. Cependant, nous nous situons à la limite entre recherche, observation et surveillance et la recherche française, qui est de très haut niveau, fonctionne par appel d'offres. Par conséquent, l'observation de long terme, voire la surveillance, ne peut pas fonctionner avec des appels d'offres. En effet, lorsque vous déposez un projet, vous n'êtes pas sûr qu'il sera financé. Cependant, la compréhension du système ne peut pas être dépendante de crédits qui arrivent ou non.
La direction de l'IPGP a dû vous en parler et le phénomène concerne également les directeurs d'observatoire ou les membres des observatoires qui ne sont pas permanents. Il ne s'agit d'ailleurs pas de postes statutaires et les départs sont difficiles à gérer. Le système italien dispose quant à lui d'une structure, l'INGV, avec des personnes qui travaillent en permanence sur l'observation et la surveillance en lien avec la sécurité civile. Ce sont donc des chercheurs qui effectuent ce métier et qui conservent ce lien entre observation, surveillance et recherche. En France, ce système existe au niveau du Corps national des astronomes et physiciens (Cnap) et fonctionne très bien. Cependant, nous n'avons pas assez de personnel : la moitié des services nationaux d'observation, qui sont gérés au CNRS avec les autres organismes, le sont par des enseignants-chercheurs d'une université, car nous manquons de personnels Cnap ou CNRS dans ces observatoires pour réaliser cette surveillance et l'acquisition des données.
La dernière section créée au sein du Cnap est intitulée Océan-Atmosphère, sujet qui devient vraiment critique et nécessite un travail sur le climat. Actuellement, pour l'alimenter et recruter des jeunes, nous sommes contraints de prélever des postes au niveau de la Terre solide, c'est-à-dire des personnes qui font la surveillance volcanique et sismologique, ou de l'astronomie-planétologie. Concrètement, on alimente une section du corps en déshabillant les autres, car nous sommes conscients au CNRS qu'il est fondamental de travailler sur le changement climatique. Nous ne sommes tout de même pas dans la situation de l'hôpital français, mais nous rencontrons de réelles difficultés.
Dans la note que je vous ai transmise, nous avons travaillé sur cette notion de mission nationale d'observation et de recherche pour proposer de passer d'une fonction liée à des appels d'offres à une fonction régalienne, c'est-à-dire avec un engagement de l'État pour mieux se préparer à ces risques. Le coût annuel des catastrophes naturelles représente environ 10 milliards d'euros pour la France et les assureurs affirment que les risques naturels liés au changement climatique seront les risques majeurs des dix, vingt ou trente ans à venir. Le coût annuel en argent et en vies humaines va nécessairement croître et nous pensons qu'en anticipant mieux, nous pourrons atténuer modestement les conséquences du changement climatique. Par exemple, le cyclone Belal a été très bien géré grâce à une bonne anticipation. Une prise de conscience a lieu en recherche et à travers la nation sur le changement climatique et l'État se doit d'accompagner cet effort. Nous avons d'ailleurs les structures nécessaires et nous pouvons améliorer le système. Un léger effort d'amélioration de nos structures et des moyens financiers ou des postes associés seraient bénéfiques. En effet, si nous améliorons de 1 % l'anticipation, nous gagnons 100 millions d'euros par an : nous ne coûtons donc pas cher. Pour améliorer durablement la situation, nous estimons que 10 millions d'euros sont nécessaires par an, ce pour quoi nous sommes très rentables.

Il me reste à vous remercier de la qualité des échanges et de la clarté de vos exposés, qui nous ont permis de pénétrer quelque peu dans les problématiques volcaniques et sismiques.
L'audition s'achève à dix-huit heures quinze.
La commission procède à l'audition, ouverte à la presse, de l'Office français de la biodiversité (OFB) : M. Jean-Michel Zammite, directeur des Outre-mer.
La séance est ouverte à dix-huit heures vingt.

Mes chers collègues, nous terminons cette première journée d'audition en accueillant à présent le directeur des outre-mer au sein de l'Office français de la biodiversité (OFB), M. Jean-Michel Zammite, à qui je souhaite la bienvenue. L'OFB est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité et est chargé de la protection et de la restauration de la biodiversité en métropole et dans les outre-mer. À ce titre, il est présent dans les différents territoires ultramarins et est donc particulièrement bien placé pour évoquer les impacts des risques naturels majeurs sur la biodiversité et les moyens de les prévenir. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale.
L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(M. Jean-Michel Zammite prête serment.)
Vous avez brièvement évoqué l'OFB et certaines de ses missions, mais permettez-moi de compléter cette présentation. Je vous ai d'ailleurs transmis un PowerPoint qui pourra éclairer mes propos. L'OFB est donc une institution relativement récente, issue de la fusion d'établissements anciens et bien connus. Avec ce grand opérateur de la biodiversité né le 1er janvier 2020, la France s'est dotée d'un opérateur de référence sur l'eau et la biodiversité. Il est chargé de contribuer à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité, ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau, en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique.
L'OFB dispose de compétences étendues et intégrées ainsi que de leviers d'action complémentaires, notamment avec la police de l'environnement et la police sanitaire de la faune sauvage, la connaissance, la recherche et l'expertise sur les espèces, les milieux et les usages, l'appui aux politiques publiques, la gestion et l'appui aux gestionnaires d'espaces naturels et la mobilisation des acteurs et des citoyens.
Au-delà des 3 000 agents qui œuvrent au sein de l'OFB, l'organisme dispose également de possibilités financières pour soutenir ses actions sous l'autorité de ses tutelles, à savoir le ministère de l'environnement et le ministère de l'agriculture. L'OFB mène ainsi une politique ambitieuse de financement et de contribution à divers programmes, qu'il s'agisse de subventions ou de programmes de recherche.
Ce programme d'intervention vise à soutenir la conception et la mise en œuvre de politiques publiques ainsi qu'à renforcer et accélérer la mobilisation des territoires, des acteurs et des citoyens pour opérer des changements profonds. L'OFB soutient également des projets dans des aires protégées. Je pense d'ailleurs, monsieur le président, que vous êtes particulièrement sensible au parc naturel marin de Mayotte, service qui relève de l'OFB et de ma direction. L'objectif est de faire de ces aires protégées des territoires d'expérimentation et de déploiement des stratégies thématiques de l'OFB, tout en renforçant les réseaux d'aires protégées.
De plus, l'OFB appuie des projets contribuant aux obligations de surveillance des écosystèmes et de qualité des eaux souterraines, de surface et littorales. Il contribue également au financement de la connaissance et de la recherche sur les milieux aquatiques, marins et terrestres, ainsi que sur les espèces. Enfin, il soutient le développement des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement en outre-mer ainsi que l'amélioration des efforts de communication, de connaissance, de préservation et de restauration de la biodiversité ultramarine.
Les territoires ultramarins présentent une grande diversité environnementale et la création de l'OFB s'est accompagnée de la création d'une direction des outre-mer, dont j'ai la charge. Cette direction est le point focal de l'OFB pour les territoires ultramarins et est chargée de déployer la politique de l'établissement dans ces régions ainsi que d'adapter ou de développer des politiques spécifiques aux outre-mer.
Actuellement, cette direction compte plus de 210 membres, avec huit nouveaux recrutements prévus pour ce premier trimestre 2024. L'effectif se répartit entre 52 % de femmes et 48 % d'hommes, tandis que l'âge moyen s'élève à 38 ans. 190 personnes sont basées en outre-mer, car nous avons choisi délibérément qu'un maximum d'entre elles soit au contact des besoins et des connaissances. Parmi ces 190 personnes, 45 sont des inspecteurs de l'environnement et réalisent des missions de police de l'environnement. La direction des outre-mer est représentée dans neuf territoires, est répartie au sein de 24 résidences administratives et couvre huit des douze fuseaux horaires du territoire français et sept codes de l'environnement.
La direction des outre-mer est basée à Vincennes et organise les missions des services, qui comptent plus de 200 agents répartis dans cinq services départementaux et un service en collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon chargés de police de l'environnement. Elle dispose également de cinq délégations territoriales, présentes en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie – couvrant également Wallis-et-Futuna –, aux Antilles – couvrant également Saint-Barthélemy et Saint-Martin –, en Guyane et dans l'océan Indien – pour Mayotte et La Réunion. De plus, la direction gère les deux plus grands parcs naturels marins de France, à savoir ceux de Mayotte et de Martinique, ainsi que le sanctuaire Agoa pour la protection des cétacés aux Antilles.
Par ailleurs, des services spécialisés dans la connaissance des espèces et des milieux en outre-mer mènent des travaux de recherche et de préservation, notamment sur les espèces chassables ou les tortues en Guyane dans le cadre du plan national d'action.
Le budget alloué à la direction pour l'année 2024 s'élève à 52,5 millions d'euros et deux caractéristiques spécifiques de la direction sont définies dans le code de l'environnement : le soutien financier à travers l'attribution d'aides financières et, en particulier, à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques. Plus concrètement, l'OFB finance les besoins en eau et en assainissement en outre-mer, en mobilisant des montants nécessaires pour ces infrastructures. Le budget annuel pour ces projets se situait entre 20 et 22 millions d'euros auparavant. Toutefois, à la suite de l'annonce sur la résilience de l'eau par le Président Macron en mars dernier, ce budget va être doté à terme de 35 millions d'euros supplémentaires, cette année étant une année de transition avec 15 millions d'euros supplémentaires. Par conséquent, 55 millions d'euros seront disponibles pour financer l'assainissement et l'eau en outre-mer, ce qui représente un effort considérable et nécessaire. Nous avons également revu les dispositions pour faciliter le financement de projets d'eau et d'assainissement, notamment en élargissant les critères d'éligibilité et en augmentant les taux de financement.
Par ailleurs, nous avons reçu des dotations supplémentaires pour le financement de la biodiversité, portant le budget total à 52,5 millions d'euros cette année et à 65 millions d'euros à partir de 2025. En outre, la loi nous dit que nous pouvons mener, dans le cadre de conventions, des actions spécifiques à la demande dans les collectivités de Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en apportant un soutien technique et financier si nécessaire.
Il est généralement dit que l'outre-mer abrite 80 % de la biodiversité française, mais nous ne savons pas si ce chiffre, bien que couramment utilisé, est vrai. Il s'agit d'une extrapolation basée sur certains groupes d'espèces et le nombre croissant de découvertes annuelles. Cependant, en prenant en compte les chiffres stricts, 108 151 espèces sont décrites en métropole, contre 98 534 en outre-mer. Toutefois, 80 % des nouvelles espèces découvertes ces dernières années proviennent des territoires d'outre-mer. Si les efforts de recherche se poursuivent, il est probable que l'outre-mer dépasse largement la métropole.
Ces régions sont réparties entre les différents océans – Atlantique, Pacifique, Indien – et abritent une biodiversité unique en raison de leur isolement géographique, de leurs conditions climatiques particulières et de la diversité des écosystèmes. Les territoires d'outre-mer sont connus pour leur grande richesse d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. On dénombre ainsi 18 480 espèces endémiques en outre-mer, parmi lesquelles certaines ne sont présentes que sur un seul territoire, voire une seule commune. Certaines espèces sont donc en très grand état de fragilité. De plus, les espèces endémiques sont plus importantes dans les îles que sur le continent, car elles y ont évolué de manière séparée. Par conséquent, plus une île est ancienne, plus il est probable que son taux d'endémisme soit élevé. Par exemple, environ 30 % des espèces de la Nouvelle-Calédonie sont uniques au monde. En outre, l'endémisme est généralement plus important chez les espèces terrestres que chez les espèces marines en raison de l'ouverture du milieu marin.
Les territoires ultramarins sont des écosystèmes variés, avec des forêts tropicales, des récifs coralliens, des mangroves, des savanes en Guyane et des habitats marins. Chaque système a ses propres caractéristiques et, par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon abrite la seule forêt boréale française. Avec ses 54 000 kilomètres carrés de récifs coralliens répartis sur trois océans, la France héberge 10 % de la surface mondiale des récifs coralliens et est le quatrième pays corallien du monde.
Toutefois, nos territoires ultramarins subissent des pressions anthropiques, c'est-à-dire humaines. Malgré leur importance écologique, de nombreux écosystèmes des outre-mer français font face à des pressions fortes, avec la destruction de zones humides, la déforestation, l'urbanisation, la pollution, la surpêche et les changements climatiques.
À Mayotte, la densité de population atteint près de 815 personnes au kilomètre carré, contre 14,5 pour la Nouvelle-Calédonie et 3,4 pour la Guyane. Cependant, cette densité de population n'est pas un critère absolu de risque de dégradation. Ainsi, en Guyane, l'orpaillage illégal qui porte sur des territoires très peu peuplés cause de graves dommages environnementaux aux cours d'eau, de la déforestation et de la pollution par des métaux lourds. Cette pollution entraîne ensuite des répercussions sur les populations indigènes.
Ces territoires sont aussi très sensibles au changement climatique, avec l'élévation du niveau de la mer, des tempêtes tropicales – qui sont de plus en plus fréquentes – et l'acidification des océans, qui ont des répercussions graves sur la biodiversité. Vous avez tous en mémoire le récent cyclone Belal à La Réunion, l'activité sismique à Mayotte et la sécheresse de ces derniers mois. Les phénomènes de submersion sont quant à eux de plus en plus fréquents, comme en témoigne la récente dégradation de l'isthme de Miquelon-Langlade sous l'assaut de la mer. De plus, les discussions sont engagées quant aux déplacements potentiels de la commune de Miquelon-Langlade, confrontée à une urgence climatique et menacée par une possible immersion dans les années à venir. Un problème similaire se pose en Guyane, notamment avec le village d'Awala-Yalimapo, dont le territoire abritait l'un des plus grands sites de ponte de tortues vertes. Ces exemples illustrent la multiplication des effets du changement climatique sur les populations, leur environnement, voire même sur la survie des écosystèmes et des populations.
Concernant les richesses spécifiques des outre-mer, un outil important a été développé avec le soutien des ministères des outre-mer et de l'environnement : les compteurs de la biodiversité en outre-mer. Ils permettent d'informer et de mobiliser autour de la richesse des outre-mer. Nous nous efforçons de collecter un maximum de données et, par exemple, 555 nouvelles espèces sont décrites en outre-mer chaque année. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on recense environ 2 000 phoques, qui forment la plus grande population de phoques en France. De plus, 80 % des territoires ultramarins sont couverts de forêts, tandis que 29 % des récifs coralliens y sont en diminution et que 25 % des mangroves nationales font l'objet de mesures de conservation.
Chaque territoire ultramarin dispose de son propre compteur et nous avons des exemples de restauration, de renaturation et de bonnes pratiques. Cet outil a été déployé au congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et est géré par une équipe de PatriNat, qui est une unité mixte entre le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et l'OFB. Il constitue un outil essentiel pour informer et sensibiliser à la richesse de la biodiversité dans les outre-mer. Par exemple, 10 189 mollusques sont décrits en outre-mer et, bien qu'on se focalise souvent sur des espèces emblématiques, la richesse provient de tout l'écosystème qui agit en interdépendance. En conclusion, ces territoires sont riches et variés, mais également vulnérables au changement climatique et victimes de dégradations.

Je vous remercie pour ce panorama assez complet de l'action de l'OFB. Le but de cette commission d'enquête est d'analyser les risques qui pèsent sur nos territoires, d'évaluer dans quelle mesure nos politiques actuelles permettent de les prévenir ainsi que de les gérer et de comprendre comment l'activité humaine et les politiques de notre société contribuent à ces risques.
Je constate que votre direction compte près de 200 agents et que 55 millions d'euros sont dédiés au financement des systèmes d'assainissement, répondant ainsi à des besoins pressants. Sous un précédent mandat, j'ai été membre de la commission d'enquête sur l'eau, où nous avons pu constater, notamment en Guadeloupe, l'état désastreux des réseaux. Dans ce contexte, les moyens attribués vous paraissent-ils appropriés à l'enjeu au vu des 3 000 agents que compte l'OFB et alors que 80 % de la biodiversité se trouve sur ces territoires ?
Ma deuxième question porte sur l'impact des risques majeurs sur la biodiversité, étant donné que plusieurs témoignages évoquent une intensification des phénomènes extrêmes plutôt qu'une accélération. Dans quelle mesure cela peut-il affecter la biodiversité ? Nos activités, telles que l'aménagement du littoral, exacerbent-elles les dangers pour la biodiversité ? Et inversement, la biodiversité peut-elle nous protéger des risques majeurs ?
Enfin, le déclenchement de catastrophes naturelles peut-il nous mettre en danger en regard de la biodiversité ? Par exemple, est-il possible que des risques naturels entraînent l'émergence de maladies parce que nous serions trop en contact avec des environnements où la biodiversité présente des risques pour la santé humaine ?
Ces questions sont très vastes et je tenterai d'y répondre en mobilisant l'exemple des récifs coralliens. Une étude de l'Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) de 2016 souligne que les récifs coralliens contribuent chaque année à hauteur de 1,3 milliard d'euros aux économies des neuf collectivités d'outre-mer. En effet, en générant une économie reposant sur 12 000 entreprises, ils soutiennent 50 000 emplois et environ 175 000 ménages qui dépendent directement ou indirectement de leur existence. Les récifs coralliens offrent également des avantages non négligeables, notamment en matière de tourisme. Ils constituent donc un pilier économique essentiel. Sur le plan mondial, environ 20 % des récifs et des écosystèmes associés ont été irrémédiablement détruits au cours des dernières années sous l'effet de pressions anthropiques et naturelles. Parmi les 80 % restants, seuls 30 % seraient dans un état satisfaisant.
En outre, les récifs coralliens absorbent une grande partie de l'énergie des vagues, réduisant les dommages sur les aménagements littoraux lors des évènements météorologiques extrêmes. Ils sont donc source d'économies importantes, évaluées à 595 millions d'euros chaque année si je ne me trompe pas. Il s'agit d'indemnités naturelles gratuites et nous ne nous rendons pas compte que ce patrimoine nous fournit des ressources. En cas de poursuite de la dégradation des coraux, des conséquences significatives se feront ressentir sur le littoral, telles que l'absence de pêche, car ces récifs abritent un ensemble considérable de faune et de flore. Cependant, la pêche dans les récifs coralliens fait vivre plus de 6 millions de personnes à travers le monde et représente une valeur économique de 6,8 milliards de dollars par an, dont 215 millions pour les outre-mer français. Lorsque les récifs coralliens se dégradent, la diminution de la population de poissons affecte l'ensemble de la chaîne alimentaire.
En outre, les récifs coralliens et les écosystèmes associés, tels que les herbiers et les mangroves, agissent comme puits de carbone et jouent un rôle important dans la régulation du climat. La valeur de ce service en crédits carbone a été estimée à 175 millions d'euros. De plus, les récifs coralliens constituent une économie du tourisme, le tourisme bleu étant basé sur l'usage récréatif des récifs – excursions, plongée sous-marine, découverte, plaisance, journée à la plage. Il a d'ailleurs été évalué à 315 millions d'euros.
Les récifs amènent aussi des progrès dans la recherche médicale. En effet, environ la moitié des recherches sur les médicaments contre le cancer sont basées sur des organismes marins, qui sont également utilisés dans le traitement de maladies telles que le paludisme et la dengue. En outre, un extrait d'une éponge des récifs des Caraïbes est utilisé dans un médicament contre le VIH. Toutes ces indemnités ont donc été évaluées par l'étude de l'initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor).
De plus, il existe des liens fonctionnels entre les différents écosystèmes, notamment les mangroves. Ces dernières réduisent les flux de sédimentation et de pollution provenant du bassin-versant, agissant ainsi comme un filtre naturel. Les mangroves atténuent également les vagues et les problèmes de pollution, tout en abritant de nombreuses espèces marines, telles que les crabes, qui constituent une importante source de nourriture pour les populations locales. Elles sont enfin des zones de nurserie et de croissance des juvéniles.
Les herbiers captent eux aussi le carbone et fournissent une source de nourriture pour des espèces telles que les tortues, qui constituent également une richesse touristique majeure dans de nombreux territoires ultramarins. De plus, le récif corallien amortit l'énergie des vagues et protège les herbiers et les mangroves, or ces habitats sont propices à la vie marine et à la reproduction ainsi qu'à l'alimentation de nombreuses espèces. Comme tout patrimoine naturel, il doit être entretenu, car il est très fragile.
En effet, le réchauffement climatique menace la survie des récifs coralliens, tandis que la pollution issue des systèmes d'assainissement défaillants constitue une menace supplémentaire. L'écoulement d'eaux usées non traitées sur les récifs entraîne une couche de boue qui étouffe leur fonctionnement et peut conduire à leur destruction. Plus précisément, ils vont être surfatigués par l'accumulation de ces différents facteurs, auxquels s'ajoutent la surpêche et la pollution directe.
Dans les territoires ultramarins, l'une des urgences correspond donc à garantir des systèmes d'assainissement conformes. Par exemple, sans ces systèmes de filtration naturelle, l'eau est moins purifiée, ce qui entraîne par exemple le déclassement de plage à la baignade et des conséquences néfastes pour l'industrie touristique locale. Dans ce contexte, le rôle de l'OFB consiste à fournir des conseils et de la méthode. Par le biais de stations de mesure et de programmes de formation, l'OFB contribue à évaluer et à surveiller la santé des récifs coralliens, tout en formant une nouvelle génération de plongeurs capables de collecter des données essentielles sur ces écosystèmes. L'OFB attribue également des subventions dans le cadre d'appels à projets ou de programmes d'intervention. Par exemple, des zones de mouillage écologique sont financées afin de prévenir les dommages causés aux récifs coralliens et aux herbiers par les bateaux locaux. Des opérations similaires sont en cours de planification en Nouvelle-Calédonie.
En outre, l'OFB apporte une technicité, comme pour la gestion des parcs marins, et capitalise sur des savoirs afin de conseiller des communes qui pourront installer elles-mêmes ces mouillages écologiques. L'OFB participe également à la création d'aires marines protégées et concourt à la diminution de la pollution en finançant des stations d'épuration, ce qui permet de protéger les milieux récepteurs. Nous avons en outre financé des projets pilotes visant à améliorer la résilience des récifs coralliens, notamment en Polynésie, en nous basant sur la résistance génétique, en rétablissant la pression d'herbivorie sous les algues, en arrachant les macroalgues envahissantes et en réalisant des bouturages de coraux.
Parallèlement, l'OFB s'engage dans le développement de méthodes innovantes de cartographie afin de mieux comprendre et protéger les écosystèmes marins, et ainsi accompagner la mise en place de nouvelles réglementations. L'objectif n'est pas de protéger les espèces ou les milieux, mais de garantir à l'humain un usage de la nature.
L'OFB exerce également des missions de police de l'environnement en collaboration avec d'autres services, sous l'autorité préfectorale, afin de faire respecter la réglementation et de limiter les impacts sur les milieux naturels. Par exemple, dans certains secteurs où la pêche sous-marine est excessive, elle peut être interdite. Les mouillages interdits doivent également être contrôlés, de même que la destruction, la capture d'espèces protégées, etc.
Enfin, l'OFB apporte son expertise dans les études d'impacts pour les services chargés de l'instruction de dossiers et de déclarations d'autorisation. Par exemple, nous pouvons être consultés sur la manière de limiter les impacts causés par les travaux sur les mammifères marins.

Je remarque que, dans la présentation que vous nous avez fournie, vous avez pointé les risques émergents : « L'émergence de maladies affectant la faune et la flore, qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, peut représenter une menace pour la biodiversité ». Est-ce également vrai dans le sens inverse ? Le fait d'attaquer le territoire de la biodiversité n'engendre-t-il pas des risques pour l'être humain, qui serait confronté à des espèces porteuses de virus ?
Mes capacités scientifiques sont insuffisantes dans ce domaine-là pour vous répondre. Toutefois, en plus de ses activités de police environnementale, l'OFB assure une surveillance sanitaire, ce qui lui permet de détecter l'apparition de nouvelles maladies chez les animaux. Par exemple, à La Réunion, des cas de maladies ont été observés chez certaines espèces d'oiseaux, se manifestant par un gonflement des pieds et conduisant à la mort. Je ne connais pas les causes exactes de ces maladies, mais il est possible de faire quelques suppositions.
En effet, lorsqu'un écosystème est fragilisé, il est plus sensible aux maladies, car sa résistance s'amoindrit. Les risques de voir apparaître des maladies augmentent dès lors que le système est fatigué, comme c'est le cas avec un corps humain. En effet, l'écosystème est agressé par plusieurs facteurs et se fatigue, ce qui entraîne sa fragilisation et son dysfonctionnement.
J'aborderai le sujet avec mes collègues spécialisés en surveillance sanitaire pour vous transmettre des exemples, notamment sur l'océan Indien.

Avant de conclure, j'aimerais revenir sur Mayotte, qui connaît une situation singulière, sans même évoquer la consommation d'eau. Cependant, je voudrais revenir sur l'assainissement, car vous avez évoqué les conséquences du manque d'assainissement, qui peuvent être considérables sur la biodiversité.
Par ailleurs, les collectivités de plus de 10 000 habitants sont tenues d'avoir des stations d'épuration. Or, lorsqu'on observe Mayotte qui regroupe environ 450 000 habitants, on constate qu'il n'y a qu'une seule station d'épuration qui fonctionne de manière aléatoire, tandis que trois autres qui ont été construites depuis plusieurs années ne fonctionnent pas. Cette situation donne l'impression d'un État extrêmement riche et capable de lancer l'argent par les fenêtres, alors qu'il s'agit d'une obligation. Des stations d'épuration ont été construites, mais les populations ne peuvent pas s'y raccorder, ce qui rend ces installations inutiles.
Est-ce que l'OFB est en mesure, par exemple, de subventionner les branchements pour permettre aux populations de se connecter ? En effet, 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et les coûts de raccordement s'élèvent entre 1 800 et 2 000 euros : par conséquent, il est évident que ces populations, notamment celles du centre, qui ont des revenus très faibles, voire inexistants, auront du mal à assumer ces frais.
Nous aurions donc investi dans la construction de la station, mais aucun branchement ne serait effectué. Est-ce une perspective envisageable ? Y a-t-il d'autres solutions à envisager à Mayotte pour encourager les raccordements ? Enfin, si nous ne sommes pas capables de faire fonctionner les trois stations construites depuis plusieurs années, il est difficile de justifier la construction de nouvelles installations.
Cette question pourrait nous amener à quelques heures de débat. Concrètement, les financements alloués sont très importants, mais le principal problème dans les outre-mer correspond au manque d'ingénierie. Il existe un besoin important en ingénierie, tant sur le plan technique, administratif que financier. L'argent ne manque pas et je gère un montant important de crédits pour l'OFB, soit environ 40 millions d'euros pour Mayotte. Cependant, le problème porte sur la consommation de ces crédits, ce qui demande des ingénieurs à demeure et des personnels administratifs. En outre, des personnes compétentes doivent rester sur le territoire et gérer ces dispositifs. Construire ne fait pas tout et nous avons connu des scandales de stations construites qui n'ont jamais fonctionné.
Les investissements ne font donc pas défaut. En outre, je crois que l'article L1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les départements d'outre-mer ne sont pas contraints à une participation minimale au financement de projets à hauteur de 20 %. Il est même possible d'obtenir un financement à 100 % et de nombreux financements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en sont proches, voire atteignent les 100 %, ce qui ne garantit toutefois pas le bon fonctionnement des installations.
Lorsqu'une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, nous avons le devoir de fournir un service tel que la distribution d'eau, même si ce service ne sera pas payé. Je pense que le modèle hexagonal où l'eau paie l'eau ne fonctionne pas dans certains territoires, car il nécessite que les habitants puissent la payer. Il est normal que l'État et l'Europe fournissent un financement conséquent, ce qui ne résout cependant pas le problème de gestion. Ma direction est assez étoffée pour gérer les aides qui nous sont demandées, mais nous ne recevons peut-être pas suffisamment de demandes de dossiers, car il faut des services d'ingénierie pour les supporter. De plus, les collectivités doivent disposer de suffisamment de cadres pour monter, constituer et suivre les dossiers. Par ailleurs, il faut des entreprises locales pour réaliser les travaux nécessaires, car les prix sont parfois excessifs en outre-mer en raison de la plus grande faiblesse de la concurrence et du besoin d'importation des matériaux.
Cette réalité a été particulièrement visible lors du plan de relance, qui a été limité par la capacité d'entreprendre. Même si des fonds importants sont disponibles, ils ne résolvent pas les problèmes liés à la disponibilité des cadres. Il existe donc un problème lié à l'ingénierie résiliente et permanente dans ces territoires, même si l'OFB a augmenté ses taux.
Par ailleurs, nous avons proposé en tant que techniciens à nos élus au Conseil d'administration de voter le principe d'un système d'aide exceptionnelle en cas de crise. Auparavant, il fallait passer par le Conseil d'administration pour chaque décision afin de voter un système dérogatoire, ce qui pouvait prendre du temps. Désormais, il est donné à la commission des interventions, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 185 du programme d'intervention 2023-2025, la possibilité d'approuver une dérogation expressément motivée et circonscrite dans le temps et dans l'espace, permettant d'appliquer exclusivement, pour des études et des scénarios d'urgence, un taux de subvention de 80 % de l'assiette des dépenses éligibles. En cas de catastrophe ou de situation de crise imprévisible et irrésistible imputable aux évènements climatiques ou géologiques extérieurs ayant touché les biens de la collectivité territoriale, l'OFB peut déroger automatiquement à son dispositif pour apporter rapidement des aides d'urgence jusqu'à 80 % d'aides.
Concernant la question des branchements, l'OFB ne finance pas cette partie des ouvrages, le dispositif d'aides étant limité aux ouvrages sur le domaine public. Cependant, il existe d'autres acteurs que l'OFB.

Je vous remercie pour cette réponse et j'espère que nous trouverons une autre solution. En effet, il est inutile de construire des stations qui ne fonctionnent pas. Je vous remercie pour votre intervention et n'hésitez pas à nous envoyer des documents complémentaires.
L'audition s'achève à dix-neuf heures quinze.
Membres présents ou excusés
Commission d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer
Réunion du jeudi 1er février 2024 à 14 heures
Présents. – Mme Nathalie Bassire, M. Xavier Batut, Mme Florence Goulet, M. Frantz Gumbs, M. Mansour Kamardine, Mme Sophie Panonacle, M. Julien Rancoule, Mme Laetitia Saint-Paul, M. David Valence, M. Guillaume Vuilletet.