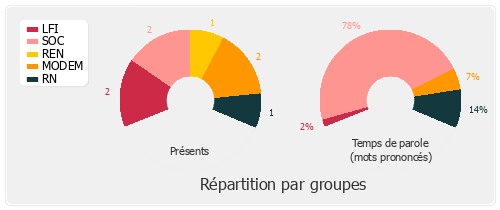Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire
Réunion du mercredi 18 octobre 2023 à 14h20
La réunion
Mercredi 18 octobre 2023
La séance est ouverte à quatorze heures vingt-cinq.
(Présidence de M. Frédéric Descrozaille, président de la commission)
La commission entend lors de sa table ronde sur le machinisme :
- M. Xavier Reboud, directeur de recherche, chargé de mission auprès de la direction scientifique Agriculture de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et vice-président de RobAgri ;
- Mme Anne Fradier, secrétaire générale du Syndicat national des entreprises de services et distribution du machinisme agricole, d'espaces verts et des métiers spécialisés (SEDIMA) ;
- M. Philippe Martinot, secrétaire général de Fédération nationale des coopératives d'utilisation du matériel agricole (FNCuma), accompagné de M. Stéphane Chapuis, responsable du service AGroEcoTech, en charge des questions environnement, agroéquipement et économie ;
- M. Laurent de Buyer, directeur général de l'Union des industriels de l'agro-équipement (AXEMA).

Nous reprenons nos travaux de notre commission d'enquête sur l'échec des politiques publiques de réduction de l'impact et des usages des produits phytopharmaceutiques.
Nous accueillons des représentants d'un secteur tout à fait déterminant pour notre sujet, bien que nous n'en parlions probablement pas assez souvent. Vous représentez les outils, les moyens techniques qui sont utilisés dans la conduite de cultures, notamment pour le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Je suis ainsi heureux d'accueillir pour cette table ronde des représentants du Syndicat national des entreprises de services et de distribution, du machinisme agricole, d'espaces verts et des métiers spécialisés (Sedima), de la Fédération nationale de la coopérative d'utilisation de matériel agricole (FNCuma), de l'Union des industriels de l'agroéquipement (Axema), ainsi que M. Reboud, directeur de recherche à l'Inrae et spécialiste de ces questions.
Je vous rappelle, avant de vous laisser la parole, que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Je vais vous demander prêter serment, de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
(Mme Anne Fradier et MM. Philippe Martinot, Stéphane Chapuis, Laurent de Buyer et Xavier Reboud prêtent successivement serment.)
Le Sedima est, comme vous l'avez dit, l'organisation professionnelle nationale qui regroupe les distributeurs et réparateurs de matériels agricoles. On parle assez généralement de concessionnaires, mais il s'agit vraiment de tout l'équipement pour les agriculteurs.
Où nous situons-nous au niveau professionnel ? Vous avez les constructeurs, les clients et nous sommes au milieu, c'est-à-dire que nos adhérents achètent le matériel aux fournisseurs en fonction des besoins des clients. Ensuite, ils le vendent et surtout, ils assurent une fonction assez déterminante, celle du service auprès des agriculteurs, en faisant en sorte que le matériel fonctionne, notamment en période de récolte.
Nous sommes sur tous les segments de l'agriculture, que ce soit la grande culture, la polyculture, l'élevage, le vitivinicole ou l'irrigation. Nous représentons à peu près 40 000 salariés sur toute la France et 2 700 entreprises, avec un service de proximité très important auprès des agriculteurs. Nos concessions peuvent aller d'une taille moyenne de vingt ou trente salariés jusqu'à trois cents salariés, mais toujours répartis sur plusieurs sites.
Pour nous, l'intervention chez l'agriculteur ne doit pas dépasser une heure, une heure et demie. C'est vraiment un impératif de délai. Je dirais que notre profession est très flexible puisqu'elle s'adapte aux besoins des agriculteurs. Au fur et à mesure des années, il y a toujours eu cette volonté de s'adapter aux besoins des clients et d'offrir des matériels qui correspondent à leurs attentes. Apporter une solution aux agriculteurs est la raison d'être de notre métier et nous savons qu'aujourd'hui, les enjeux sont très forts.
Les agroéquipements représentent à peu près 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le matériel neuf et d'occasion – pour vendre du matériel neuf, il faut reprendre un matériel d'occasion. C'est extrêmement important pour comprendre comment fonctionnent les agroéquipements et quel est le besoin des agriculteurs. Cela couvre le service magasin, pour les pièces détachées, et également tous les services administratifs et commerciaux.
Tout d'abord, merci pour cette invitation, que nous considérons comme une reconnaissance vis-à-vis de nos groupes Cuma présents sur tout le territoire.
Nous savons aujourd'hui l'importance des enjeux qui nous attendent s'agissant de la qualité de l'eau, du sol, de l'air, qui supposent des changements de pratiques. Les Cuma sont parties prenantes aux échanges sur les méthodes au sein des territoires, lesquels doivent faciliter les transitions. Nous appelons cela, au sein de notre réseau, la mécanisation responsable.
Je laisserai à mes collègues le soin d'approfondir davantage les technologies que pourront apporter à cette transition les matériels de demain. Je vais, pour ma part, vous exposer ce que font les Cuma. Je vous livre quelques chiffres clés. Notre réseau représente aujourd'hui 10 000 Cuma. Un agriculteur sur deux, soit à peu près 195 000 agriculteurs, adhère à une Cuma. Les Cuma représentent 5 000 salariés, essentiellement des chauffeurs mécaniciens. Leur chiffre d'affaires annuel s'établit à 670 millions d'euros. Elles investissent un peu plus de 500 millions d'euros dans l'agroéquipement. La taille moyenne d'une Cuma en France est d'environ 23 adhérents, pour un chiffre d'affaires de 66 500 euros et un investissement moyen de 92 000 euros chaque année.
Il est important de souligner qu'en 2023, 34 % des Cuma proposent au moins un matériel de désherbage mécanique ou alternatif, comme des herses étrille, des bineuses ou des écimeuses.
Les Cuma, ce sont avant tout des hommes. Nous sommes reconnus comme des groupes d'échanges entre pairs autour de la machine. Pour nous, le recours au collectif implique le partage. Notre réseau permet également d'accompagner les groupes d'agriculteurs sur la bonne utilisation de ces matériels. Nous sommes acteurs et parties prenantes des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) également, ainsi que, dans une moindre mesure, des groupes 30 000. Pourquoi y sommes-nous un peu moins présents ? Parce que le taux de financement reste assez faible au regard de l'obligation de résultat, dans un domaine qui ne travaille que sur des temps longs.
Nous sommes donc des facilitateurs économiques, en nous regroupant pour pouvoir diminuer nos charges de mécanisation et bénéficier d'une moindre mobilisation de capitaux. On se plaît à dire que pour 10 000 euros de parts sociales, on a souvent accès à l'équivalent de 300 000 ou 400 000 euros de matériel agricole. Nous sommes également un facilitateur de l'atterrissage des technologies par une mutualisation donnant accès à du matériel plus efficient.
Je suis directeur général d'Axema. J'ai dirigé dans une autre vie une société de pulvérisation. J'ai été président du groupe « produit marché protection des cultures », anciennement au syndicat, de 2013 à 2018, et j'ai participé à la mise en route du contrat de solutions en 2017.
Notre syndicat rassemble 230 adhérents, dont 190 fabricants et importateurs, qui représentent 93 % du chiffre d'affaires de l'agroéquipement en France. Ce sont environ 25 000 salariés.
Dans les 13 milliards d'euros cités par Mme Fradier, 9 milliards concernent les ventes de matériel neuf, dont 75 % sont importés, ce qui fait qu'on a une balance commerciale largement déficitaire : 2 milliards d'euros en 2022. La production des cultures représente 190 millions d'euros d'investissements chaque année, avec à peu près un millier de salariés dans l'activité. En tout, 40 % de cette fabrication part à l'export. Environ 2 300 machines ont été immatriculées en 2022.
La France est le deuxième producteur de matériels de protection des cultures, avec douze sites de production. Les acteurs majeurs de cette activité en France sont des sociétés étrangères, Amazone, Kuhn ou encore Tecnoma pour la France.
L'ensemble de toutes ces données économiques figure dans un rapport disponible sur notre site. Il est publié chaque année.
Notre syndicat participe toujours au contrat de solutions. Nous sommes également mobilisés dans le cadre de la construction du règlement européen SUR. Nous avons par ailleurs lancé un cas d'usage sur les données numériques de pulvérisation cette année, en liaison avec Numagri, de façon à recueillir ces données, les analyser, regarder si elles sont standardisées ou standardisables, pour voir ce que l'on peut en déduire par la suite. Cela fait partie d'un plan plus large sur la gestion des données dans l'agriculture.
Comme je le disais, notre syndicat intègre un groupe « produits marchés protection des cultures » qui réunit l'ensemble des fabricants et importateurs pour réfléchir à ce qui peut être fait pour améliorer la situation et en particulier répondre à la réglementation lorsque celle-ci arrive de Bruxelles.
Parmi les enjeux de la filière, y compris dans la partie épandage et pulvérisation, je cite la décarbonation, le numérique, le partage de l'information, la diffusion des technologies dans le marché. Ce n'est pas toujours très simple, quand on a la technologie, de faire en sorte qu'elle arrive chez l'agriculteur, pour différentes raisons. C'est aussi le prix des machines, parce que nous avons été fortement impactés ces dernières années par la disponibilité des matières premières. Le prix de nos matériels délivrés a ainsi augmenté de façon importante.
L'utilisation des machines est un autre enjeu important. Aujourd'hui, il existe un parc d'environ 285 000 pulvérisateurs recensés, selon une estimation Agreste de 2014. Sur ce total, l'organisme en charge du contrôle, OTC Pulvé, estime à environ 100 000 le nombre de pulvérisateurs qui n'ont jamais été contrôlés, alors que la réglementation impose un premier passage dans les cinq ans. Or, environ 20 % des appareils qui passent le contrôle doivent repasser une deuxième visite parce qu'un défaut majeur a été détecté sur la machine. Ainsi, quand on parle d'utilisation, il est important de voir qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de respecter les instructions d'utilisation des produits qui sont sur les étiquettes ; il faut aussi les appliquer avec un résultat correspondant à ce que l'on voulait faire.
Dans le domaine des agro-équipements, la recherche amont et aval est essentiellement faite par les fabricants eux-mêmes. Les techniques de pulvérisation mises sur le marché aujourd'hui, qu'elles fassent appel à l'intelligence artificielle ou à de la vision artificielle, ont été développées par les fabricants. Certaines briques ont pu être développées dans des centres de recherche ou ailleurs mais elles sont assemblées par les fabricants.
Dans ce domaine, nous constatons un réel manque de recherche fondamentale sur la goutte. C'est vraiment un sujet, parce qu'apporter une goutte chargée d'un produit au bon endroit sur une plante avec la bonne taille et avec le bon effet est en réalité extrêmement complexe. Il y a certes un problème de distribution mais, avant tout, il faudrait comprendre les phénomènes qui sont la base de cette technique.
Un enjeu important est la formation de nos clients agriculteurs, laquelle est dispensée parfois par les constructeurs, souvent par les concessionnaires et malheureusement, derrière, passe très souvent par le reste des organisations – je ne fais de procès à personne.
Je mentionnerai aussi l'enjeu des nouvelles technologies d'application – aujourd'hui, nous considérons que les subventions, lorsqu'elles sont données, ne vont pas forcément au bon endroit et avec la bonne massification.
Je terminerai sur l'enjeu du partage des bonnes pratiques, appuyées ou pas sur le numérique. L'injection directe est l'une des solutions pour diminuer sensiblement les utilisations de produits phytosanitaires. À plus long terme, il faut aussi parler de la détection de maladies robotisée, de l'utilisation de la robotique dans nos technologies.
Outre mes fonctions à la direction scientifique agriculture, j'ai aussi rapporté sur les analyses des alternatives à différents produits sur la sellette, le glyphosate, le prosulfocarbe, le S-métolachlore. J'ai vu, à cette occasion, les alternatives que les agriculteurs pouvaient mobiliser. L'association RobAgri, dont je suis vice-président, travaille sur le développement de la robotique agricole ; elle est porteuse du grand défi robotique.
Pour préparer cette audition, je me suis appuyé sur un certain nombre de documents qui sont tous disponibles sur Internet. Nous avons constitué des dossiers dédiés sur les agroéquipements et leur place dans l'agroécologie. Nous avons beaucoup travaillé la question de l'ensemble des leviers, dont le levier du machinisme, pour la préparation du programme prioritaire de recherche « Cultiver et protéger autrement ». Nous avons consacré un numéro de la revue Ressources à « Réduire les pesticides un peu, beaucoup, résolument. » Nous avons aussi publié un livre intitulé « Zéro pesticide ». Je peux également citer le livre blanc réalisé avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) sur la place du numérique dans une agriculture durable. Nous avons des prospectives sur la projection de l'agriculture à l'horizon 2050 et avons travaillé sur l'agrotechnopôle de Montoldre, dans l'Allier, considéré comme un lieu où l'on peut discuter entre acteurs de la recherche professionnels.
Je dirais juste, en termes en termes d'introduction, que les agroéquipements sont le passage obligé de toute action agricole. Il y a de nombreux leviers qui permettent de diminuer la dépendance aux produits phytosanitaires, que ce soit le choix variétal, l'approche biologique par le biocontrôle ou les infrastructures agroécologiques, les pratiques agronomiques ou la lutte chimique, mécanique et physique. Les pesticides ne sont qu'un levier parmi d'autres. En revanche, pour l'agriculteur, le machinisme, c'est le passage obligé qui rend possible ou pas le déploiement de certaines de ces pratiques.
Je donne quelques illustrations concrètes de la place des agroéquipements dans la réduction des produits phytosanitaires, à travers les dossiers que nous avons étudiés. Pour réduire l'usage du glyphosate, l'utilisation du désherbage mécanique ressort comme le levier numéro un. Dans le cas du S-métolachlore, l'application d'un herbicide sur des cultures à large écartement permet de gérer de manière différente le rang et l'entre-rang. On peut ne traiter que de manière localisée sur le rang. C'est le choix qu'a porté le Luxembourg. Dans le cas du prosulfocarbe, et concernant les pommes de terre, on peut travailler avec des approches mécaniques de butage et d'hersage, ou de passage de herse étrille pour les grandes cultures.
Si l'on fait un bilan de l'utilisation de ces alternatives, ce qui remonte assez clairement, c'est qu'elles sont toutes considérées comme étant plus techniques. Elles génèrent des chantiers plus lents, elles sont plus aléatoires selon la fenêtre météorologique et potentiellement plus chères. Ainsi, le choix des alternatives peut avoir un impact sur le temps passé, les énergies fossiles utilisées ou l'émission de gaz à effet de serre.
Dans nos différents rapports technico-économiques sur l'adoption des alternatives par les agriculteurs, nous avons ainsi constaté qu'en moyenne, il y avait un coût à se passer des produits phytosanitaires. Pour sortir du glyphosate, nos estimations vont ainsi de 10 à 80 euros de surcoût à l'hectare pour les grandes cultures et de 120 à 400 euros pour les cultures pérennes.
Nous ne disposons pas toujours d'un recul très important sur la part de ces surcoûts, qui peuvent être compensés par d'autres innovations technologiques. Nous partons d'une situation où les pesticides sont le système de base et le paradigme dominant. Nous essayons de basculer vers quelque chose qui est souvent moins connu, moins travaillé, sur la base de petites séries et nous ne bénéficions pas de l'apprentissage, des économies d'échelle, du cadre qui permettent de s'assurer qu'on utilise toutes ces solutions dans les bonnes conditions.
La situation vers laquelle on se dirige est toujours moins connue et moins adaptée ou moins performante au temps zéro que celle qu'on abandonne, sauf si on change les critères pour évaluer les performances.
Que fait la recherche ? Beaucoup de choses. D'abord, peut-être, elle quantifie les métriques de l'évaluation. Une équipe de l'Inrae s'est portée volontaire pour essayer de proposer un label performance « pulvé », afin d'avoir une évaluation quantifiée, qualifiée de la qualité des pulvérisateurs. Nous misons beaucoup sur les actions préventives, notamment à travers des approches de piège, de tests, de dispositifs expérimentaux pour pousser plus loin ces logiques dans les principales filières. Nous pensons qu'il est important de tirer profit du numérique pour accroître l'efficience des interventions, car le numérique permet en théorie de réaliser des économies en approchant de la solution la plus efficiente possible. Mais nous restons quand même convaincus qu'il va falloir produire dans des paysages qui seront, demain, plus complexes, plus diversifiés, sans rendre impossible le travail de l'agriculteur. Il faut donc accompagner ces démarches par des outils qui permettent de simplifier.
Dans le cadre de mes deux mandats de président du comité scientifique d'orientation recherche et innovation, nous avons soutenu le développement du challenge « robotique et capteur au service Écophyto » (Rose). L'ambition était d'amener les équipes scientifiques à travailler sur les méthodes permettant de faire un désherbage, non pas dans l'inter-rang, ce que tout le monde sait assez bien faire, mais sur le rang, pour permettre d'atteindre un niveau où le désherbage mécanique autorise une gestion complète de la flore adventice dans les parcelles. Évidemment, ce n'est pas concentré sur le seul désherbage. Il y a d'autres travaux qui concernent bien sûr la lutte contre les insectes ravageurs ou contre les maladies.
Je dirais que la communauté scientifique est largement internationale et que ces questions sont reprises dans un certain nombre de projets européens.
L'Inrae est la fusion de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea). À l'Inra, il y avait un département mathématique, mais pas de département de sciences de l'ingénieur au sens du CNRS ou des écoles d'ingénierie. En revanche, l'Irstea avait cette compétence. On a donc laissé au monde industriel et ses grands groupes la force de frappe pour développer les avancées sur le machinisme. Nous sommes obligés d'y revenir, d'où la mise en place du dispositif de Montoldre dans lequel nous testons des prototypes sur des bancs d'essai et nous évaluons leurs performances. Nous sommes à même d'accélérer les processus d'amélioration de ces équipements-là, évidemment pour la pulvérisation, mais aussi pour d'autres secteurs importants de l'agriculture.
Dans nos travaux sur les agroéquipements, je dirais que nous mettons particulièrement l'accent sur les actions prophylactiques, en essayant de mettre en avant la nécessité de diminuer notre dépendance aux produits phytosanitaires à travers une réflexion générale sur l'importance de développer les leviers préventifs et pas seulement les leviers curatifs, selon l'adage « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Nous essayons ainsi de trouver tous les supports d'agroéquipement qui permettent cette prophylaxie. Il y en a dans tous les secteurs ; on peut notamment booster l'immunité des plantes, intercepter les semences d'adventice pour éviter qu'elles rejoignent le sol, travailler sur les outils de surveillance et décliner derrière des règles de décision associées pour que les agriculteurs puissent utiliser ces équipements dans les meilleures conditions.
Le grand défi robotique a bénéficié de 21 millions d'euros dans le cadre de France Relance. L'idée, c'est que, grâce aux robots, on peut faire travailler une machine 24 heures sur 24 sans forcément tasser les sols ; on peut leur donner des missions d'action préventive, consistant par exemple à éviter le démarrage des populations adventices en faisant un passage un peu systématique.
Que peut-on changer ? On peut mobiliser des services plutôt que l'achat des équipements pour que les agriculteurs trouvent de meilleurs prix. On peut travailler sur l'aide à l'achat. On peut apporter du numérique pour améliorer le confort. On peut travailler sur des références qui quantifient mieux les bénéfices attendus, notamment pour les actions préventives, avec une évaluation élargie, en fonction de critères environnementaux, sociaux et économiques. Et évidemment, on peut automatiser certaines choses pour gagner sur les coûts de main-d'œuvre des tractoristes.
Pour aller plus loin, on pourrait travailler sur la place du machinisme dans les cahiers des charges, qui ne sont en général pas connus. On pourrait aussi revenir sur les pratiques telles qu'elles sont menées dans d'autres pays européens. On pourrait aussi imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, on en profite pour l'intégrer dans l'ajustement des doses maximales applicables à l'hectare. On pourrait enfin élargir les critères pour qu'ils couvrent mieux les besoins d'une agriculture durable dans laquelle les pesticides auront nécessairement moins leur place.

Nous sommes heureux d'avoir un panel sur le machinisme au sens large. Je vais retenir tout de suite deux grandes familles ; d'une part, le matériel de pulvérisation, qui utilise la chimie ou d'autres produits pour soigner les plantes et, d'autre part, ce qui permet, notamment en matière de désherbage, de remplacer les pesticides, en l'espèce par le désherbage mécanique.
Je vous dis d'emblée que le rapport de 2014 que j'avais rendu avait été pour moi l'occasion de grandes découvertes, en particulier lorsque j'ai visité des sites de l'Irstea. J'avais été impressionné par la capacité de la technologie et des innovations à apporter des solutions, par exemple sur les canopées, sur les vignes. Je m'étais rendu compte que l'on pouvait réduire les impacts de façon considérable, par la qualité et l'innovation technologique.
Qui est donneur d'ordres aujourd'hui en matière d'innovation technologique ? Il y a la recherche publique et le marché. Le marché, ce sont des impasses auxquelles est confronté le monde paysan, les attentes en matière de protection de la santé, de protection de l'environnement. Il y a aussi la recherche. Se fait-elle en France ? Les labos privés sont en France, aux États-Unis, au Japon. Pouvez-vous nous faire une cartographie de l'innovation technologique ? Est-ce que la France, l'Europe sont maîtres du jeu ou est-ce qu'aujourd'hui, elles subissent plutôt, avec des centres de décision qui sont extracommunautaires ? L'Irstea a rejoint l'Inrae, c'était une belle intuition de restructuration d'instituts pour avoir ce continuum entre la recherche agronomique et les potentiels apportés par le machinisme. Quelle relation entretiennent les entreprises avec le monde académique ? De quelle manière vous parlez-vous ?
Les centres de recherche privés, si l'on parle des fabricants, sont répartis là où sont les fabricants. Dans la pulvérisation, on trouve une quinzaine d'acteurs majeurs. Je ne parlerai pas de la Chine parce que la Chine ne communique pas, même si c'est un énorme pays avec énormément d'épandages de produits phytosanitaires. La majorité des applications s'y fait par pulvérisateurs manuels, au backpack : on n'est pas dans la même technologie.
En ce qui concerne les dernières technologies comme le spot spraying – l'application localisée – les centres de recherche ont été répartis. Les sociétés ont à peu près toutes sorti les produits en même temps, à deux ans d'intervalle, parce que c'était lié à la capacité de la vision artificielle de détecter les plantes. Cette technologie est arrivée à peu près au même moment, via trois ou quatre opérateurs de vision artificielle.
Vous dites que la demande est tirée par le marché ; mais les fabricants savent tous qu'il faut réduire les produits phytosanitaires à l'avenir si l'on veut éviter de polluer le monde. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est délicat, c'est de réaliser des technologies qui sont accessibles aux agriculteurs, en termes de mise sur le marché, de réparations, de formations, etc. Avec ce critère, tout devient beaucoup plus complexe. Quand on regarde aujourd'hui un appareil de dernière technologie, ce que j'ai coutume d'appeler un sapin de Noël, ce sont des appareils automoteurs par exemple, qui valent 350, 400 000 euros. Si vous prenez un appareil traîné, on met à peu près 300 0000 euros sur la table. Ce sont des appareils que tout le monde ne peut pas se payer.
Ces centres de recherche sont plutôt répartis à travers le monde. Il existe un concurrent américain très important, qui fait 35 % de part de marché dans le monde. Il y en a ainsi une partie aux États-Unis, une bonne partie en Allemagne et un peu en France, parce qu'il y a quelques fabricants malgré tout, même s'ils n'ont pas l'importance qu'ils pourraient avoir. Nous ne sommes pas leaders en termes de recherche. Comme je l'ai dit, contrairement à d'autres pays, nous n'avons pas de recherche universitaire fondamentale sur certains phénomènes physiques ; sur la goutte, entre autres.
Pour ce qui concerne la relation avec la recherche, nous avons de très bonnes relations avec l'Inrae. Mais nous ne nous parlons pas au sens technique du terme. En dehors de nos partages institutionnels, il n'y a pas de formalisme dans la demande. L'Inrae, Arvalis ou l'Institut des sciences du végétal (ISV) font des constats. On les partage avec eux parce qu'on a participé aux essais, mais on n'a pas de demande formelle. Par exemple, on n'a pas de demande au niveau de la répartition des gouttes. Aujourd'hui, on parle tous de zones de non-traitement, de buses antidérive. Personne ne sait comment ça se qualifie. On sait dans les résultats, parce qu'on fait quelques mesures, que la buse permet de localiser à la pulvérisation et de ne pas trop en envoyer en l'air, mais c'est tout. Il n'y a pas de cahier des charges pour dire que la goutte, dans la ZNT, doit faire 300 microns et que la goutte sur le reste de la buse, en fonction de la température, doit faire de 100 à 250 microns. Tout cela n'existe pas. Il n'y a pas de requis scientifique. On est plus dans le cadre d'une expérimentation que dans le cadre d'une recherche.
On essaye, dans le cadre de notre syndicat, d'être assez ouvert sur toutes les innovations technologiques, puisque c'est le métier de demain pour nos techniciens. On a très tôt pris attache auprès de l'Inrae sur toutes les problématiques robotiques, justement pour savoir comment adapter les profils de formation. Quand vous vendez un matériel, il faut derrière assurer la maintenance et surtout transmettre l'usage du matériel, apprendre à s'en servir. C'est ce que font nos adhérents. Ce qui revient souvent parmi les remarques de nos adhérents, c'est que lorsque vous vendez une machine, vous faites la prise en main de la machine, vous donnez des explications à l'agriculteur, mais il ne s'en sert pas forcément tous les jours. Entre-temps, il peut avoir oublié ou il ne maîtrise pas forcément la technique. On s'est investi pour essayer de proposer aux agriculteurs des formations sur l'usage de ces appareils de plus en plus sophistiqués. Ce ne sont pas forcément les mêmes matériels selon du type de cultures. La pulvérisation dans la vigne, en grande culture ou dans le maraîchage, ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques ou la même façon d'aborder le sujet. Cela demande des formations assez ciblées, assez proches du terrain, parce qu'un agriculteur ne va pas venir à Paris pour se former. Il faut que ce soit assez proche.
Il faut aussi avoir des fonds dédiés. Quand on a proposé cela aux agriculteurs, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de budget de formation. Je pense que c'est bien de subventionner les machines, mais il faut aussi être attentif à ce qu'on aide à la diffusion du savoir et à la sécurisation des usages. Un agriculteur a besoin d'être sécurisé sur son matériel, de surcroît avec les enjeux de santé que vous mettez en avant.

Il est parfois compliqué d'apprivoiser le matériel. Il y a la recherche fondamentale en laboratoire, on produit une machine et il faut la mettre en place. Au niveau du réseau des Cuma, avez-vous déjà une réflexion notamment sur cette question de l'appropriation, de l'accessibilité, vu les coûts qui sont évoqués, dans les 300 000 à 500 000 euros pour des robots de taille importante ? Avez-vous déjà été confrontés à ces questions ? Avez-vous un retour d'expérience ?
Je reviendrai juste sur le débat antérieur. On parle beaucoup de l'optimisation de l'application de produits phytosanitaires et je ne veux pas que l'on oublie la substitution, en particulier via le désherbage mécanique. Nous sommes positionnés sur les deux, c'est-à-dire que les Cuma ne sont pas utilisatrices ou non-utilisatrices de produits phytosanitaires. On travaille à la fois avec des agriculteurs en bio et en conventionnel. On travaille ces techniques sous l'angle du déploiement, et pas à l'échelle de la recherche, même si on a des connexions régulières avec la recherche appliquée ou fondamentale. C'est notre métier historique de groupes d'agriculteurs qui se mettent ensemble pour réunir des moyens d'investissement et d'utilisation.
On est ainsi facilitateurs de l'atterrissage des technologies, qu'elles soient liées aux produits phytosanitaires ou portent sur d'autres sujets de la mécanisation. Entre autres, nous créons des références, nous faisons des démonstrations au champ, dans la parcelle d'un agriculteur, nous faisons de la formation, en action et en salle. Nous provoquons des échanges aussi ; et c'est presque dans ce domaine-là que l'on voit que cela fonctionne le mieux. Il n'y a pas mieux qu'un agriculteur pour parler à un autre agriculteur. On essaye d'avoir des gens expérimentés qui présentent à leurs collègues ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les points de vigilance.
On travaille aussi à l'émergence de solutions nouvelles, c'est-à-dire au-delà de la machine, dans sa mise en œuvre, dans son appropriation, dans son adaptation aussi à un certain nombre de productions. On voit qu'il y a quand même quelques impasses. Quand on travaille sur les grands domaines du blé, de l'orge et du colza, il y a un marché potentiel qui fait que les constructeurs s'y intéressent. Quand on va sur des productions plus marginales, qui pourtant sont nécessaires dans les systèmes, notamment dans une optique de diversification, on constate des trous dans la raquette.

Je termine cette question sur le continuum de recherche et de développement privé et public. Aujourd'hui, à l'Inrae, êtes-vous influents et producteurs d'innovations, êtes-vous un observateur qui alerte ? Vous avez eu un discours général sur les solutions, mais quel est votre rôle dans la fabrique des solutions ?
Effectivement, on a un certain nombre de brevets, notamment sur la pulvérisation confinée. Nous travaillons aussi sur l'analyse du signal en imagerie pour pouvoir apporter derrière un traitement localisé. Tous ces travaux sont réalisés dans des unités de l'Inrae, en lien avec des partenaires qui sont aussi adhérents d'Axema.
Notre travail consiste aussi à apporter un regard critique et objectif sur les performances atteintes par les équipements. Le travail de bancs d'essai permet ainsi d'évaluer les performances réelles en conditions des gros équipements, notamment à travers la définition de catégories, comme le label « Performances Pulvé », qui a pu permettre de qualifier un certain de nombre d'équipements dont les buses étaient porteuses d'améliorations substantielles pour la pulvérisation.
Monsieur Potier, vous avez choisi de restreindre les échanges au matériel de pulvérisation et de désherbage mécanique. Ce sont effectivement à mon sens les deux axes majeurs. Pour le premier, il s'agit d'améliorer les performances. Le désherbage mécanique implique une substitution. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travaux aussi à mener sur l'utilisation de plusieurs leviers à effet partiel dans une reconception plus large. C'est ce que font tous les jours les agriculteurs en bio. Nous devrions sans doute nous en inspirer pour l'agriculture conventionnelle.

Merci de nous le rappeler. Cependant, notre objectif est bien aujourd'hui de nous concentrer sur l'apport du machinisme, qui recèle des solutions vraiment innovantes.
Je vais vous poser deux dernières questions. La première, c'est la question de la santé. Pensez-vous que l'on est aujourd'hui dans un processus de sécurisation qui ne cesse de progresser, ou est-ce que de nouveaux risques peuvent apparaître avec les nouvelles technologies ? On connaît le vieux pulvérisateur et tous ses dangers pour la santé humaine. On a progressé dans la mise en œuvre, le numérique, on parle de drones, etc. Y a-t-il de nouveaux risques sanitaires qui pourraient apparaître, sur lesquels vous pourriez attirer l'attention de la commission d'enquête ?
J'ai aussi une question relative au coût économique et au carbone. Dès qu'on parle de désherbage, le contre-argument qui est donné, qu'il s'agisse du bio ou d'alternatives aux produits phytosanitaires, c'est le coût carbone. Pouvez-vous le quantifier et le relativiser par rapport à d'autres enjeux ? Comment cette question-là doit-elle être positionnée ?
Par ailleurs, il y a également le temps humain, le temps de travail. Vous avez donné quelques chiffres. La robotique va-t-elle permettre d'alléger la tension sur le travail humain, sous réserve qu'on trouve les moyens d'amortir les investissements que cela suppose ? À quelles conditions sociales d'utilisation ?
Il est difficile de répondre de façon courte. Y a-t-il de nouveaux dangers ? A priori non, ces dangers sont bien identifiés. Si l'on parle sécurité, il faut avoir en tête que la moitié des pulvérisateurs n'a pas d'incorporateur. Il y a 280 000 pulvérisateurs sur lesquels nous pouvons et devons agir.
En ce qui concerne le traitement mécanique des adventice, une étude a été faite l'année dernière par un alternant chez nous. Si l'on compare le ratio entre la largeur de la rampe – 24 à 36 mètre ou plus – et l'amplitude de l'appareil mécanique qui va traiter – 5 ou 6 mètres au plus – on voit bien qu'il va falloir passer entre quatre et six fois plus pour couvrir la même surface. Par ailleurs, il faut prendre en compte le tassement des sols, la dépense de gasoil et donc l'empreinte carbone que l'on va laisser. Le coût global d'un traitement mécanique est ainsi quatre fois plus élevé que celui d'un traitement chimique.
Je souligne que l'achat de matériels en collectif permet une diminution de l'impact carbone. Ainsi, un matériel acheté en Cuma profite en général à sept agriculteurs. Durant la vie de l'outil, si l'on considère sa construction, son utilisation et son démantèlement, on aura émis substantiellement moins de gaz à effet de serre.
On a lancé des travaux en lien avec l'agriculture de conservation des sols pour voir comment ils pouvaient se passer du glyphosate. Ces méthodes impliquent des essais sur des destructions de couverts par des rouleaux hacheurs, beaucoup moins consommateurs d'énergie. Il s'agit aussi de passer des lames de type scalpeur qui vont déplacer moins de volume de terres que les méthodes de désherbage mécanique. Il existe donc des solutions plus douces.
Je suis d'accord pour dire qu'il existe encore beaucoup d'équipements qui ne sont pas utilisés dans les normes les plus avancées de protection des personnes. On avait lancé, dans le cadre d'Écophyto, un travail sur l'exposition des ouvriers agricoles lorsqu'ils reviennent dans les parcelles. Il y a la période d'application, mais aussi le contact potentiel des gens avec du matériel de pulvérisation, qui est source de contamination. C'est une question qui, à mon sens, est complexe et qui mérite qu'on y regarde de plus près. Tout ne passera pas les zones de non-traitement.
Concernant la distribution, nous sommes alertés quant à la protection de nos propres salariés quand ils interviennent pour réparer les matériels. Nous manquons de visibilité sur l'impact qu'aura la robotique sur ces engins, et sur les règles qu'il faudra mettre en place pour sécuriser nos interventions.

Au moment de programmer les travaux de cette commission avec le rapporteur, il nous a paru évident qu'il faudrait parler machinisme. Vous êtes assez rarement autour de la table sur la question du modèle agricole, de sa transformation, de la transition écologique. Quels lien avez-vous avec les autres acteurs du conseil aux agriculteurs ? Je pense au conseil indépendant, aux chambres consulaires, aux coopératives ? En fait, ce qui se dessine au fil de nos auditions, c'est que tout le monde travaille un peu en silo. En matière de recherche, Monsieur Reboud, regardez-vous également les problématiques de la génétique et des semences, de l'usage des intrants en protection et en nutrition ? Vous êtes au carrefour de thématiques, par la question du calendrier agricole et des équipements. Dans quelle mesure parvenez-vous à englober l'ensemble de ces problématiques de manière transversale ?
Monsieur de Buyer, vous avez indiqué que pratiquement 100 000 pulvérisateurs ne sont pas contrôlés alors que 20 % de ceux que vous contrôlez nécessitent un deuxième passage. Que fait-on et quel est le niveau de conscience de tous les acteurs ? Je repense aux chambres consulaires et à tous les organismes qui sont autour des agriculteurs. Quel est le niveau de conscience sur l'impact des buses bouchées, d'une mauvaise pression ou d'une mauvaise orientation du pulvérisateur ? D'après vous, quels résultats pourrions-nous atteindre, en termes de réduction des usages et des impacts des pesticides, uniquement avec une meilleure formation, un meilleur usage des produits déjà existants ? Je ne parle même pas d'innovation technologique.
Nous avions répondu à cette question au moment du début des réflexions autour du contrat de solutions. A ce jour, en dehors de ce contrat de solutions, nous travaillons effectivement tous en silo. Nous avons des relations entre nous, mais qui ne prennent pas en considération le problème global. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'initiative, mais il n'y a pas de coordination. Nous nous sommes retrouvés avec une quarantaine d'organisations autour de la table. Nous avions cette opportunité et nous l'avons ratée. Le contrat de solutions continue d'exister aujourd'hui mais il vivote. Il n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous imaginions à l'époque pouvoir faire sur l'ensemble des techniques applicables, en particulier au niveau du machinisme, mais pas seulement. Ce contrat de solutions était pourtant le moyen de travailler horizontalement avec l'ensemble des structures.
Ce qui a manqué, et qui contribue également à l'échec du plan Écophyto, c'est que parmi les objectifs qui nous étaient assignés, il n'y avait pas de hiérarchisation. J'avais déjà été auditionné pour votre rapport de 2014, Monsieur Potier. Ce rapport est un panégyrique de tout ce qu'il faut faire et tout est dedans. Sauf qu'à la sortie, le filtre, les priorités, les enjeux et les objectifs n'ont pas été écrits. En plus, le Nodu et l'IFT, qui ne sont pas réellement des indicateurs d'utilisation, n'ont pas permis de mesurer les résultats et de les diffuser. À l'époque, nous avions proposé de diffuser ces résultats une fois par mois ou une fois tous les trimestres, de façon à ce qu'on voie les effets éventuels et à ce qu'on puisse intervenir rapidement pour corriger le tir en l'absence d'effets. Tout cela n'a pas été mis en route.
Le gouvernement avait refusé de s'associer au contrat de solutions. Le fait de ne pas avoir su mobiliser et établir des priorités autour d'Écophyto fait que ce plan a été traité par les personnes qui devaient le traiter, mais il n'a pas été, dans son ensemble, mis en œuvre.
Je me positionne comme l'un des représentants des utilisateurs. Et même à l'échelle des utilisateurs, il n'y a pas de coordination avancée. Je le dis en termes très clairs. Nous sommes terriblement seuls dans ce domaine des agroéquipements. Le réseau Cuma apporte une grande partie des forces de conseil indépendantes dans ce domaine. Mais il n'y a pas de grande force de conseil indépendante sur les agroéquipements en France. On a soixante-dix conseillers agroéquipement. J'estime qu'ils sont moins de cent au total en France.
Vous avez parlé des connexions avec les autres réseaux. On le fait autant que possible. On parlait des contrôles de pulvérisateurs, avec 20 % de contrôles qui ne passent pas. On travaille en ce moment avec l'Inrae sur un projet qui s'appelle « Néo Pulvé », lequel vise à objectiver les raisons de cette contre-visite et à produire un contenu de formation pour sensibiliser les agriculteurs qui viennent au contrôle sur ce que cela implique pour l'environnement, pour eux, pour la réussite du traitement. Un traitement qui échoue, c'est 100 % de doses perdues, il faut le recommencer. On était déjà partie prenante au moment du contrôle volontaire du pulvérisateur avant sa généralisation.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous connecter à autant de monde que nous pouvons, mais les Cuma restent un tout petit réseau au regard de l'ampleur de l'enjeu. Il faut absolument renforcer les dispositifs de soutien à l'humain, à l'accompagnement qui va avec les machines et vise leur pleine maîtrise, leur pleine utilisation, le plein potentiel des technologies qu'on met sur le marché.
J'ai oublié de répondre à une partie de votre question. À l'époque, nous étions tous d'accord autour de la table du contrat de solutions pour dire qu'environ 20 % d'économies de produits phytosanitaires pouvaient être faites par une amélioration de la formation, toutes choses égales par ailleurs.
Je voulais ajouter qu'on s'est également joint au contrat de solutions à l'époque. On avait mis en avant que lorsqu'un agriculteur achète un matériel neuf de pulvérisation, il n'y a pas trop de soucis, mais que souvent, il a plusieurs appareils de pulvérisation, donc des anciens, avec la possibilité d'enrichir des matériels anciens de kits qui permettent de réduire aussi l'utilisation des produits. Cela pose un problème juridique pour nos adhérents. Lorsque l'on intervient sur ces machines, cela suppose un travail avec les fournisseurs pour voir comment on peut intervenir et quelles sont les limites de notre responsabilité dans le cadre de l'intervention. Nous avons par ailleurs un problème de pénurie de main-d'œuvre. Enfin, se pose également le problème de la récupération des matériels anciens. Aujourd'hui, l'agriculteur garde son matériel, vous ne pouvez donc pas savoir lequel va utiliser, de l'ancien ou du plus récent. La réalité de terrain doit être intégrée.
On a des travaux d'analyse du contenu du Certiphyto, par exemple, pour voir comment il faut le faire évoluer afin que les agriculteurs soient plus en phase avec ce que l'on peut leur proposer.
On voit bien, à travers le réseau des fermes Dephy, par exemple, que les bons résultats obtenus – entre moins 20 % et moins 50 % de produits phytosanitaires par rapport à la Ferme France – tiennent largement au dispositif de suivi ou de discussion en groupe, qui leur permet de réduire leur usage de produits tout en maintenant voire augmentant la rentabilité de leur exploitation. Ils sont donc dans une logique de système et c'est celle que l'on défend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler le levier des agroéquipements sans réfléchir à quels couverts végétaux on essaie de détruire, sur quel type de cépage on travaille. Concernant les enjeux génétiques que vous avez mentionnés, le fait de travailler sur les cépages résistants en viticulture, par exemple, a permis de passer de treize à deux traitements antifongiques. Nous voyons bien qu'il y a des marges de manœuvre majeures, mais cela nécessite effectivement une bonne articulation d'ensemble.
Nous voyons cette richesse et cette diversité des approches dans la commission des certificats d'économie de produits phytosanitaires qui essaie de rendre compte des gains potentiels des différents leviers que les agriculteurs peuvent mobiliser. Une logique de cohérence globale doit être mise en place, en incluant également l'articulation entre les modes de production et les modes de consommation.
Quelles traces des agroéquipements dans les cahiers des charges, et notamment les cahiers des charges privés ? J'ai beaucoup de difficultés à savoir si, oui ou non, un grand distributeur peut ajouter des contraintes sur son label, s'agissant du choix des outils à utiliser. Nous n'avons pas connaissance de cela. Une peu plus de transparence serait sans doute nécessaire quant à ces cahiers des charges.

Lorsque l'on évoque l'abandon partiel de ce qui est encore aujourd'hui un élément structurant de notre agriculture, l'usage des produits phytosanitaires, se pose impérativement la question des alternatives. Le secteur du machinisme agricole semble plutôt bien se porter ; en témoignent vos propos et le pavillon entier que vous occupiez lors du salon de l'élevage, à Rennes – le Space – cette année.
Ma première question porte sur le lien entre votre activité commerciale, la démarche du plan Écophyto et la perception qu'ont les agriculteurs, vos clients, de votre activité. Lorsque vous faites commerce de machines agricoles, quelle part prend, dans vos arguments de vente, l'opportunité de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires ? Les agriculteurs y sont-ils sensibles ?
La conversion des exploitations coûte cher ; les syndicats agricoles nous l'ont encore dit la semaine dernière. Vos machines sont très efficaces mais aussi très onéreuses et le plan Écophyto est justement là pour accompagner financièrement les transformations attendues au sein du monde agricole. De votre point de vue d'industriels, cet accompagnement est-il suffisant et efficace dans son exécution ?
Certains agriculteurs, pour l'entretien de leurs bordures de champs, passent par des prestataires. Il y a dans cette démarche une forme de mutualisation de la mécanisation agricole et de ses coûts. Que pensez-vous de cette pratique ?
Le monde des agroéquipements va-t-il bien ? Nous avons effectivement enregistré une croissance de nos ventes dans les cinq dernières années ; cela va probablement se traduire en 2024 par un réajustement du marché à la baisse. Le phénomène est complexe. Il y a eu énormément de ruptures de composants pendant la période du Covid-19. Le prix des matières premières a beaucoup augmenté. On constate une augmentation globale du chiffre d'affaires. Mais la quantité de matériels vendus sur le terrain a plutôt baissé au cours des deux dernières années. La rentabilité moyenne des PME françaises de l'agroéquipement ne dépasse pas les 4 %. Ce n'est pas énorme quand on regarde les efforts de R&D que ces sociétés doivent consentir pour arriver à concurrencer les groupes internationaux qui sont eux aussi dans la partie, mais qui ont l'avantage de surfer sur une surface beaucoup plus importante de pays et d'économies.
Nos machines coûtent cher. Oui, tout est toujours trop cher. Ce que l'on voit, c'est que les charges de mécanisation sont bien plus importantes en France que dans les autres pays d'Europe. Il y a des raisons à cela, mais qui ne sont pas forcément imputables au coût des matériels. Achète-t-on la bonne machine au bon endroit et au bon moment ? Cette question se pose.
Le plan d'accompagnement est-il suffisant ? Sûrement pas. Les 285 000 pulvérisateurs valent 7 milliards d'euros au prix d'achat actuel, peut-être même un peu plus compte tenu des dernières augmentations. Qu'a-t-on mis sur la table depuis une dizaine d'années ? Peut-être 150 à 300 millions d'euros de subventions. Nous ne sommes pas du tout à l'échelle d'une massification. Comment massifier cette technologie ? Mme Fradier en a parlé, on peut faire du rétrofit sur un certain nombre de machines, mais encore faut-il que nous nous mettions d'accord et que les différentes techniques que l'on peut monter sur ces anciennes machines arrivent.
Encore faudrait-il que nous prenions les bonnes cibles. Quand on parle d'Écophyto, il ne faut pas traiter la totalité de la Ferme France, mais plutôt se centrer sur les personnes qui consomment le plus de produits phytosanitaires ou ceux qui utilisent des CMR1 ou CMR2 avec une dangerosité supérieure aux autres.
Encore faudrait-il que l'on travaille sur la sécurité. Il existe encore aujourd'hui des produits physiques en poudre extrêmement nocifs par inhalation. On devrait être capable de les mettre sous forme liquide et de remettre des concentrations qui n'obligent pas à avoir des grammes par hectare ou des dizaines de litres par hectare. Cet ensemble de contraintes techniques n'a pas été discuté. Nous n'avons pas fixé d'objectifs tous ensemble, alors que nous avons déjà évoqué ces sujets entre nous, mais qu'il n'y a pas de coordination.
L'accompagnement des priorités et des plans au niveau du ministère n'est pas suffisant. Un plan est en cours actuellement, à hauteur de 360 millions d'euros. Mais cela fait un an qu'on l'a ouvert et il n'y a toujours pas un seul euro sur le marché. Il y a un problème d'efficacité dans la mise en œuvre de ces plans. Nous n'avons même pas été consultés en amont. Le cahier des charges est sorti, il était déjà trop tard pour intervenir. On aurait pu atteindre beaucoup plus de machines si on avait réfléchi tous ensemble à la solution. Du moins, peut-être pourrons-nous le mettre en route en 2024.
Nous nous réunissons d'abord pour diminuer nos charges de mécanisation. La mutualisation permet par ailleurs des échanges entre pairs sur des méthodes et des pratiques qui nous font avancer, pas tous à la même vitesse, mais au moins, cela permet d'expérimenter sans prendre de grands risques et dans un cadre plus rassurant puisqu'à plusieurs, il est déjà plus facile d'essayer de nouvelles méthodes.
S'agissant des produits phytosanitaires, une étude menée par l'institut Agro de Rennes démontre que lorsqu'il y a un maillage important de Cuma sur un territoire, il en résulte une baisse significative du taux de produits phytosanitaires utilisés.
Il est difficile de donner ces informations dans le sens où les papiers ne sont pas encore publiés dans les revues scientifiques et je ne m'avancerai pas sur les chiffres.
Je veux juste revenir sur le lien entre le conseil commercial et l'objectif de réduction des produits phytosanitaires. Le conseil commercial n'est pas abordé sous cet angle que vous évoqué. Il est abordé sous l'angle de la différenciation par rapport à ce que l'agriculteur possède ou par rapport à ce que propose le concurrent, sous l'angle de la valeur ajoutée apportée.
Effectivement, c'est une question que j'ai posée juste avant cette intervention auprès de nos adhérents. Ce qui ressort pour eux, c'est que la préoccupation des agriculteurs par rapport aux enjeux de santé n'est pas première. La préoccupation première, c'est celle rentabilité et de la compétitivité de leur exploitation. Ils vont déjà essayer de trouver un matériel qui leur permette d'accroître leurs gains de productivité. Bien sûr, ils sont aussi sensibles aux questions de santé, et ils le sont d'autant plus quand ils commencent à avoir eux-mêmes des salariés. On mène régulièrement des enquêtes, notamment pour savoir quel est le premier interlocuteur des agriculteurs pour les aider dans le choix des matériels. Ce sont les concessionnaires qui ressortent en premier, à un très fort taux. Or, ce n'est pas vraiment leur rôle de mettre en avant les enjeux de santé.
On aimerait peut-être qu'il y ait davantage d'intervenants neutres pour conseiller les agriculteurs. Cependant, il faut savoir que nos adhérents ont une obligation de formation. C'est-à-dire que, pour vendre le matériel, ils doivent être formés sur ce matériel chez les constructeurs. Ils ont ainsi une très bonne connaissance de la machine. C'est la raison pour laquelle on a eu de moins en moins de conseillers dans les chambres d'agriculture sur ces questions : ces métiers deviennent de plus en plus complexes et technologiques.
Les concessionnaires et leurs techniciens sont néanmoins vigilants aux aspects sanitaires. Ce qui ressort toujours, c'est la fenêtre de tir météorologique. Un désherbage mécanique est plus long en termes de travail et ne peut pas être fait sur grande culture. Mais depuis vingt ans, dans les grandes cultures, la consommation de produits phytosanitaires a diminué grâce à l'usage de matériels beaucoup plus performants en termes de pulvérisation. Cependant l'agriculture est diverse. On a encore beaucoup d'agriculteurs avec des surfaces beaucoup plus petites, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens.
Nous ne sommes pas demandeurs de subventions. Pour nous, elles perturbent plus les marchés qu'elles n'apportent de solutions. Comme le dit M. de Buyer, il faudrait peut-être travailler autrement, en tenant compte des réalités de terrain. Telles que les subventions sont proposées aujourd'hui, elles engendrent des achats d'opportunité plutôt que des achats vraiment réfléchis. On a la prime pour acheter un nouvel équipement mais, derrière, est-ce que l'on va éliminer les anciens équipements plus polluants ? Pour l'instant, non. Il faut, à mon avis, réfléchir à la façon dont les aides sont orientées.
J'insiste pour dire que nous sommes face à des changements de pratiques. Les innovations arrivent et il semble nécessaire d'accompagner les agriculteurs dans les changements de pratiques. C'est un travail qui n'est pas uniquement lié à des subventions. En tout cas, c'est ce que l'on croit au sein de notre organisation professionnelle.
Il existe plusieurs dispositifs de soutien, qui sont parfois un peu hétérogènes entre régions, et dont je vous épargne la complexité. Ils sont de toute façon nécessaires, c'est-à-dire qu'ils ne compenseront pas le surcoût de la mise en œuvre de la nouvelle pratique permise par cet agroéquipement. Cela ne couvre pas la totalité du surcoût, donc c'est facilitant. Je pense que les agriculteurs ont largement conscience des enjeux de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytosanitaires.
Je repositionne ce que sont nos conseillers et notre réseau. Le travail d'un conseiller en agroéquipement dans le réseau Cuma n'est pas de comparer la machine bleue, la machine verte et la machine rouge ; c'est de dire en quoi cette nouvelle typologie de machines, cette nouvelle action mécanique, électrique, cette nouvelle technologie de pulvérisation va permettre la mise en œuvre d'une pratique agronomique. C'est ce champ-là du conseil qui, je pense, n'est pas assez travaillé. Comparer une herse étrille d'une marque ou d'une autre, mécaniquement, ce sera toujours un système de dent qui vient gratter le sol. Par contre, prendre le temps avec l'agriculteur d'expérimenter, de trouver des dispositifs, en donnant accès à un équipement pour que l'agriculteur l'essaye dans ses parcelles, avec ses conditions, sur ses cultures, avec un accompagnement pour maîtriser la pratique, l'outil en fonction des conditions météo : voilà un champ qui me semble largement oublié. Au-delà de soutenir l'achat de la herse étrille, il s'agit de pratiques beaucoup plus complexes à mettre en œuvre qu'un traitement avec un produit phytosanitaire et un pulvérisateur, quand bien même on ne serait pas assez fort sur la goutte. Je pense que les enjeux d'accompagnement, sur le désherbage mécanique notamment, sont sous-évalués.
Je suis totalement d'accord avec le fait que les subventions n'améliorent rien au comportement du marché. Si l'on pouvait s'en passer, ce serait beaucoup mieux parce que cela ne fait que perturber. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je dis simplement que cela perturbe. Il n'y a plus de conseiller machinisme en chambre d'agriculture. C'est un sujet sur lequel on a déjà échangé avec M. Windsor. Il manque une véritable courroie de transmission sur ces enjeux. Les Cuma en font une partie, mais cela ne suffit pas.

Monsieur Reboud, vous avez parlé de la supériorité du coût du désherbage mécanique par rapport au désherbage chimique sur les cultures pérennes. Si j'ai bien entendu, c'était de 100 à 400 euros supplémentaires à l'hectare. Qu'intègre ce chiffre ? Inclut-il l'amortissement du matériel, la consommation de gasoil ? Intègre-t-il aussi le temps passé par la personne qui conduit le matériel ? La perte des récoltes ? Je suis viticulteur et je sais bien que dès qu'on arrive avec des lames pour gratter le sol, on détruit un système racinaire installé et l'on peut avoir des pertes de récoltes de 20 à 30 % la première année. La situation se résorbe avec les années parce que le système racinaire se reconstruit plus en profondeur. J'ai vu aussi du désherbage mécanique sur du maïs. On voit bien que le matériel, même s'il est très performant, entraîne des dégâts sur les cultures. On a parlé tout à l'heure des fenêtres météo. Quand vous avez un printemps qui est pluvieux, il faut avoir une fenêtre de météo large pour permettre que les sols sèchent avant de passer les outils mécaniques. Si on n'y arrive pas, le développement d'herbes vient concurrencer les cultures, avec un impact sur les récoltes.
Il y a eu beaucoup d'innovations sur les alternatives mécaniques, mais y a-t-il eu des innovations sur l'optimisation des traitements chimiques, en matière de désherbage notamment ? Je prends l'exemple de la vigne ; l'enherbement n'a gagné que 10 % de la zone désherbée : une optimisation très importante de l'usage des produits phytosanitaires me semble possible. L'intelligence artificielle se développe et peut donner des perspectives énormes dans ce domaine. Du point de vue de la recherche, a-t-on acté la fin de l'herbicide, ne travaille-t-on que sur le désherbage mécanique ?
Aujourd'hui, nous avons l'ensemble des technologies nécessaires pour diminuer de 70 à 85 % les doses d'herbicides – pas forcément pour les vignes néanmoins, qui sont des cultures un peu particulières. La technologie de la vision artificielle est néanmoins susceptible de répondre à l'ensemble des besoins.
Mais j'en reviens à la question du coût. Ce sont des machines chères et il faut trouver le moyen de massifier leur arrivée sur le terrain, de façon à rendre perceptible cet effet attendu de baisse des volumes de produits appliqués.
En réalité, il y a plus de recherche sur l'application optimisée des produits phytosanitaires que sur le désherbage mécanique. L'enjeu est surtout le ciblage des adventices : une fois que vous savez où elles se situent, envoyer une molécule, un courant électrique, un marteau-pilon pour les écraser ou une dent pour les scalper se révèle presque accessoire. Le plus difficile est ainsi de repérer l'adventice avant qu'elle ne soit dangereuse, préjudiciable ou nuisible pour la culture en place. Des solutions émergent sur l'imagerie, la reconnaissance et la localisation. Au total, il y a assez peu de recherches technologiques sur d'autres moyens que la dent pour aller gratter le sol.
On a effectivement évoqué le spot spraying, l'analyse du signal. On a aussi de la cartographie : les agriculteurs peuvent obtenir une cartographie de leur chardon ou de leur datura dans le cadre d'une contractualisation.
S'agissant du coût du désherbage, notamment en viticulture, vous avez raison : on a pris en compte tout ce que vous avez dit, notamment les pertes de rendement transitoires. Pour les coûts de main-d'œuvre, on a utilisé les barèmes d'entraide pour avoir une idée des montants. Je vous renvoie à notre document, en accès libre sur Internet, qui cherche à évaluer le surcoût lié à la sortie du glyphosate et à la mobilisation d'alternatives.
Pour les approches, on s'est appuyé sur les données du réseau Dephy et sur les enquêtes de pratiques culturales, pour essayer d'avoir les données les plus proches des conditions rencontrées réellement sur le terrain. Ce qui peut faire la différence, c'est en premier lieu l'écartement entre rangs. Dans chacun des grands bassins viticoles de France, on n'a pas exactement les mêmes pratiques, ce qui fait que l'on n'arrive pas au même coût.

On voit bien que les technologies évoluent rapidement, notamment sur la pulvérisation. En revanche, j'ai le sentiment que l'entretien pêche un peu ; j'entends souvent que le matériel est un obsolète ou mal nettoyé, ce qui peut induire des débits supérieurs. Comment améliorer cela ? Les Cuma pourraient-elles mettre en place des services d'entretien ?
Concernant le prosulfocarbe, l'Anses a rendu une décision récente, imposant notamment des buses anti-dérives. Qu'en pensez-vous ?
Enfin, j'aimerais savoir quels sont les cas où il n'y a pas d'alternative au glyphosate ?
On sait que le prosulfocarbe est un produit extrêmement volatil et qu'une partie de la volatilisation avait lieu au moment de la pulvérisation. D'autres pays européens avaient déjà exigé d'avoir des buses plus limitantes et la France s'est alignée sur la position de 90 %, complémentaire de la logique d'extension de la zone qui ne doit pas être traitée.
Pour le glyphosate, il y a effectivement un certain nombre de situations d'impasse. On en a mentionné dans notre rapport. Si j'essaie de résumer rapidement, 100 % des agriculteurs en agriculture de conservation des sols utilisent le glyphosate. Si l'on veut maintenir cette agriculture qui représente 3 à 4 % de la surface agricole utile et qui a, par ailleurs, d'autres intérêts sur le maintien de la vie du sol et le stockage du carbone, il faut pour l'instant maintenir l'autorisation du glyphosate. Il y a aussi les situations où les sols sont très pierreux et/ou en forte pente, où tout travail du sol se traduit par un risque important d'érosion ou de ruissellement. Dans ces situations-là, il faut effectivement permettre d'utiliser les solutions chimiques, notamment le glyphosate qui, de par son caractère total, est une solution vraiment privilégiée par les agriculteurs.
Quelles sont les deux situations pour lesquelles il y avait une reconnaissance de l'existence d'une alternative crédible d'usage courant, conformément à l'article 50.2 de la directive 1107 européenne ? Lorsque vous labourez, vous faites le même travail qu'avec du glyphosate. Pour les cultures pérennes – viticulture et arboriculture – vous ne pouvez utiliser le glyphosate que sous le rang des arbres ou de la vigne, soit sur un tiers de la surface au maximum.
Ces évolutions et ces restrictions d'utilisation du glyphosate ont été mises en place dans le cadre de nouvelles autorisations de mise sur le marché définies par l'Anses entre 2020 et 2021, pour une application à partir du 1er janvier 2022. On dispose d'une année complète de recul, qui a montré que cette nouvelle réglementation se traduisait par une baisse d'utilisation des tonnages de glyphosate en France.
Sur la question de l'entretien des pulvérisateurs, il n'est pas dans la mission des Cuma de réaliser des entretiens pour des tiers qui ne seraient pas adhérents. En revanche, nous avons un réseau composé de fédérations départementales et régionales qui accompagnent les Cuma tout au long de l'année. Certaines de ces fédérations proposent des contrôles de pulvérisateurs à destination de Cuma dépourvues de salariés pour s'occuper de l'entretien. Ces contrôles sont à chaque fois accompagnés de conseils personnalisés. Parfois, les conseils peuvent être déclinés vers d'autres agriculteurs qui ne sont pas en Cuma, parce que notre force est aussi de recueillir des résultats et des données pour pouvoir ensuite les publier.

Je vais revenir également sur l'argument du coût économique qui a été évoqué tout à l'heure. Le facteur un à quatre entre le désherbage chimique et le désherbage mécanique semble être un argument ultime. Cependant, je pense que ce chiffre n'est pas pertinent si on ne le rapproche pas de la globalité des charges d'une exploitation et/ou de son excédent brut d'exploitation. Pouvez-vous ainsi nous indiquer quel est le poids pondéré de ce surcoût dans un résultat d'exploitation ? Nous savons que le facteur de décision pour les agriculteurs est souvent un facteur économique.
Effectivement, c'est un sujet complexe, et c'est pour l'appréhender dans toutes ses dimensions que nous avons été missionnés pendant un an. On a aussi exprimé nos résultats sous forme d'EBE ; de mémoire, nous trouvions 13 % de différence. Mais je vous renvoie aux documents pour avoir la vraie fourchette de valeurs. Je ne sais plus exactement ce que couvrait ces 13 %, mais l'on voit que c'est significatif.
Il y a sans doute d'autres facteurs qui sont susceptibles d'influer sur les résultats observés. Il est difficile de savoir quelle part de la différence on attribue à l'évolution des techniques de désherbage par rapport à d'autres changements, par exemple le changement climatique, le fait qu'on puisse faire de la vente directe, etc. On a utilisé des approches de statistiques issues du domaine des médicaments pour estimer ces effets, avec des approches par score de propension, qui permettent de qualifier et de retirer une partie des différences qui ne sont pas directement liés aux changements considérés.
On a constaté à cette occasion que les agriculteurs qui sont en vente au domaine ont la capacité de répercuter une partie du surcoût sur le prix de la bouteille et d'en faire un argument commercial en montrant aux gens qu'ils n'utilisent pas le glyphosate depuis des années et qu'ils consentent des efforts pour maintenir la qualité du terroir. En revanche, les agriculteurs qui sont sur des marchés plus compétitifs, du type vente de vin de table, peuvent perdre le marché s'ils subissent des surcoûts qu'ils ne pourront pas répercuter sur le prix de vente de leur production.

Vous parlez uniquement de la viticulture, j'aurais aimé avoir ces éléments pour l'ensemble des cultures.
La situation de l'arboriculture n'est pas très différente, si ce n'est qu'il y a des différences sur le type de cultures. Comme pour la viticulture, on peut pratiquer l'enherbement ou le désherbage mécanique sur l'entre-rang.
S'agissant des cultures annuelles, on va chercher à faire place nette avant d'installer la culture. Évidemment, c'est concentré sur le désherbage mécanique, mais certains agriculteurs vont essayer d'éviter le retour des adventices au sol en jouant sur le broyage des menues pailles ou en utilisant des écimeuses. Sur les domaines expérimentaux de l'Inrae, on sait faire des cultures sans utiliser d'herbicides et sans détérioration majeure du potentiel de production.

Monsieur de Buyer, vous dites qu'il existe des solutions technologiques pour l'optimisation des doses mais qu'elles ne sont pas massifiées. Pourquoi, à votre avis ? Pensez-vous qu'il existe un intérêt économique à cette massification ? On achète quand même une machine plus chère, plus sophistiquée, mais l'économie de produits qui en résulte ne compense pas ce surcoût en réalité. Ne faudrait-il pas revoir les cibles des subventions ? J'ai toujours été frappé de voir des subventions en faveur des écimeuses, par exemple dans les vignes, lesquelles n'apportent absolument rien en termes de transition.
Il y a les subventions locales, celles de la région, celles du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE), les subventions nationales. Par exemple, l'appel à manifestation d'intérêt « équipement pour la troisième révolution agricole » est une subvention nationale dans le cadre de France 2030. Le premier problème que l'on a avec ces subventions, c'est qu'on n'en voit pas le résultat. Vous pouvez interroger les régions, on ne sait pas combien de matériels, dans quelles catégories, ont été subventionnés. Deuxièmement, nous n'arriverons pas à connaître les enveloppes et les critères de tri.
Pour ce qui concerne le coût, quand je dis que nous avons toutes les solutions, nous avons toutes les briques techniques nécessaires, avec la visualisation, la vision artificielle, etc. Massifier ces techniques supposerait d'avoir une cible, car il ne serait évidemment pas question de massifier à l'ensemble des exploitations. Il faudrait prioriser sur ce qui est susceptible de générer le plus de résultats.
Quant à savoir si l'investissement dans ces technologies est rentable par rapport à l'utilisation du gasoil ou au coût des produits phytosanitaires, la réponse est non. C'est tout sauf rentable. Ça va être un débit de chantier. Aujourd'hui, il y a moins de salariés, une augmentation des surfaces, une réduction du temps d'intervention par les effets climatiques ou d'autres effets. Vous avez une demande principale sur le terrain, au-delà du coût, qui est le débit de chantier. On a besoin d'aller plus vite en moins de temps pour faire le plus de travail possible.
Les technologies qu'on amène aujourd'hui ont un double rôle. Soit elles permettent un gain très significatif sur l'application des produits phytosanitaires, soit elles permettent un gain sur le débit de chantier. Je prends l'exemple de la vigne. Vous avez depuis de très nombreuses années des descentes multi-rangs, quatre rangs, six rangs, tout à fait efficaces, mais combien sont équipées aujourd'hui de ces technologies ? Un peu plus de la moitié. Vous avez encore, dans des plans d'investissement locaux – je ne veux pas dire où – des personnes qui considèrent qu'un bon aéro trois rangs fait largement le travail et coûte deux fois moins cher qu'une descente. On entend encore ce genre de discours.
Je pense que la massification passera aussi par la gestion de l'ancien matériel. Quand un agriculteur achète un matériel, il s'attend à ce que le concessionnaire lui reprenne l'ancien matériel avec une certaine valeur. Si l'on veut diffuser largement les nouvelles technologies, il va falloir arrêter avec les anciennes. Il y a également tout le problème du traitement des déchets liés à ces anciens matériels. C'est une vraie question de fond qui, pour l'instant, n'est pas traitée. La massification oblige à prendre en compte la question des matériels anciens, qui a un coût économique.
Le débat pourrait laisser croire que rien n'est fait. Sur le parc actif des Cuma, en cinq ans, nous voyons 20 % de pulvérisateurs en moins et 50 % de matériel de désherbage mécanique en plus. C'est quand même l'effet des subventions et l'effet des conseils. Certaines choses s'améliorent.
La mutualisation est une partie de la réponse sur la question du coût économique. Effectivement, cela n'effacera pas le fait qu'il y a un surcoût économique à renoncer à utiliser, totalement ou partiellement, un produit phytopharmaceutique. Dans la discussion, on se concentre beaucoup sur les herbicides, mais il y a peut-être aussi d'autres pans de la protection des cultures qui doivent être étudiés.
Je pense aussi qu'on aurait intérêt à favoriser les initiatives remarquables. Les agriculteurs n'attendent pas forcément qu'on leur amène une solution clé en main. Certains innovent parce qu'ils n'ont pas le choix. Les agriculteurs biologiques ont fait le choix de se passer d'un produit et ils ont trouvé certaines solutions. Elles mériteraient peut-être d'être connues ailleurs. Même hors cahier des charges biologique, on voit des agriculteurs leaders et innovants, qui mettent en œuvre des solutions très accessibles puisqu'ils l'ont fait sans l'aide d'un centre de recherche ou d'une technologie de pointe. On sera là, nous, réseau Cuma, pour massifier les technologies lorsqu'elles sont prometteuses et nécessitent de former les agriculteurs. Mais ne sous-estimons pas la capacité de certains agriculteurs à innover et aidons-les parce que l'agriculteur ne voit pas son voisin comme un concurrent, mais comme un collègue avec qui il va pouvoir partager certaines choses.

Je suis désolé de devoir interrompre cette audition ; on voit bien qu'il y aurait matière à la prolonger, mais le programme est tel qu'on est forcé de se restreindre.

C'était vraiment passionnant, au-delà de nos attentes. Il me reste quelques questions sur lesquelles vous pourriez peut-être nous envoyer des retours écrits assez rapides. Notre commission d'enquête va être amenée à faire des recommandations. Dans le projet de loi de finances, 250 millions d'euros sont mis sur la table pour des solutions agroécologiques visant à diminuer les pesticides dans le budget de l'agriculture. Certains pays font mieux que nous, nous pourrions nous en inspirer. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont vos recommandations pour progresser, qu'il s'agisse de mutualisation, de formation, d'encadrement, de systèmes de reprise de matériel ? Le machinisme est une des voies les plus performantes en la matière, à travers la diminution des doses, les applications au bon endroit, la sécurité, les solutions mécaniques pour le désherbage.
Que pouvons-nous faire d'intelligent dans ce domaine ? Je suis persuadé que le ministère de l'agriculture sera à l'écoute de nos propositions, si elles sont collégiales et transpartisanes, s'agissant d'un budget qui n'est pas affecté pour l'instant. Il s'agit simplement d'une enveloppe globale, d'un fonds qui sera abondé par tous les moyens de taxation des produits phytosanitaires. Nous devons orienter ces moyens ; cela n'a pas été suffisamment le cas jusqu'à aujourd'hui. Il existe de nombreuses pistes et c'est vraiment le moment de les formaliser.
Puis, la commission entend lors de sa table ronde avec la filière semences :
- M. Didier Nury, président de l'Union française des semenciers (UFS) accompagné de M. Laurent Guerreiro, administrateur ;
- M. Pierre Pages, président de l'Interprofession des semences et plants (Semae) et M. Jean-Marc Bournigal, directeur général.

Nous poursuivons nos travaux en nous consacrant à un autre aspect de cette politique publique de réduction de l'impact et des usages des produits phytopharmaceutiques, qu'est la question du matériel végétal. Nous accueillons les représentants de deux organisations, l'Union française des semenciers (UFS) et l'Interprofession des semences et plants (Semae).
Nous allons vous laisser la parole pour un propos introductif. Ce qui est important pour nous, c'est que vous soyez pédagogues si l'on entre dans des aspects techniques. Derrière les mots qui peuvent être les plus évidents, il y a parfois beaucoup d'enjeux. Pour l'anecdote, quand j'étais étudiant, je me souviens d'un professeur de génétique des populations qui nous avait dit que cela faisait une heure qu'il nous parlait de semence améliorée et que pas un seul élève n'avait levé la main pour savoir ce qu'on entendait par une semence « améliorée » : pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Comme s'il était évident qu'un blé qui fait plus de grains, moins de pailles, mais qui est plus fragile et plus gourmand, est mieux. Je vous demande donc d'être aussi précis et rigoureux que possible dans le langage.
Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que vous êtes tenus de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires.
(MM. Didier Nury, Laurent Guerreiro, Pierre Pagès et Jean-Marc Bournigal prêtent serment.)
L'Union française des semenciers représente la quasi-totalité des entreprises qui officient dans le secteur de la semence sur le territoire français. Les trois piliers principaux de nos métiers concernent la recherche, que nous appelons la sélection variétale, la production et la commercialisation. C'est un tissu d'un peu plus d'une centaine d'entreprises, principalement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), dans des coopératives agricoles, des entreprises familiales et également quelques filiales de grands groupes internationaux. On s'adresse à l'ensemble des marchés, que ce soient les agriculteurs, les maraîchers professionnels, les jardiniers amateurs ou les collectivités publiques et les espaces verts.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un métier extrêmement innovant, puisque nous investissons 13 % de notre chiffre d'affaires dans la recherche. La France occupe vraiment une position de leader sur ce secteur : nous sommes le premier exportateur mondial et le premier producteur européen.
Nous sommes, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, utilisateurs de produits phytosanitaires, même si c'est sur des surfaces et des quantités plus modestes à l'échelle du territoire, ce qui n'empêche pas de travailler à les réduire. Par contre, nous sommes surtout des apporteurs de solutions, puisque tout ce qui pourra être gagné grâce à la section variétale sera un pas significatif vers la réduction de la chimie.
Je suis agriculteur multiplicateur de semences dans la région de Pau. Le Semae est une interprofession qui rassemble les semences dans toute leur diversité, une interprofession longue puisque nous représentons tous les maillons de la filière dans les cinq collèges : la sélection et la maintenance des variétés, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des semences. Nous les représentons à travers nos cinquante-quatre organisations membres.
C'est une filière d'excellence. L'innovation est un axe majeur pour nous. Le chiffre d'affaires global de la profession représente 3,5 milliards d'euros et nous sommes le premier exportateur mondial avec une balance commerciale excédentaire de 1 milliard d'euros. Le secteur pèse dans l'économie.
Je parlais de diversité des acteurs, de diversité de types de production de semences. Nous avons à cœur de résolument positionner les métiers des semences et l'interprofession comme porteurs de solutions pour les transitions que nous sommes en train de vivre et d'aborder.
Je suis administrateur UFS et également président de la société RAGT, qui est l'une des nombreuses sociétés de sélection présentes sur le territoire et au-delà. Comme vous le savez probablement, la sélection se déroule sur le temps long. Le principe de la sélection est relativement simple. Il s'agit, par le croisement de parents complémentaires, de tenter d'obtenir des descendants qui vont cumuler les caractéristiques favorables des parents que vous avez choisis pour baser votre programme de sélection. On estime que, suivant les espèces, il faut compter environ six à quinze ans – six ans pour du maïs, quinze ans pour des graminées fourragères – pour obtenir une variété améliorée.
La sélection est un secteur très dynamique en France, avec un peu plus de 130 structures de recherche présentes sur le territoire national et 13 % du chiffre d'affaires des entreprises semencières réinvesti dans la recherche. C'est une moyenne, qui couvre un échantillon qui va de 5 à plus de 20 %, soit bien au-delà du niveau d'investissement de la plupart des secteurs, dont la pharmacie.
La sélection répond à une exigence d'inscription au catalogue, indispensable pour commercialiser de nouvelles variétés sur le territoire européen. Cette exigence d'inscription au catalogue a encore évolué ces dernières années avec la transformation du critère de valeur agronomique et technologique des variétés (VAT) en valeur agronomique, technologique et environnementale (VATE), dans le dessein de progresser plus rapidement sur la tolérance au stress biotique et abiotique.
Pour obtenir l'inscription au catalogue français, vous devez proposer une variété qui présente une valeur ajoutée par rapport à celles inscrites l'année d'avant, en termes de matériel génétique. Avec la VATE, si votre variété présente des tolérances aux maladies ou à un certain nombre de stress abiotiques, vous pouvez bénéficier d'un bonus à l'inscription qui permet de compenser d'autres critères que vous n'auriez pas réussi à remplir. Les systèmes français et européen accordent ainsi beaucoup de poids à la tolérance aux maladies.
L'inscription est un processus relativement long. Pour essayer de répondre aux attentes des agriculteurs, mais également de la société, d'avoir des variétés plus tolérantes et requérant moins de produits de protection des plantes, nous avons besoin d'outils. Il n'y a pas un seul gène dans une variété qui va vous permettre de résister au spectre complet des maladies existantes, des insectes ou d'autres parasites qui peuvent agresser les plantes. Pour ce faire, nous sommes obligés de cumuler, à l'intérieur des variétés, un grand nombre de gènes de résistance qui, additionnés les uns aux autres, vont permettre d'élargir le spectre de résistance des variétés. Ce travail est long et fastidieux. Il n'est pas évident qu'une construction à 5 gènes sera nécessairement meilleure qu'une construction avec un peu moins de gènes, dès lors que l'on a intégré un gène un peu défavorable. Il s'avère nécessaire – on parle de pyramidage en sélection – de cumuler des strates de niveaux de défense dans les variétés. Cette activité scientifique et les outils que l'on peut développer pour améliorer les résistances variétales ou l'adaptation au changement climatique sont déjà une réalité. J'en veux pour preuve que 27 % des fiches certificats d'économies de produits phytopharmaceutiques (CEPP) concernent des variétés avec des profils améliorés, qui permettent d'envisager ces économies de produits phytosanitaires.
Nous espérons l'accès le plus rapide possible à un grand nombre de technologies, dont les new breeding techniques (NBT), qui devraient permettre au monde de la sélection et du développement de raccourcir encore les durées de sélection, de cumuler plus facilement des critères de résistance et donc d'obtenir des variétés beaucoup plus résilientes demain.
Les entreprises semencières ont décidé de maximiser les chances de réduction des produits phytopharmaceutiques via une diversité d'actions. Nous pouvons évoquer notamment les associations variétales, qui se développent de plus en plus. En colza, par exemple, un nombre croissant de développements vise à associer deux variétés de colza différentes, une variété un petit peu plus précoce qui, en florissant avant la variété principale, va attirer les insectes, principalement les méligèthes, ce qui autorise ensuite le développement de la culture principale. C'est un exemple, déjà un peu ancien, d'association variétale. Aujourd'hui, à travers les plantes de service, les couverts végétaux, le recours à la biodiversité et à la diversité génétique, un champ disciplinaire s'est ouvert, qui permet de réduire la pression fongique, mais aussi de mieux gérer les questions de fertilisation et les problématiques liées à l'eau.
Toutes ces solutions existent en effet mais il faut des agriculteurs pour les produire, avec aussi des contraintes de production au champ qui sont importantes.
J'ai parlé d'un grand nombre d'acteurs dans la filière des semences, c'est aussi un grand nombre d'espèces. La diversité est très importante, avec une segmentation extrêmement forte puisqu'on a 142 espèces, mais plus de la moitié sont cultivées sur moins de 100 hectares sur le territoire national, tandis que les 8 principales espèces représentent plus de 10 000 hectares. Cela pose des défis particuliers pour l'accompagnement de ces productions, puisque les petites surfaces recèlent une diversité importante de productions mais aussi de bioagresseurs.
Les productions de semences sont très encadrées, nous avons des cahiers des charges stricts sur le plan sanitaire, sur le plan de la qualité, sur les normes en termes d'adventices, ce qui génère beaucoup de contraintes pour les 18 000 agriculteurs qui mènent à bien ces productions. Comme le reste de la population agricole, nous avons besoin de solutions, notamment phytosanitaires. Pour des petites productions, mais aussi maintenant pour certaines productions sur des surfaces plus importantes, nous commençons à manquer de solutions. Par exemple, il n'y a plus de production de semences de radis rouges ou d'épinards en France, parce qu'on n'a pas de solution crédible de protection des cultures. Les entreprises semencières ne veulent plus prendre de risque et ont déporté l'activité ailleurs dans le monde, où la capacité de production perdure. Notre capacité à approvisionner le marché en semences est un enjeu de souveraineté.
Nous devons vraiment prendre la mesure de cet enjeu. Aujourd'hui, 33 % des usages en porte-graines ne sont pas pourvus, comme l'ont révélé les travaux des groupes techniques sur les usages orphelins en 2020. Nous avons pourtant toujours demandé de ne pas retirer un produit tant qu'il n'y avait pas de solution alternative.
Cela a été évoqué, on observe une mobilisation très importante de la recherche et du développement pour trouver des solutions alternatives aussi en production de semences. M. Guerreiro a évoqué les plants de campagne et les plants de services. L'interprofession a aussi engagé des axes de recherche. La commission de l'innovation nous accompagne pour avancer sur tout ce qui touche à la lutte intégrée, à la maîtrise des bioagresseurs. Nous avons le souci de nous inscrire dans une production de semences qui réponde à ces enjeux-là. Nous menons un vrai travail d'évaluation de toutes les solutions qui se présentent – des solutions chimiques, mais aussi de biocontrôle. Notre budget, qui dépasse les 2 millions d'euros, vise à accompagner ces transitions sur la production.
Nous avons besoin de soutien parce que c'est un enjeu de souveraineté pour notre filière des semences et pour notre pays. Nous nous sommes associés aux travaux lancés récemment, notamment dans le cadre du programme Écophyto 2030. Une task force spécifique aux semences a été mise en place pour essayer de trouver des solutions. C'est pour nous un enjeu vraiment essentiel de pouvoir sécuriser la production sur notre territoire.
Pour terminer, une fois que l'on a récolté cette production, elle vient dans nos usines pour y être séchée, triée, éventuellement traitée et conditionnée. C'est un maillon extrêmement fort puisqu'on est à la base de la chaîne alimentaire. Il faut à tout prix préserver la quantité et la qualité. Dans ces usines, nous sommes utilisateurs des produits phytosanitaires de deux manières, d'abord pour les traitements de semences et ensuite pour les insecticides de stockage.
Premièrement, les traitements de semence. Il faudrait quand même rappeler que ces traitements sont pour nous un excellent moyen de réduire la pression de la chimie. A impact égal, la quantité de produits que nous utilisons sur un hectare de terres agricoles correspond à celle qui serait utilisée ensuite sur 50 mètres carré. Les traitements sont donc pour nous un outil dont il ne faut pas se priver. Concernant nos ouvriers qui appliquent ces traitements en usine, des efforts ont été accomplis pour éviter le plus possible de les mettre en contact avec les produits et pour vraiment mettre la juste dose, afin de ne pas gaspiller de produits.
Deuxièmement, les insecticides de stockage. Nous avons de plus en plus de difficultés pour ce stockage, du fait de la pression environnementale qui s'accroît, avec des étés et des hivers de plus en plus chauds, qui font que les larves ne sont pas détruites. Nous commençons à voir apparaître sur le marché certaines technologies sans produits de traitement, des technologies thermiques, des technologies de mise sous vide ou de mise sous gaz, mais qui posent aussi d'autres problèmes. Il est clair que nous ne pouvons pas nous passer des insecticides de stockage. A défaut, en cas d'attaque de charançons, vous ne pouvez pas vendre votre silo pendant trois semaines !
Je souligne, en conclusion, que nous avons vraiment une filière d'excellence, qui est une vraie richesse pour la France, qui peut avoir un impact majeur sur la transition agroécologique et qui mérite, ainsi, d'être valorisée.

Ma première question concerne l'interaction, en termes de capitaux et de donneurs d'ordres, entre le monde de la semence et le monde de la phytopharmacie. Dans le paysage français et mondial, on a l'impression d'une d'intégration croissante de ces deux mondes.
Nous avons vécu un mouvement important de concentration ces dernières années. Des entreprises de la phytochimie ont essayé de compléter leur arsenal en venant dans le domaine des semences, générant ainsi un grand nombre de concentrations. Mais nous avons aussi, a contrario, des exemples assez récents de désinvestissements dans le domaine de la semence de la part de quelques entreprises de la phytochimie.
Je pense que ce sont deux mondes certes complémentaires dans leurs actions, mais qui se caractérisent par des compétences et des savoir-faire assez différents. Nous assistons plutôt à un renforcement de structures semencières fortes. Les structures de la phytochimie ont davantage tendance à se développer en direction du biocontrôle.

En termes de création de brevets, que contrôlent les firmes phytosanitaires dans le monde de la semence ?
En tout, plus de deux-cents entreprises de production occupent le secteur, dont soixante-dix entreprises de créations variétales. On se focalise beaucoup sur les trois ou quatre grands acteurs internationaux qui sont effectivement aussi des agrochimistes, mais le secteur des semences est bien plus large, grâce à une diversité d'acteurs très importante. Parmi ces acteurs, il y a des petites entreprises locales de création variétale.

Bien sûr, il y a de tout. On va trouver des startups, des PME, des entreprises familiales. Mais, pour que le petit ne cache pas la concentration des gros, pouvez-vous me dire quelle est la part des brevets produits récemment par des firmes multinationales, par des entreprises sous contrôle coopératif ou par des PME européennes ? Ou, à défaut, pouvez-vous m'indiquer la part relative de leurs chiffres d'affaires ?
Nous vous communiquerons les chiffres par écrit.

La biodiversité végétale est aussi générée par une biodiversité économique. La concentration des acteurs peut fausser la recherche de solutions équilibrées. On va avoir besoin de solutions et pour cela, il faut une vraie concurrence.
Il existe quand même des entreprises françaises de taille correcte, extrêmement puissantes et influentes dans ce secteur.

Ce phénomène de concentration est un enjeu majeur pour l'agriculture de demain.
Pouvez-vous nous redire quelles sont les procédures françaises d'admission à la commercialisation ? On aura passé beaucoup de temps sur le régime d'autorisation des produits phytosanitaires, parce que c'est le cœur de notre sujet. Pouvez-vous dire en quelques minutes comment fonctionne le régime d'admission à la commercialisation des semences dans notre pays ? C'est un régime singulier, qui est distinct du système américain ou du système asiatique et qui est plutôt une fierté française. Est-ce d'ailleurs une fierté européenne ?
Ce processus global débute par l'inscription. En France et en Europe, les semenciers sont attachés à cette forme de protection de la génétique qu'est le certificat d'obtention végétale. Sans chercher une confrontation, il s'oppose au système du brevet.
L'Union française de semenciers vient de rappeler sa position sur les conséquences en propriété intellectuelle liée à l'utilisation des NBT. L'intégralité des semenciers présents ont exprimé une position unanime en faveur de la prévalence du certificat d'obtention végétale (Cov) par rapport aux brevets. Le certificat permet en effet l'enrichissement, année après année, et le croisement de ces génétiques, alors que le brevet est un système plus fermé, qui permet moins de tirer parti de la diversité génétique.

Vous me préciserez si ce Cov est français ou européen. On peut le polariser par rapport à d'autres systèmes, celui du brevet notamment, qui courent dans le monde. Mais quels sont ses principes et ses vertus ?
Le certificat d'obtention végétale est une forme de protection qui reconnaît l'innovation de l'obtenteur. Il est attaché à une description des caractéristiques de la variété pour éviter le vol pur et simple d'une innovation variétale, mais n'empêche pas l'utilisation par un tiers. On donne tout droit à ce qu'un autre obtenteur puisse venir utiliser cette variété pour la croiser avec d'autres variétés et en créer quelque chose qui doit, à la fin, être différent, et constituer une amélioration par rapport à la variété de départ.
C'est donc un système ouvert qui reconnaît un titre de propriété sur l'innovation, l'inventivité, avec les retours commerciaux attendus si vous vendez cette variété. Je peux déclarer que cette variété m'appartient, je l'ai créée, je l'ai multipliée, je vous la mets à disposition, et j'ai donc droit à une juste rémunération pour ce travail d'inventivité. Cependant, je n'empêche pas une autre structure d'avoir accès cette variété pour en faire quelque chose d'autre.

Quand l'agriculteur achète une semence certifiée, il paye le droit de propriété, la recherche et le développement. Il va permettre le réinvestissement. Il y a une reconnaissance du travail fait par les obtenteurs, mais il ne peut pas lui-même reproduire cette semence et la vendre avec le même droit de propriété. Ce serait du vol, en l'occurrence. En revanche, il a le droit de ressemer cette semence et de l'utiliser.
Dans les systèmes de brevets, il y a le risque potentiel, sur le plan commercial, de créer une dépendance de l'agriculteur à chaque semi. Est-ce une sorte de monopole ? Je crois qu'il y a en réalité deux sujets distincts, derrière cette problématique du brevet. Celle du rapport à l'agriculteur et celle du rapport aux autres chercheurs de solution. Le système français est ouvert. Il permet à d'autres de s'appuyer sur cette innovation pour produire d'autres innovations. Dans le système du brevet, c'est plus difficile. Ma reformulation vous paraît-elle convaincante ?
Vous avez effectivement la relation entre les obtenteurs. Lorsque votre propriété intellectuelle a été actée par un Cov, c'est la variété que vous allez commercialiser. Dans ce cas, elle vous appartient. Si vous êtes un autre obtenteur, vous avez le droit d'utiliser, à des fins de recherche, la variété commercialisée, sans payer de droits. Si vous développez une autre variété qui a des caractéristiques qui vous permettent de l'inscrire au catalogue, vous pourrez la commercialiser.
Lorsque l'agriculteur achète les semences, si elles sont certifiées, il paye les droits. S'il veut renouveler ses cultures à partir de semences de ferme, il doit juste payer une somme destinée à rémunérer la recherche faite initialement. Il a le droit de faire des semences de ferme à partir de variétés qui ont été achetées une fois.
Il y a donc bien deux exemptions, celle des agriculteurs et celle des obtenteurs, laquelle permet d'entretenir une création variétale sans limites. Dans un système de brevet, un obtenteur qui voudrait utiliser la semence d'un autre obtenteur doit d'abord obtenir l'autorisation du détenteur de brevet.
Le certificat d'obtention végétale n'est pas un système proprement français ; c'est un accord international qui regroupe aujourd'hui plus de soixante-et-onze pays à travers le monde, et qui constitue la base de la protection intellectuelle des semenciers au sein de l'Union européenne et en France.

Nous pouvons dire qu'il y a une inspiration française, une école française de la semence qui a largement contribué à cette doctrine internationale. Dans un système de brevet, le détenteur d'un brevet peut-il empêcher l'agriculteur de ressemer sa semence ?
C'est une possibilité. Le brevet n'exclut pas, dans sa définition, que l'agriculteur puisse réutiliser la variété brevetée, mais il est tout à fait possible de rajouter à titre individuel des conditions qui excluent la réutilisation d'une semence avec un brevet.

Une part importante de la recherche mondiale est opérée par des industries et des entreprises qui sont elles-mêmes productrices de produits phytopharmaceutiques. Cela introduit une sorte de biais dans le consensus sur la nécessité à s'affranchir de la phytopharmacie. Quand vous êtes purement des semenciers, vous pouvez rechercher l'intérêt de l'agriculture, de l'agriculteur et de la société, en contribuant à cet objectif de réduction de la phytopharmacie. Est-ce que vous admettez que la perspective et les motivations ne sont pas tout à fait les mêmes, pour une firme qui intervient à la fois dans la semence et dans la phytopharmacie ?
Par ailleurs, comment coopérez-vous avec la recherche publique ? Quelle est la part de l'innovation publique dans l'innovation liée à la semence dans notre pays ? Y-a-t-il des certificats d'obtention produits par l'Inrae ou par d'autres instituts de recherche scientifiques publics en France ?
S'agissant de votre première question, nous sommes forcés d'admettre que la perspective est nécessairement différente, même s'il faut avoir en tête que, dans ces entreprises, la semence et la phytopharmacie constituent quand même souvent des canaux séparés.
J'ai du mal à répondre à la première question, étant moi-même dans une société purement semencière ; je ne sais pas du tout ce qu'il peut se passer dans des sociétés qui auraient cette double activité. Je tiens quand même à redire que pour obtenir l'inscription d'une variété, le modèle est le même pour tous. En tant que firme, vous avez un intérêt à générer du progrès génétique, à générer des résistances dans vos variétés, parce que cela vous donne autant de possibilités de sécuriser l'inscription de ces variétés et donc de pouvoir les commercialiser. Sans inscription à un catalogue européen, il n'y a pas de commercialisation possible pour la majorité des espèces.
Concernant la recherche publique, nous avons la chance, dans le système français, d'avoir des appels d'offres, des programmes scientifiques qui ont choisi comme prisme de ne rendre éligibles des projets qu'à partir du moment où ils sont construits en partenariat public-privé. C'est également le cas du fonds de soutien aux obtentions végétales, qui impose également ce travail en partenariat.
Il est cependant réaliste de reconnaître que, dans les entreprises de sélection, on ne souhaite pas mutualiser tous ses secrets, tous ses savoir-faire avec d'autres. Le risque d'une association avec la recherche publique, c'est qu'elle découle sur une publication qui mettrait au grand jour un certain nombre de méthodologies de sélection, voire de gènes de résistance. Certaines entreprises ne le souhaitent pas.
Même s'il y a des exceptions à cette collaboration, les partenariats restent extrêmement dynamiques. Nous devions pouvoir vous communiquer quelques éléments chiffrés à ce sujet. À titre très personnel, mon entreprise mène une centaine de projets de recherche en Europe avec des structures publiques, ce qui nous permet de bénéficier de savoir-faire que nous n'avons pas.

Vous avez parlé de NBT. Une clarification sémantique me semble nécessaire au sujet de ces nouvelles technologies du végétal, dans un contexte où plusieurs appellations circulent.
Pouvez-vous nous dire quels espoirs suscitent ces NBT du point de vue de la maîtrise de l'usage de la phytopharmacie et quels sont potentiellement les risques qui sont attachés à cette technologie ?
NBT était le terme premier que nous utilisions. Nous préférons aujourd'hui parler de NGT pour New Genomic Techniques. Le champ couvert reste le même. Cette technologie permet de générer des mutations ciblées dans le génome. Si vous avez la connaissance d'une séquence d'ADN, vous avez la capacité d'effectuer une mutation ponctuelle ciblée et de regarder la conséquence de cette mutation. Je vous donne un exemple pour l'illustrer. Vous avez un gène de résistance à une maladie, par exemple la septoriose du blé, extrêmement dommageable actuellement en France. On connaît aujourd'hui douze gènes de résistance à la septoriose, qui sont utilisés dans quasiment tous les programmes de sélection des obtenteurs de blé en France. Grâce aux NGT, demain, vous aurez la capacité, dans chacun de ces douze gènes, de venir changer quelques bases et de regarder si le nouveau gène, avec cette mutation, devient encore plus résistant à la maladie que ne l'était le gène primaire. Voilà ce que permettent de faire les NGT. Cela ne vous exempte pas du travail d'analyse et de sélection, pour regarder si la modification que vous avez apportée représente un avantage ou non.
Cette technique permettra d'aller beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus ciblée dans ce travail de sélection. L'une des craintes exprimées par la profession semencière, c'est l'éventualité d'une prise de brevets derrière ces technologies, pourrait éventuellement pousser à la multiplicité des brevets existants et même à venir breveter des caractéristiques qui nous semblent natives, donc existantes dans la nature, même si elles ont été légèrement augmentées.
La position de notre association consiste à dire que puisque nous souhaitons que le certificat d'obtention végétale reste la forme de protection première, nous ne souhaitons pas voir arriver une prévalence du brevet pour les NGT.

Je vous pose la question de ce qu'on peut attendre des NBT et vous nous dites craindre que les brevets viennent s'approprier cette nouvelle technologie. Pourquoi cette crainte ? Ne pourrait-on pas continuer le récit français des soixante-dix pays qui nous suivent avec le certificat d'obtention végétale ? En quoi y a-t-il une association entre la rupture technologique que constituent les NGT et la question des brevets ?
Il y a un nouvel élément, l'Office européen des brevets, qui a une lecture de ce qui est brevetable ou non, et qui pourrait rendre éligible une prise de brevets sur un certain nombre de caractères.

Je voudrais que vous nous donniez votre avis sur le lien entre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et l'activité de sélection variétale génétique de nouvelles technologies.
Historiquement, le mouvement de société remettant en cause un certain modèle agricole très dépendant des produits phytopharmaceutiques est parti de la controverse sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). Votre propre mission de sélection variétale, de travaux génomique pour générer de nouvelles variétés, n'est au fond pas très loin de ce qui est critiqué dans cette agriculture productiviste. Etes-vous confiant dans votre capacité à vous inscrire dans ce mouvement de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques ? En toile de fond, il y a la question du glyphosate.
Je pense qu'il faut faire un « défocus » chronologique parce que le métier de sélectionneur est beaucoup plus ancien que l'apparition de la technologie. Le métier de sélectionneur a commencé de manière professionnelle et industrielle au cours du XXe siècle. La culture de ce métier consiste bien à trouver les ressources dans la nature pour améliorer les performances des plantes.
Améliorer les performances des plantes, cela veut dire trouver des plantes qui, en elles-mêmes, sont plus résilientes, résistantes au sec, aux aléas climatiques et aux bioagresseurs, qui puissent résister toutes seules, sans apport de produits phytosanitaires. On n'y arrive pas à 100 % par la sélection. C'est la raison pour laquelle est mené un travail conjugué des deux types d'activités, le métier de sélectionneur qui va chercher les ressources dans les plantes, et une autre activité consistant à venir en complément, comme un médicament, quand la plante n'arrive pas à se défendre toute seule.
Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la philosophie du métier. Il peut y avoir certaines convergences. Nous avions fait une enquête auprès de nos adhérents sur la répartition de leurs efforts de recherche en fonction des différents critères que sont la résistance au sec, la résistance aux bioagresseurs, la résistance aux aléas climatiques ainsi que la résistance à certains produits phytosanitaires. On constate que la majorité des axes de recherche ne sont pas liés aux produits phytosanitaires. Nous vous communiquerons les résultats de l'enquête.
M. . Si la question consiste à savoir si l'utilisation des NGT va se focaliser de façon majoritaire sur le développement de mutations pour générer de nouvelles tolérances aux herbicides, je dirais que c'est une application possible, mais il serait dommage de cantonner une technique aussi puissante que les NGT à des sujets aussi simples que la tolérance à un herbicide souvent contrôlé par un nombre de gènes extrêmement faible, voire un seul gène.
La perspective que nous avons, c'est de rendre possible ce qui ne l'est pas aujourd'hui, ou très difficilement, avec des méthodologies de sélection conventionnelle. Il s'agit d'apporter des modifications pluri-cibles, pluri-gènes, pluri-allèles, pour répondre à des critères dits complexes comme l'amélioration du rendement et la tolérance à des stress climatiques ou développer des profils de résistance, notamment aux maladies fongiques.
Le ministère de l'agriculture s'appuie sur le comité technique permanent de la sélection (CTPS) qui oriente la sélection en fonction de la vision que le pays a de l'évolution de son agriculture, en fonction de la règlementation, y compris communautaire. Une partie de la réponse à votre question dépend ainsi de la vision politique qui sera donnée demain, quant à l'encadrement de ce processus de sélection, pour accompagner l'agriculture dans les transitions et face au changement climatique.

Je voulais interroger Monsieur Pagès sur un point de son exposé qui m'a semblé très important. Vous dites que certaines semences ne sont plus produites en France, et que c'est le résultat de la suppression ou du retrait de molécules phytopharmaceutiques, qui ne permet plus de cultiver ces semences dans des conditions satisfaisantes. Vous n'avez pas le temps de nous faire l'inventaire des cultures concernées, des molécules retirées mais, si disposez de documentation, il pourrait être intéressant de nous la communiquer.
Pouvez-vous quand même nous préciser si ces semences sont toujours produites en Europe ou dans l'Union européenne ? Nous savons que la question de la souveraineté est redevenue prégnante. Nous l'avons vu au moment du Covid-19, s'agissant des médicaments et des masques. Dans l'hypothèse de mauvaises récoltes, de pénuries ou de tensions géopolitiques, la France peut-elle, du fait de cette perte de souveraineté, se retrouver dépourvue de semences pour certaines cultures ?
Ces productions se font désormais à l'extérieur de l'Union européenne. Nous pourrons vous apporter les précisions utiles. Les retraits des molécules sont souvent liés à des interdictions européennes. Mais la production de semences est une activité qui est mondialisée. Et l'on importe, dans l'Union européenne, des semences parfois très ciblées sur des petites espèces potagères ou autres, que nous ne sommes plus en mesure de produire chez nous.
Nous, agriculteurs, avons besoin de solutions pour produire. On nous donne des contrats de multiplication en accord avec des établissements semenciers, avec des engagements de production et de qualité. Pour répondre à ces engagements, on a besoin de moyens de production. On ne peut pas produire de façon satisfaisante et sécurisée si on ne protège pas nos productions. Les semences, c'est un excellent vecteur de maladies. Pour se prémunir contre cela, comme le stipulent les cahiers des charges et la réglementation nationale européenne, des contrôles sanitaires sont assurés. Je suis producteur de semences de tournesols ; il ne faut pas qu'il y ait de mildiou dans le tournesol, sinon c'est détruit. J'ai donc besoin d'avoir des solutions de production.
Nous sommes très en attente de solutions autres que phytosanitaires. Nous n'utilisons pas ces produits par conviction, mais par besoin. Les pas de temps ne sont souvent pas les bons quand on n'a pas de solution. Les entreprises semencières font tout un travail d'adaptation de capacité des espèces et des variétés. Mais il y a souvent un décalage entre le moment du retrait des solutions phytosanitaires et celui où des solutions arrivent par les semences. Ce sont dans ces intervalles qu'on est extrêmement vulnérable.
Un semencier qui a des besoins de semences, en radis par exemple, et n'a pas la possibilité de les produire sur le territoire national, va aller chercher des solutions ailleurs. Mais il doit pouvoir mettre sur le marché des semences de ces espèces. On doit s'adapter en permanence. La Fnams, qui est la Fédération des agriculteurs multiplicateurs de semences, a tout un volet d'activités sur l'expérimentation, la recherche et développement pour essayer de trouver des solutions palliatives aux retraits de molécules. C'est une question de capacité à produire et de souveraineté, qui est prégnante pour les petites espèces mais aussi pour les espèces plus importantes. Le retrait du S-Metolachlore en production de semences de maïs est un vrai problème pour nous. Il est difficile de trouver des solutions alternatives parce que l'on travaille sur du matériel reproductif beaucoup plus fragile et parce qu'on a des lignées qui ne sont pas résistantes. Tout cela fragilise le secteur à un moment où la concurrence est quand même présente. À chaque fois qu'on limite notre capacité de production, on ouvre la porte à des semenciers d'autres pays. Je ne pense pas que l'on risque de manquer de semences. Mais quant à dire que ces semences continueront à être produites en France ou en Europe, c'est une autre question.

La production de semences est, quelque part, intolérante aux maladies. Dans le même temps, il n'y a pas de régime dérogatoire pour la production de semences, c'est-à-dire que les producteurs de semences ont les mêmes contraintes en termes d'utilisation des produits phytosanitaires que la production normale. C'est bien ce que vous confirmez maintenant.
Des dérogations sur des utilisations de produits, nous n'en avons quasiment plus. Quand on considère la qualité d'une semence, il y a deux aspects. Il y a d'abord une notion de compétitivité, qui implique un certain niveau de production. Dans ce point de vue, on peut accepter que la plante soit attaquée, on aura peut-être un rendement qui sera plus bas, mais à la limite, cela entre dans le calcul de la compétitivité.
Mais par ailleurs, la semence est un véhicule pour les maladies. Pour les espèces potagères, on doit s'organiser pour n'avoir aucune maladie dans les semences. Or, le règlement phytosanitaire s'applique à tout le monde. Ainsi, si nous ne sommes pas capables de garantir cette qualité attendue pour la semence, nous perdons les contrats, nous n'avons plus accès à la production. Le risque est de ne pas avoir les semences dont on a besoin, ou que la production parte hors du territoire européen. Et là, c'est une question de souveraineté.
Il y a bien deux sujets. Premièrement, les exigences réglementaires sont plus strictes pour la production de semences. Par ailleurs, les lignées en champs de production sont souvent beaucoup plus fragiles vis-à-vis des agents pathogènes que l'hybride qui en descend. On a ainsi besoin, pour la semence initiale, de moyens de préservation dont on a moins besoin pour l'hybride descendant.

J'aimerais savoir dans quel modèle agricole les NGT s'inscrivent. Avec les produits phytosanitaires, on a perdu en compétences, si je peux me permettre, en termes de technique d'agronomie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution qui s'inscrit dans un modèle plus global, qui inclut également des évolutions agronomiques et le biocontrôle ? Mesure-t-on l'impact à long terme de cette technologie sur l'environnement, voire sur la santé ? Si aujourd'hui les NGT étaient autorisées, en combien de temps pourrait-on faire cette transition ?
Ma dernière question s'entend par rapport à l'export. Je pense notamment à la question de la phosphine qui a fait débat ces derniers mois. Typiquement, cet exemple pourrait-il être résolu ou pas du fait des contraintes que les pays étrangers nous imposent ?
Je peux faire une réponse d'agriculteur : il n'y a pas une technique qui viendra se substituer à une autre dans la transition que l'on est en train d'opérer ; on le voit bien sur nos exploitations. Oui, on a pu fonctionner par le passé en se disant que les solutions phytosanitaires apportaient la réponse à tout. On a un problème, on fait un traitement et c'est réglé. Ce changement de modèle, on le porte aussi parce que la société l'attend et parce que les agriculteurs font partie de la société. On n'est pas différent des autres.
Mais il n'y a pas de réponse universelle. Les NGT ne régleront pas tout, mais on en a besoin parce qu'il y a des résistances variétales. C'est aussi un outil qui nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes. On redécouvre les vertus de l'agronomie et heureusement, je pense que c'est important. Des outils sont à notre disposition, des outils d'aide à la décision, des outils de pilotage. Je suis agriculteur depuis trente ans. Avant, j'arrosais beaucoup, je ne savais pas trop ce que je faisais et aujourd'hui, tout est piloté sur mon exploitation.
Il n'y a pas une solution, on a besoin de toutes les solutions. Les NGT en font partie, au même titre que l'agronomie. On est engagé dans ce processus, mais on a vraiment besoin de tout pour répondre aux attentes. Il ne faut quand même pas oublier que l'on a aussi besoin de produire. La qualité est essentielle. La façon dont on va produire est essentielle. Les récents événements sur la planète nous montrent que l'équilibre alimentaire est fragile. On a besoin de tout mener de front.
Je ne suis pas persuadé que les NGT soient un élément favorisant ou défavorisant d'un retour à plus de compétences agronomiques. Je pense que ce qui fait vraiment l'évolution majeure, y compris dans les entreprises semencières, c'est la prise de conscience que la variété ne pourra de toute façon pas répondre, avec ou sans les NGT, à 100 % des problématiques. Les réponses seront multiples. On a probablement oublié le retour aux basiques ; il ne faut plus seulement raisonner à l'échelle de la culture, mais au niveau d'un système de culture, au niveau d'une exploitation, au niveau de la vie du sol.
Tous ces paramètres reviennent en force et pas forcément grâce aux NGT, mais parce que c'est incontournable si on veut être en capacité d'apporter des éléments de réponse aux enjeux. Les NGT viendront s'inscrire dans cette voie, en permettant l'obtention de produits qui apporteront des nouvelles caractéristiques, mais elles ne feront pas la révolution agronomique. Cette révolution est déjà en cours chez bon nombre de semenciers.
Votre deuxième remarque portait sur les NGT et la santé. J'avoue que je me sens à peine compétent dans ce domaine. La réglementation a défini – même si ce n'est pas encore finalisé – deux grandes catégories. Dans la catégorie 1, on trouve les modifications qui auraient pu être trouvées ou développées par un process naturel. Cela implique un nombre d'interventions dans le génome extrêmement faible, sans introduction d'ADN externe. Si vous avez changé, dans une base d'ADN un C par un T, on peut penser que l'impact est nul. Par ailleurs, la réglementation semble avoir prévu une catégorie 2 où les modifications seraient plus massives et pour lesquelles il faudrait probablement passer par un processus d'évaluation un peu plus lourd.
Concernant votre dernier point, je ne me sens pas en capacité de vous apporter une réponse pertinente.

Ma première question s'adresse à M. Guerreiro. Vous avez dit que ces dernières années ont vu la concentration, au sein de plusieurs entreprises, d'activités de phytochimie et de semences. Les semences, on l'a dit tout à l'heure, sont une alternative sérieuse, d'excellence aux produits phytosanitaires et donc un élément clé dans la réussite du programme Écophyto. N'y a-t-il pas un conflit entre les intérêts commerciaux des entreprises qui concentrent ces deux activités et les attendus du plan Écophyto ?
Ma deuxième question s'adresse davantage à M. Pagès. C'est un cas pratique qui concerne la production de plants résistants à l'usage de produits phytosanitaires. En juillet, au début de notre commission d'enquête, nous avons reçu des chercheurs de l'Inrae qui nous avaient parlé de certaines variétés de pommes de terre développées par les chercheurs et résistantes aux bioagresseurs, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un traitement phytosanitaire.
Cependant, de passage à Bretagne Plants, dans ma circonscription et plus précisément dans ma commune, j'ai aussi cru comprendre que seules certaines variétés de pommes de terre sont considérées conformes ou retenues pour les besoins du marché industriel de la pomme de terre. Comment travailler avec les agriculteurs et les industriels pour promouvoir les variétés de qualité ? Quel rôle pour le politique dans cette perspective ? J'imagine qu'il s'agit là d'un travail à l'échelle de la filière ?
On essaiera de vous donner des chiffres plus précis, mais la proportion de structures semencières indépendantes, sans activité dans le domaine des produits phytosanitaires, est quand même assez écrasante par rapport aux quelques multinationales auxquelles vous faites allusion. Certes, ces dernières ont un poids très important, mais il y a quand même, en nombre, énormément plus de structures qui ont une activité uniquement dans les semences et qui visent à l'amélioration des variétés commercialisées. C'est là une réalité bien plus prégnante que les quelques acteurs qui pourraient avoir un pied dans les deux univers et être critiqués ou critiquables. Je laisse le législateur décider si la réunion de ces deux activités est compatible avec le droit ou la réglementation. On a énormément de structures semencières performantes en France, en Europe, voire dans le monde, qui ne font que de l'amélioration génétique et qui délivrent des variétés.
Je vous propose que nous vous communiquions ultérieurement les parts de marché par espèce de ces fameuses trois ou quatre grandes sociétés qui peuvent être présentes sur les deux marchés, ainsi que celles des sociétés françaises et européennes. Cela éclaircirait votre doute parce que, pour beaucoup d'espèces, la part de marché des sociétés françaises non impliquées dans l'agrochimie est quand même extrêmement importante.
Vous demandez s'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre la partie agrochimique et la partie sélection. Encore une fois, les axes majeurs de sélection ne sont pas liés aux produits phytopharmaceutiques ; ils visent des plantes plus résistantes naturellement aux bioagresseurs. Nous vous ferons parvenir également cette enquête dont je parlais tout à l'heure.
Cet axe de la sélection pour des résistances à des herbicides n'est qu'un tout petit focus et, dans le cas de NGT, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Nous ferons en sorte de vous communiquer des données factuelles et cela permettra de relativiser, en tout cas sur le territoire français. La situation est différente ailleurs dans le monde.
Effectivement, l'Inrae a développé des plants de pomme de terre qui sont résistants aux maladies. Cette situation révèle la nécessité de travailler en filière. On est dans une chaîne ; on ne travaille pas pour soi, on travaille pour cette chaîne. Il faut en permanence s'assurer que ce que l'on va créer répond au besoin des industriels et du consommateur au bout de cette chaîne. Si l'industriel ne veut pas telle variété de pommes de terre, c'est qu'elle ne correspond pas au marché.
La bonne nouvelle, c'est que l'on a trouvé des plantes qui sont résistantes. Je crois que si l'on a un rôle à jouer, nous, interprofession et vous aussi, les politiques, en appui, c'est pour casser les chapelles qui peuvent se mettre en place entre les différents maillons et pousser pour qu'il y ait des collaborations. Je pense qu'elles existent entre l'Inrae et la filière des plants de pommes de terre. Les industriels ne doivent pas être exclus de ces tours de table parce qu' in fine, ce sont eux qui décident s'ils ont besoin ou pas de ces variétés. Toute l'organisation que l'on a mise en place dans l'interprofession permet cela. C'est toute la question de l'articulation entre les sélectionneurs et le marché pour lequel on travaille, parce qu'on travaille toujours pour un marché.
Peut-être une lueur d'espoir, Madame la députée, qui ne concerne pas les pommes de terre mais l'orge. L'orge est également touchée par un puceron qui transmet un virus. On a réussi à rendre certaines variétés résistantes non pas aux pucerons, parce qu'on laisse le puceron venir piquer le plant d'orge et y véhiculer son virus, mais au virus. On a trouvé une solution génétique qui permet, quand le virus est introduit, de le localiser à l'endroit de sa piqûre. Ainsi, il ne se diffuse pas dans la plante. On a réussi à le faire au début sur des variétés d'orge fourragère qui ne répondaient pas aux besoins des industriels impliqués dans la création du malt et la transformation en bière. Aujourd'hui, après trois années de sélection, des variétés résistantes ont été inscrites sur le segment des orges brassicoles.
La sélection est un procédé vraiment itératif qui permet de faire des améliorations. C'est une question de temps et parfois, on a besoin de solutions de protection des plantes pour nous permettre d'arriver à ces solutions génétiques plus complexes sans nous retrouver dans des impasses.

La question des NGT sera traitée à l'échelle européenne, via le vote d'un règlement. En conséquence, il n'y aura pas de débat français ; il pourra y avoir un débat au sein de la société civile, mais il n'y aura pas de débat législatif ni de décision gouvernementale visant à déployer ou non cette technologie.
On est à maintenant deux mois du lancement officiel de la nouvelle stratégie Écophyto. Nous aurons rendu notre rapport à cette échéance. Le gouvernement nous dit qu'il tiendra compte de nos conclusions. La nouvelle stratégie sera présentée une première fois au mois d'octobre, puis il y aura une période de débat au cours de laquelle notre commission d'enquête rendra ses conclusions. Nos travaux sont ainsi susceptibles d'alimenter directement le plan Écophyto 2030. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de finances, 250 millions d'euros ont été apportés au budget de l'agriculture pour financer des mesures systémiques plus agronomiques ou des solutions techniques comme celles apportées par la technologie végétale.
Face à cette double perspective, nous serions très sensibles à ce que vous nous fassiez des propositions concrètes pour lever les obstacles à un bon déploiement des innovations technologiques en matière de semences, dans le sens qui nous intéresse, c'est-à-dire celui d'une moindre dépendance aux solutions chimiques en termes d'intrants. Nous sommes dans une période où ces propositions ont susceptibles de prospérer, avec notamment le projet de loi d'orientation de l'agriculture (PLOA), qui sera présenté prochainement. Le ministre nous l'a confirmé hier en tête à tête.

Nous avons assisté à une audition de grande qualité, assez technique, sur cet aspect passionnant de la filière que vous représentez, qui est de haut niveau. C'est effectivement une fierté française que d'avoir bâti cette filière avec des acteurs qui sont parmi les plus performants au monde.
Enfin, la commission entend lors de sa table ronde sur le biocontrôle :
- Mme Céline Barthet, présidente de l'Association française des produits de biocontrôle (IBMA France) et M. Denis Longevialle, directeur général ;
- M. Thibault Malausa, chercheur de l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE).

Nous reprenons nos travaux avec la dernière audition de ce jour, consacrée à la question du biocontrôle. Je suis heureux d'accueillir M. Thibault Malausa, chercheur à l'Inrae, spécialiste du biocontrôle, Mme Céline Barthet, présidente de l'Association française des produits de biocontrôle (IBMA France) et M. Denis Longevialle, directeur général d'IBMA France.
Pour information, notre commission a d'abord travaillé à homogénéiser les connaissances des membres de la commission sur les enjeux, qui sont très techniques, des différentes familles de produits phytopharmaceutiques, de leurs modes d'action, de leurs impacts sur l'eau, l'air et le sol. Nous sommes ensuite entrés dans un examen critiques des politiques publiques conduites en matière de réduction des produits phytopharmaceutiques.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le biocontrôle fait partie des produits phytopharmaceutiques, il ne peut donc pas être considéré comme une alternative à ces produits mais comme une alternative à la chimie. Je vais vous demander justement d'être le plus précis possible sur la question des différents modes d'action : micro-organismes, macro-organismes, produits et molécules utilisés, pour que cette exigence de clarté et de rigueur posée initialement soit maintenue au long des travaux de la commission.
Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que vous êtes tenus de prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires.
(Mme Céline Barthet, MM. Thibault Malausa et Denis Longevialle prêtent serment.)
Mon objectif, dans ces sept minutes, va être de présenter de façon générale le panorama du biocontrôle. La définition publiée sur le site du ministère en charge de l'agriculture est la suivante : « Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation de mécanismes naturels ». C'est extrêmement large. La façon dont je présente l'ensemble des stratégies de biocontrôle, qui vont en réalité au-delà des produits et des intrants, consiste en général à poser deux questions.
Premièrement, qui contrôle ou régule les ravageurs adventices ou pathogènes ? Cela peut être des macro-organismes (insectes, araignées, acariens, nématodes) ou des micro-organismes (bactéries, virus, champignons). Cela peut aussi être des plantes de contrôle, des plantes de services. Cela peut être des substances jouant le rôle de médiateurs chimiques, des kairomones, des phéromones ; tout ce qui va régir les interactions à l'intérieur d'une même espèce ou entre les espèces.
Enfin, dans notre définition française du biocontrôle, on parle de « substances naturelles », d'origine animale, végétale ou minérale, le minéral étant vraiment très spécifique à notre définition nationale.
La deuxième question consiste à savoir comment on utilise ces différents régulateurs. Cela peut être sous forme d'intrants, sous forme de produits ; dans ce cas ils seront produits par une industrie, puis commercialisés par un distributeur, et atteindront l'utilisateur.
Mais l'on peut aussi utiliser des organismes et substances déjà présents dans l'environnement, comme le fait le biocontrôle par conservation. Par certaines pratiques, en ajoutant certaines ressources, certains intrants, on va moduler l'activité des organismes déjà présents. Ce type de biocontrôle sort déjà partiellement du champ des produits.
On a également le biocontrôle par acclimatation qui a pour objectif de restaurer un cortège ennemi naturel qui aurait été perdu lors d'une invasion biologique. Une espèce invasive arrive sur notre territoire sans son cortège d'ennemis naturels. On va aller chercher dans son aire native les ennemis naturels qui vont être à la fois spécifiques et efficaces pour les introduire en France.
Enfin, il y a la lutte autocide, qu'on travaille en France sous la bannière du biocontrôle. On utilise le ravageur contre lui-même, par exemple en le stérilisant, en lâchant des grandes quantités de mâles stériles qui vont entrer en compétition avec les mâles naturellement présents. L'opération va perturber la reproduction et faire chuter les niveaux de densité des populations.
Sur le plan technique, le biocontrôle a le potentiel pour remplacer tout ce qui est insecticides et mollusquicides, même si ce n'est pas forcément à très court terme. Cela devient un peu plus compliqué pour les fongicides et surtout pour les herbicides. Pour ces derniers, nous sommes très loin du compte.
A combien se monte l'effort public et privé en faveur du biocontrôle au niveau national ? J'avais réalisé une étude sur une base de données de la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) entre 2017 et 2021. Elle révélait un niveau de subventions sur projets situé entre 5 et 10 millions d'euros par an, sans doute de l'ordre de 20 millions d'euros si l'on inclut les cofinancements, les coûts complets, les salaires publics et privés. On serait donc à peu près à 20 millions d'euros, avec un ratio qui serait de 50/50 entre recherche académique et recherche appliquée, ce qui fait environ 10 millions d'euros par an d'efforts d'innovation et à peu près l'équivalent en développement de méthodes.
Pourquoi le biocontrôle n'est-il pas complètement au niveau des attentes en termes de diminution d'usage des pesticides ? D'abord, l' innovation pool, le tirage par la demande est en panne. C'est quelque chose de très classique sur des innovations qui doivent s'intégrer dans un système très dominant, particulièrement figé dans le cadre des pesticides. Le parallèle est intéressant et même perturbant avec l'automobile électrique, par exemple. Si on lit des articles scientifiques de sociologie de l'innovation sur le biocontrôle et sur l'automobile électrique, on constate que l'on se trouve quasiment dans la même situation. En raison du système agricole et alimentaire, des infrastructures, le biocontrôle est systématiquement pénalisé par rapport à des pesticides classiques. Par ailleurs, il existe une carence importante au niveau de l'aval des filières, le biocontrôle étant peu valorisé à ce stade. De ce fait, les acteurs de l'innovation n'ont pas complètement leur destin en main, de la recherche jusqu'à l'agriculteur. Ce ne sont pas ces gens-là qui détiennent la clé, les choses se jouent à un niveau plus aval.
On a une tendance, notamment en France, à ne penser que produits lorsqu'on pense biocontrôle. Finalement, quand on considère le champ des possibles pour l'agriculteur, les produits sont une partie de la solution, mais ce n'est pas uniquement cela. On déploie à peu près 90 % des efforts sur les produits. Il faut absolument diversifier. Les services et les stratégies de régulation de type biocontrôle par conservation et acclimatation facilitent l'intégration des produits. C'est un énorme angle mort dans tous les pays, et notamment en France.
Il y a aussi une problématique avec notre manière de concevoir l'innovation, selon une logique très top-down en France, héritée des systèmes agrochimiques : le laboratoire trouve la molécule ou l'organisme, l'industriel qui s'en saisit et on essaie de la faire adopter à l'agriculteur. Il faut arriver à innover avec les acteurs, à mettre l'agriculteur au centre du jeu, à valoriser son savoir-faire.
En termes de grande priorités, je dirais qu'il faut transformer, diversifier et utiliser l'ensemble des leviers du biocontrôle. Il faut aller jusqu'au marché, pour inclure l'aval. Par ailleurs, il faut parvenir à mettre en place un phasage simultané, entre les catégories et les types de leviers du biocontrôle, mais aussi avec les autres leviers de l'agroécologie.
Je vais commencer par vous présenter IBMA France, qui nous sommes, qui nous représentons. Nous sommes l'association qui regroupe les metteurs en marché de produits de biocontrôle en France. Cette association a aujourd'hui un peu plus de 25 ans. Vous voyez, ce n'est pas tout nouveau le biocontrôle en France, il existait d'ailleurs bien avant la création d'IBMA France.
Nous regroupons aujourd'hui trente-quatre entreprises du marché français de toutes typologies, aussi bien des grands groupes bien installés que des petites startups qui sont encore en train de développer de nouvelles solutions. Ce sont aussi des activités très variées, aussi bien des sociétés qui ont une activité mixte, avec des solutions conventionnelles et des produits de biocontrôle, mais également des metteurs en marché uniquement sur l'axe du biocontrôle.
L'association fonctionne autour de quatre axes stratégiques majeurs, que je vous cite brièvement. Le premier, ce sont les politiques publiques et la réglementation. Nous veillons en permanence à avoir un cadre réglementaire qui soit favorable aux produits de biocontrôle, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Beaucoup de choses existent, ont déjà été mises en place au niveau français. Au niveau européen, en revanche, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Nous avons également un axe d'information. Nous essayons en permanence d'informer les utilisateurs, qui sont aussi bien les agriculteurs que les amateurs, puisque nos membres couvrent les agriculteurs mais aussi les jardins, espaces verts, infrastructures (Jevi).
Troisième axe, la formation puisque les solutions de biocontrôle ont besoin de beaucoup d'accompagnement, de pédagogie, d'explication. On s'investit beaucoup dans la formation digitale, en essayant de mettre à disposition des formateurs, des conseillers, des supports adaptés à nos produits.
Quatrième axe, la recherche et l'innovation. Nous sommes impliqués dans différents dispositifs. Le dernier en date est le grand défi « biocontrôle biostimulant » avec la naissance de l'association pour le biocontrôle, la biostimulation et l'agroécologie (Abba), qui doit prendre son envol d'ici fin 2023.
Nous avons mis en place depuis environ dix ans un baromètre interne qui nous permet de suivre le chiffre d'affaires des produits de biocontrôle sur le marché français. Il y a dix ans, on était en valeur à environ 5 % du marché français de la protection des plantes. Dans notre dernier baromètre, portant sur les chiffres de 2022, nous avions atteint 10 %. L'objectif fixé est d'atteindre les 30 % d'ici 2030. En valeur, nous sommes à 278 millions d'euros en 2022. J'apporte une précision qui a son importance également : l'ensemble de nos adhérents représentent 90 % du marché français. Vous avez donc une belle représentativité du marché français du biocontrôle avec vous aujourd'hui.
Il nous semblait important aussi de vous resituer le biocontrôle dans le plan Écophyto.
Quelques mois après le lancement du premier plan Écophyto, le député Antoine Herth a remis un rapport au Premier ministre de l'époque, François Fillon, qui cherchait à mieux connaître le biocontrôle et à voir dans quelle mesure il pouvait répondre aux besoins d'Écophyto. Ce rapport, intitulé « Le biocontrôle pour la protection des cultures, quinze recommandations pour soutenir les technologies vertes », est encore une référence aujourd'hui. La période 2010-2011 marque ainsi le début de la prise en compte du biocontrôle dans nos politiques publiques.
Le deuxième temps fort, c'est 2012-2014. L'année 2012 correspond à toute la dynamique autour du projet agroécologique pour la France ; le biocontrôle est alors reconnu comme l'un des fondamentaux de l'agroécologie. La loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, promulguée en octobre 2014, comporte plusieurs mesures relatives au biocontrôle.
Premièrement, elle propose une définition du biocontrôle, dans le cadre de l'article L. 253-6 du code rural. Il s'agit du premier article de la section 5 consacrée au plan Écophyto, au sein du titre III du code rural relatif à la protection des cultures. Ce sera pour nous, pour Écophyto, pour les différents acteurs, la référence de ce qu'est le biocontrôle en France. Cette définition devient, à quelques mots près, une référence au niveau européen.
Pour rebondir sur les propos de Thibaut Malausa, c'est vrai qu'avec cette définition, on est très orienté vers le produit. Cela ne veut pas dire que l'on s'interdit les techniques alternatives qu'il est utile d'associer, de combiner entre elles pour favoriser et asseoir le mieux possible la protection des cultures.
La période 2012-2014, c'est donc l'installation officielle du biocontrôle. En 2014, le député Dominique Potier remet son rapport au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, lequel met l'accent sur des mesures visant à accélérer le déploiement du biocontrôle et l'innovation dans ce domaine.
Le dernier temps fort se situe entre 2018 et 2020. On a changé de majorité présidentielle. Dans le cadre de la loi Egalim, a été ajoutée à la définition du biocontrôle la mention d'une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle conçue sur cinq ans. Cette stratégie a finalement été lancée en 2020. Les axes stratégiques adoptés dans ce cadre recouvrent largement nos propres axes stratégiques, évoqués en introduction.

Cet historique me fait chaud au cœur parce que ce sont des étapes qu'on a bien connues, sur lesquelles on s'est engagé. Il y en a une que vous n'avez pas évoquée : c'est la question du système de coupe-file dans le régime d'autorisation. Il s'agissait de permettre aux solutions de biocontrôle d'être traitées de façon accélérée ou prioritaire par rapport aux solutions chimiques. C'est un sujet sur lequel nous avons très souvent été alertés par des opérateurs qui avaient conçu des produits et voulaient les commercialiser. Le système paraissait embolisé. Il m'est arrivé de plaider sur deux ou trois dossiers en écrivant à l'Anses, en alertant le ministre de l'agriculture. On a même organisé des réunions des parties prenantes à l'Assemblée. On était très attaché à la mise en œuvre du principe selon lequel à moyens égaux, l'Anses doit accorder une priorité aux solutions non chimiques.
Peut-on dire qu'aujourd'hui, l'Anses, parvient à traiter les dossiers de biocontrôle avec les délais suffisamment raisonnables pour que la science fasse son office ? Est-ce qu'il n'y a pas de file d'attente pour les produits de biocontrôle ? Ou est-ce qu'il faut déployer des moyens publics supplémentaires pour aller plus vite dans les solutions ?
Effectivement, et je l'ai abordé très légèrement dans mon introduction en disant que le travail devait être fait au niveau européen. À partir du moment où, en France, on a eu à disposition une définition du biocontrôle au sein du code rural, on a pu mettre en place différents dispositifs pour le favoriser, notamment au niveau de l'Anses. Pour déposer un dossier de demande d'AMM pour un produit, il faut normalement réserver un créneau de dépôt. Ce n'est pas le cas pour les produits de biocontrôle. Et une fois que l'on a déposé son dossier, l'évaluation est accélérée par rapport à un produit conventionnel. Il y a donc deux choses : la priorité et l'évaluation accélérée.
Il y a même aussi un troisième apport qui n'est pas des moindres, celui des taxes que nous payons, nous industriels, auprès de l'Anses, qui sont minorées pour le biocontrôle. Par exemple pour certains produits de biocontrôle, la taxe sera de 2 000 euros, contre 50 000 euros pour un produit conventionnel. Je vous parlais de certains de nos adhérents qui sont des petites structures, des startups qui n'ont parfois pas encore de produits sur le marché, donc pas de revenus. Il est extrêmement important que les taxes soient accessibles pour ces petits acteurs.
Le bilan français est donc plutôt positif de ce point de vue. Mais ce que l'on observe, c'est que, pour autoriser un produit, il y a deux volets. Préalablement à l'obtention de l'AMM, les substances actives doivent être évaluées et autorisées au niveau européen. Or, en Europe, il n'y a pas de définition des produits de biocontrôle. Si vous déposez votre dossier, vous vous retrouvez donc dans le pool commun de toutes les substances actives. Il n'y a pas de priorité ni d'examen accéléré. Il y a donc un goulot d'étranglement important au niveau européen. Cependant, nous avons des signaux encourageant dans le cadre du règlement européen SUR en cours de négociation, qui devrait poser une première définition du biocontrôle. Nous nous en réjouissons d'autant plus que cette définition reste compatible avec ce qui existe déjà en France.

Il était acquis depuis longtemps que cette définition européenne serait l'une des propositions de cette commission d'enquête. Cela semble plutôt bien parti. Si vous vouliez nous écrire en termes précis ce que pourrait être cette définition, pourquoi pas dans une coproduction entre l'Inrae et IBMA, pour avoir une sorte de caution scientifique, nous ferions nôtre votre proposition. Le levier réglementaire, c'est une manière d'accélérer la recherche, le développement, etc.
C'est effectivement le facteur limitant actuellement. On va plus vite à l'Anses pour les produits, mais on est freiné pour la molécule elle-même. Cependant, cela ne vaut pas pour tous les types de biocontrôle. Parfois, il ne s'agit pas d'une molécule mais d'un organisme vivant. Dans cette situation, faut-il quand même passer à la fois par l'Anses et l'Efsa ? Est-ce le même régime pour une molécule chimique ou pour les macro-organismes ?
Par ailleurs, considérez-vous que nous mettons suffisamment de crédits dans le biocontrôle, en termes de recherche publique et privée ? Quelle est la contribution de la recherche fondamentale aux solutions développées par les entreprises privées ? Quelle est la part de la recherche publique et privée ? Comment le domaine public pourrait-il mieux favoriser l'aboutissement de solutions nouvelles ?
Je crois qu'on peut dire de manière consensuelle que l'effort de recherche est assez équilibré entre le public et le privé. On est vraiment sur un ratio de 50/50, avec des vocations plus académiques d'un côté, plus appliquées de l'autre.
Sur la question du transfert, il faut distinguer selon qu'on parle des produits de biocontrôle ou du biocontrôle au sens large. Concernant les produits, il n'y a pas grand-chose de ce qu'on produit en laboratoire qui ne soit pas transféré. Le câblage est excellent. Il y a même plutôt un épuisement de ce qui sort des laboratoires de recherche : tout part vers l'industrie.
Il ne s'agit pas tant de dire qu'il y a trop ou pas assez de recherche en faveur du bioncontrôle. Le problème est plus global ; nous sommes dans une situation de déni qui concerne l'ensemble des leviers de l'agroécologie. Si on regarde les moyens investis à l'après-guerre pour installer et établir les modèles agrochimiques, cela doit être au moins deux à trois supérieur à ce que l'on déploie aujourd'hui en faveur des leviers de l'agroécologie. C'est quelque chose que l'on a tendance à oublier. Je ne pense pas que le biocontrôle soit moins bien loti aujourd'hui que les semences ou la robotique. Mais la dimension globale de l'effort n'est pas adaptée à l'enjeu de transition agroécologique qui est devant nous.

Globalement, il n'y a pas assez pour l'agroécologie, mais dans ce que l'on fait pour l'agroécologie, la part qui va au biocontrôle est raisonnable. En revanche, on a besoin de plus de recherches dans l'agroécologie. Par ailleurs, vous nous dites que le câblage est bon entre les laboratoires publics et les entreprises.
J'aurais peut-être un commentaire un peu plus nuancé. On sort d'une expérience qui s'appelle le consortium public-privé biocontrôle. Lorsqu'on a fait le bilan avec nos adhérents, on voit qu'il y a quand même un fossé entre ce que la recherche fondamentale est capable d'apporter et le moment où les industriels peuvent prendre le relais. On a parfois des choses qui sortent des laboratoires qui sont encore trop loin du marché pour que les industriels prennent le relais. Il peut y avoir de la déperdition à ce niveau.

Y a-t-il encore des choses qui ne vont pas assez vite, qui sont bloquées ? Pouvez-vous caractériser davantage ce fossé à combler ?
Ce n'est pas une histoire de vitesse, c'est surtout une histoire de maturité de l'innovation. L'innovation qui sort d'un laboratoire de recherche public est encore généralement très loin d'être utilisable, transférable à un utilisateur. Il reste beaucoup de développements à faire. Cela induit de la déperdition : tout ce qui sort d'un laboratoire ne donnera pas un produit. Il manque peut-être un maillon dans la chaîne.
Certains moyens pourraient être alloués à des niveaux plus matures pour être proches de l'innovation « agriculteur ». On fonde de grands espoirs sur le grand défi « biocontrôle et biostimulant » et l'association pour le biocontrôle et la biostimulation pour l'agroécologique (Abba), qui devraient justement favoriser le soutien aux projets à des niveaux TRL (technology readiness level) un peu plus élevés, pour aller plus près de l'innovation, sans forcément être dans le corps de ferme.
Je tiens à souligner que le crédit d'impôt recherche est la première source de financement recherche pour les entreprises de biocontrôle. C'est un vrai outil pour accélérer, renforcer, développer la recherche. On en fait beaucoup plus grâce au crédit d'impôt recherche que si on ne l'avait pas.

Il fait l'objet de critiques récurrentes, mais pas quand il s'agit d'aller dans le sens que vous indiquez.
Dans le domaine du biocontrôle, il y avait initialement beaucoup de startups, parfois des PME. Et puis les multinationales de la chimie ont racheté des brevets, en tout cas la propriété de plusieurs produits. Que peut-on dire aujourd'hui, dix ans après le début de ce mouvement ? Le rachat à prix d'or des bonnes solutions par les grandes firmes a-t-il pour effet de stimuler la créativité des entreprises, la recherche des chercheurs et des ingénieurs ? Au contraire, cela a-t-il plutôt pour effet de tarir ce système d'émergence ?
J'ai envie de dire que c'est un bon signe. Ces grands groupes avaient traditionnellement une part de produits de biocontrôle ou de produits alternatifs assez faible dans leur portefeuille. Si vous regardez les feuilles de route de certains grands groupes, vous constaterez qu'il y a de vraies ambitions sur le biocontrôle. Ces ambitions se traduisent effectivement via le rachat de certaines startups. Je dirais que c'est plutôt positif. Elles arrivent sur le marché plus vite, avec des moyens plus rapides. Cela ne tarit absolument pas le gisement de startups ou d'innovations, bien au contraire. De toute façon, il ne faut pas croire que les startups sont armées pour aller jusqu'au marché. Ce serait illusoire. Elles sont excellentes sur l'innovation, elles savent démontrer une preuve de concept, mais viennent ensuite de très nombreuses étapes, et le volet réglementaire en fait partie. Monter un dossier d'AMM est très coûteux et demande une expertise que bien souvent, ces startups n'ont pas en interne. Il y a aussi ensuite la mise en marché qui demande des investissements humains et financiers. De toute façon, les startups ne se suffiraient pas à elles-mêmes. Certaines passent le pas, ont une croissance, passent du statut de startup à celui de PME et grandissent. D'autres se font racheter, mais pas toutes et bien heureusement. On a des exemples d'adhérents qui grandissent.
Je partage cette analyse, il n'y a pas de tarissement. On a au contraire un vivier de startups qui me semble de plus en plus important. En revanche, il y a une tendance au formatage des modèles d'affaires, c'est-à-dire que la plupart des entreprises sont créées, accompagnées, rachetées, avec toujours le même modèle d'affaires qui est : « j'ai la petite molécule, la petite bête biocide. Je la développe en grande quantité, j'en mets une grande quantité au champ ». C'est un vrai problème en termes de déploiement. On manque de diversité de modèles d'affaires. Il faudrait vraiment arriver à d'autres types d'innovateurs, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des associations, pour permettre d'autres types d'innovation. Les produits ne vont pas tout résoudre. En termes de coûts/bénéfices, avec les produits, je mets un euro, j'en récupère vingt. Dans d'autres approches plus collectives, territoriales, je mets un euro et j'en récupère deux mille. Du point de vue de l'agriculteur et des chaînes de valeur, il y a un énorme intérêt à diversifier.
Je voudrais quand même insister sur cet aspect parce seuls les produits de biocontrôle sont définis dans le code rural et on a tendance à se focaliser, dans les discussions, uniquement sur les produits, alors que l'ensemble de la réponse n'est pas là.

Vous évoquez là la question du système commercial. Dans notre système actuel, une molécule chimique s'éteint, on la remplace par une autre molécule chimique qui est moins efficace, elle-même remplacée par un produit de biocontrôle. Il y a un business plan et un modèle d'affaires pour cette approche. Or, le biocontrôle, c'est bien plus que cela. C'est la conservation, c'est lié à la mosaïque paysagère, à l'écosystème de la parcelle, on peut faire appel à des logiques d'importation et d'acclimatation, d'autocide, etc. Mais pour tous ces systèmes-là, il n'y a pas forcément de modèle d'affaires. Pourtant, ce sont des pratiques vertueuses et les investissements sont bons. Comment passer des solutions expérimentales ou marginales à des modèles industriels ou universels qui se généralisent ?
J'aimerais que vous nous précisiez ce que vous entendez par le fait que les infrastructures ne sont pas adaptées au biocontrôle ?
Comme vous le dites, une valeur très importante réside dans le service, la régulation, le paysage, la plante de service, le savoir-faire de l'agriculteur. Mais on n'a pas de modèle d'affaires pour capturer cette valeur. L'un des objectifs du grand défi de biocontrôle et de biostimulation pour l'agroécologie, c'est justement d'aller regarder ce qui se fait à l'étranger, souvent sous des formes différentes, avec des filières qui sont devenues elles-mêmes les acteurs de l'innovation. Certains modèles existent et il faut qu'on arrive à se les approprier et à les adapter au système français.
S'agissant des infrastructures, j'en reviens à ce que je disais sur les voitures électriques. Actuellement, quand on a une voiture électrique, on n'a pas autant de flexibilité, par exemple pour se ravitailler. De la même façon, le biocontrôle ne bénéficie pas de l'ensemble de l'infrastructure disponible, entendue dans un sens très large. Il s'agit des outils, des savoir-faire, de la formation, des agroéquipements. Même au niveau réglementaire, tout est prévu pour les pesticides.

Je vais faire un peu de provocation, n'y voyez aucune arrière-pensée, mais c'est pour aller au fond des choses. Peut-on vraiment parler de biocontrôle lorsqu'il s'agit simplement de recourir à une produit de substitution dit « naturel » ? Cette idée de s'appuyer sur la nature est une bonne chose, on ne joue pas les apprentis sorciers, mais la nature produit des substances extrêmement dangereuses, par exemple la patuline.
Je prends l'exemple de l'acide pélargonique, qui nous sert aujourd'hui à désherber les voies ferrées en France, à la place du glyphosate. Cela nous coûtait 110 millions d'euros avec le glyphosate et cela coûte à présent 270 millions d'euros. On doit passer beaucoup plus souvent parce que l'appareil racinaire n'est pas détruit. En outre, l'acide pélargonique est plus écotoxique que le glyphosate. Est-ce un progrès ou pas ?
Je ne vais peut-être pas vous répondre directement sur la question de l'acide pélargonique versus le glyphosate. Ce n'est pas parce qu'une substance est naturelle qu'elle est vertueuse et moins toxique. D'ailleurs, on n'autorise pas les produits de biocontrôle au motif qu'ils sont naturels. On a bien le même filtre d'évaluation des risques que pour les autres produits.
En revanche, les produits de biocontrôle n'ont pas pour objectif d'éradiquer les insectes, les mauvaises herbes ou les maladies. Ils jouent sur des équilibres de populations de ravageurs, en essayant de les maintenir sous des seuils de nuisibilité. C'est quand même assez différent dans l'esprit. Pour certaines familles, on est bien sur des mécanismes très naturels. Je pense par exemple à tout ce qui utilise les phéromones, la confusion sexuelle. On ne tue rien, on empêche les insectes de se reproduire, pour éviter de retrouver, par exemple, des vers dans des pommes ou dans des raisins.
Globalement, les mécanismes utilisés dans le biocontrôle sont très proches de la nature, ce qui permet de dire que leurs impacts indésirables sont moins importants pour l'environnement.
Je vais peut-être donner un éclairage avec ma casquette de chercheur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément mieux. Toute substance ou tout organisme, d'un point de vue recherche, est pris de la même manière avec les mêmes filtres. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Quand on regarde de grandes catégories de produits, la plupart des pesticides chimiques ont été modifiés pour être plus rémanents, plus résistants. Ce n'est pas le cas pour les produits de biocontrôle. Il y a quand même des patterns qui font que l'on évolue vers plus de respect de l'environnement et de la santé. Cela reste du cas par cas et justifie une vigilance et un niveau de précaution tout aussi exigeant que pour l'ensemble des produits.

Vous n'avez peut-être pas osé répondre à ma question consistant à savoir si c'était un progrès d'avoir interdit l'utilisation du glyphosate pour désherber les voies ferrées, mais votre réponse était plus intelligente qu'un simple oui ou non à cette question.

Les attentes des agriculteurs envers les biocontrôles ne sont-elles pas un peu déçues ou trompées, lorsqu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir remplacer un produit chimique, de synthèse ou bio, par un biocontrôle ? Celui-ci n'aura souvent pas les mêmes effets… Je me demande s'il n'y a pas un problème de communication quant à ce que l'on peut attendre de ces nouveaux produits de biocontrôle.
En réalité, la solution n'est-elle pas le mix, c'est-à-dire un mélange de biocontrôle et d'autres matières pour nous aider ? Vous avez dit que le biocontrôle fonctionnait bien sur les insectes. Mais on sait bien qu'en volume, on utilise bien plus de fongicides pour lutter contre les maladies. Comment parvenez-vous à lutter contre les champignons avec le biocontrôle ?
Effectivement, on ne l'a pas encore dit, mais c'est extrêmement important. Le biocontrôle, ça ne fonctionne pas si l'on pense que l'on va substituer, poste à poste, un produit de biocontrôle à un produit conventionnel. L'approche ne peut être que combinatoire, c'est-à-dire qu'on va changer tout le système, on ne va pas changer juste un élément du système. Quand on parle de combinatoire, il s'agit d'associer d'autres solutions au sens large. Cela peut être des variétés résistantes, travail mécanique, le machinisme, les outils d'aide à la décision (OAD)... Il est vrai que cela demande un effort beaucoup plus important de repenser complètement sa manière de produire. Cela engendre la déception que l'on entend parfois, de la part de certains utilisateurs. D'où l'importance d'accompagner et de faire de la pédagogie et de la formation, parce que ce n'est pas évident.
L'évaluation est accélérée, mais l'évaluation n'est pas au rabais. On a exactement la même grille que pour les autres produits. On passe au filtre du même tamis. On a les mêmes critères. C'est une contrainte, mais finalement, cela donne de la robustesse et une sécurité. On n'a jamais demandé à ce que cette évaluation soit allégée. On veut une priorité, on veut une accélération, mais on veut aussi remplir les mêmes critères que les autres produits.
Les produits les plus utilisés quand on regarde toutes les familles de protection des cultures sont les herbicides, suivis des fongicides et, en dernier, des insecticides. Par ailleurs, on a tout ce qui est lutte anti-limaces et régulateur de croissance. C'est le marché global. C'est vrai que le marché du biocontrôle est complètement inversé de ce point de vue. On est très présent sur les limaces et les insectes, beaucoup moins ensuite. Le parent pauvre du biocontrôle, ce sont les herbicides. La recherche se poursuit chez nos adhérents. On se heurte, en tant qu'association professionnelle, à des questions de confidentialité que vous comprendrez bien.
Notre baromètre donne des indications sur le marché, c'est perfectible, il serait intéressant d'aller à l'hectare. S'agissant de la lutte contre les champignons, il s'agit du troisième type de produit de biocontrôle en matière de pénétration du marché. Sur 100 % de ventes de fongicides en France en 2022, 14 % étaient des produits de biocontrôle. Le biocontrôle est donc présent aussi sur ce secteur, sans être en première position, comme il peut l'être pour les mollusques et pour les insectes.
Vos questions sont au cœur des problèmes que l'on identifie actuellement. On a une énorme marge de progression dans le dialogue entre acteurs de la recherche et de l'innovation pour définir les problèmes, dialoguer sur la façon de les cibler. C'est aussi parce que notre vision est, en général, très contre-productive. On dit toute l'année que ce n'est pas une approche de substitution, mais finalement, très souvent, pour simplifier les messages, on présente les choses de façon substitutive, on fait croire quelque chose qui est économiquement aberrant pour l'agriculteur. Non, on ne va pas pouvoir remplacer un ou deux produits à large spectre par quinze produits de biocontrôle, dont chacun est individuellement plus cher que le produit antérieur ! Il y a énormément de quiproquos.

J'ai une question d'ordre général concernant vos moyens budgétaires. Les moyens budgétaires consentis dans le cadre de ce programme Écophyto pour développer des alternatives à la chimie sont-ils suffisants ?
Je souhaite rebondir sur une vive inquiétude actuelle du monde agricole, qui est la baisse du financement des mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec). Est-ce une évolution inquiétante, sachant que les Maec permettent aussi une baisse de l'utilisation des fongicides, des herbicides ? Il y a des milliers d'agriculteurs engagés dans ces pratiques. Le dispositif semblait efficace sur la période 2017-2023.
Il est toujours compliqué de répondre sur ces aspects budgétaires. Je le redis, on n'a pas pris la dimension actuelle du challenge par rapport à ce qui a été fait à l'après-guerre pour la révolution verte. Nous sommes vraiment sur des ordres de grandeur inférieurs. Je crois qu'Écophyto 2 ou 2+ était financé à hauteur de 75 millions d'euros par an. C'est infiniment insuffisant pour arriver à des objectifs d'impact sur les durées attendues.
Aujourd'hui, s'agissant du biocontrôle, le tirage par la demande n'est pas là. On a un système figé. Le marché est petit. On n'arrive pas bien à englober les services ou la conservation dans ces chiffres, il est donc difficilement d'en faire une estimation juste. Pour les produits, on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions d'euros par an. Dans l'absolu, en termes de filière industrielle, c'est tout petit. Comme la plupart des dispositifs de soutien à l'innovation sont indexés sur l'investissement privé, la machine a du mal à tourner. Tout le monde y met vraiment du sien, les acteurs travaillent ensemble, investissent autant qu'ils peuvent, mais la pompe à l'innovation est insuffisante sur le biocontrôle. Il y a un problème d'insuffisance de moyens par rapport aux objectifs. 10 millions d'euros par an, c'est l'équivalent d'une solution développée, en allant suffisamment loin dans l'intégration de cette solution.
Il faut aussi savoir où sont dirigés les moyens. Beaucoup de moyens vont permettre aux innovations d'apparaître, mais on ne va pas les porter jusqu'au marché et c'est un peu là où l'on pêche en ce moment. Le chemin est extrêmement long et souvent sous-estimé. Des améliorations doivent être apportées à ce niveau.
Vous parliez des Maec. Effectivement, c'est inquiétant puisque c'était un moyen d'accompagner les agriculteurs dans leurs changements de pratiques. C'est une thématique dont on discute souvent. Changer ses pratiques, c'est prendre des risques et on a besoin d'accompagner les agriculteurs dans cette prise de risques. Les agriculteurs ne peuvent pas tout porter tout seuls.
Au lieu de sécuriser et de renforcer tout ce qui va permettre au biocontrôle de s'installer, d'être sur le marché, d'être dans l'intégration, dans les systèmes, d'avoir des systèmes territoriaux, de renforcer cette infrastructure dont je parlais pour le biocontrôle, il y a presque une tendance à la limiter. Il y a beaucoup de solutions, mais elles s'arrêtent toutes à peu près au même moment, quand il faut diffuser aux champs. Ce sont des toutes petites solutions qui ne sont presque pas utilisées.

Il y a toute une question d'accompagnement des agriculteurs. Comment est-ce qu'on peut rassurer quand n'y a pas vraiment de risque ? S'il y a un risque, comment peut-on l'assurer ?
En bio, paradoxalement, on utilise peu de biocontrôle. Est-ce que ce n'est pas une sorte de paradoxe ? En grande culture, en polyculture – élevage, on ne fait pas appel à des biocontrôles. Est-ce une question économique ou une question d'infrastructure globale ? Enfin, les herbicides restent le grand angle mort des alternatives, à part la mécanique, avec ses contraintes. Y a-t-il le début d'une ouverture ? Je n'imagine pas de solution de biocontrôle à même de remplacer les herbicides pour contrôler les adventices.
Les agriculteurs en bio n'utilisent peut-être pas moins de produits de biocontrôle mais, en tout cas, ils n'en utilisent effectivement pas plus. En revanche, ils utilisent plus de biocontrôles au sens large. Ce n'est pas forcément objectivé. Les gens en bio ont trouvé des moyens d'avoir des pratiques qui permettent de réguler la présence des bioagresseurs. Ils créent de la valeur, il doit y avoir du service, il y a du savoir-faire. Il y a un modèle d'affaires lié au bio sur le biocontrôle.
S'agissant des herbicides, des pistes se dessinent à l'Agence nationale de la recherche. Mais l'expérience montre qu'en général, il faut entre quinze et vingt ans entre le moment où l'on est à ce niveau-là et la solution terrain. Ce ne sera donc pas pour tout de suite. L'avantage des pesticides, c'est que c'est à la fois une méthode curative et une assurance. Effectivement, il manque, dans ce que l'on propose actuellement, la question assurantielle. C'est la même chose lorsque je parle du modèle d'affaire et de l'infrastructure : la question de l'assurance est sous-jacente.
Il y a une vingtaine d'années, les premiers utilisateurs de produits de biocontrôle étaient bien souvent des agriculteurs qui étaient en bio. A l'heure actuelle, les produits de biocontrôle sont utilisés à parts égales par les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs bio.
La disponibilité des herbicides constitue une question récurrente. S'il y avait une solution alternative identifiée et qu'on commençait à la faire entrer dans le circuit d'évaluation, sauf à ce qu'elle ait un traitement de faveur, on patienterait au moins sept à huit and. Elle aurait sans doute un traitement de faveur au vu des enjeux…

Quand on voit les controverses sociétales et scientifiques autour du glyphosate, il y aurait un vrai enjeu à pousser des solutions herbicides. C'est pour cela que tout ce que l'on est en train de bâtir devra être entendu, du moins je l'espère.
Quand on aborde ces sujets, on entre souvent sous le sceau de la confidentialité et on a du mal à échanger au niveau d'IBMA France sur ces questions. Une enquête interne qu'on avait réalisée en 2020 montrait que 37 % des projets portaient sur cette thématique des herbicides. On ne sait pas où en sont ces projets.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Anne-Laure Babault, M. Frédéric Descrozaille, M. Grégoire de Fournas, M. Éric Martineau, M. Dominique Potier, M. Loïc Prud'homme, M. Michel Sala, Mme Mélanie Thomin
Excusée. – Mme Marie Pochon