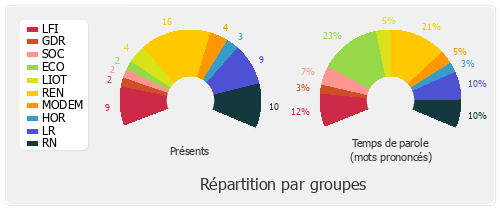Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique
Réunion du jeudi 18 octobre 2018 à 8h45
Résumé de la réunion
La réunion
Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE
Jeudi 18 octobre 2018
Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission
La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à une audition en forme de table ronde sur la filiation : Mme Laurence Brunet, juriste, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne ; Mme Caroline Mecary, avocate aux barreaux de Paris et du Québec, ancien membre du Conseil de l'Ordre ; Pr André Lucas, professeur émérite de droit privé à l'Université de Nantes ; Me Geoffroy de Vries, avocat à la Cour, secrétaire général de l'Institut Famille et République.
L'audition débute à huit heures quarante-cinq.

Nous débutons notre séquence de ce jour par une audition en forme de table ronde sur le thème de la filiation.
Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Laurence Brunet, juriste, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, Mme Caroline Mécary, avocate aux barreaux de Paris et du Québec, ancien membre du Conseil de l'ordre, le professeur André Lucas, professeur émérite de droit privé à l'université de Nantes, et M. Geoffroy de Vries, avocat, secrétaire général de l'Institut Famille et République.
Nous vous remercions, mesdames, messieurs, d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre mission d'information. Les débats sur l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes engendrent de nombreuses réflexions sur les potentielles modifications de l'actuel droit de la filiation.
Dans son étude publiée en juillet dernier sur la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d'État a décrit quatre options à l'établissement du lien de filiation des enfants nés par AMP dans l'hypothèse de son ouverture aux couples de femmes. Il a estimé que l'autorisation de l'AMP pour les femmes seules n'impliquait aucun aménagement particulier du droit de la filiation.
Afin de nourrir et de faire mûrir nos réflexions sur ce sujet, nous souhaiterions connaître vos positions et arguments sur cette problématique.
J'expliquerai pourquoi il est absolument nécessaire aujourd'hui de modifier la loi sur la bioéthique et, par voie de conséquence, les dispositions du code civil sur la filiation.
La loi de 2013 a ouvert le mariage aux couples de même sexe et la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint de même sexe. La plupart du temps, l'enfant est né d'un don de gamètes à l'étranger, en contravention des lois françaises puisque l'assistance médicale à la procréation (AMP) est fermée aux couples de femmes. Le droit, via la procédure de l'adoption, donne la possibilité à la conjointe de la mère légale d'adopter cet enfant.
Du point de vue de la cohérence du droit, il s'agit d'un montage. Fermer les yeux sur le mode de conception de l'enfant et permettre l'instauration d'une seconde filiation me semble un montage incohérent. En ne s'intéressant pas au mode de conception de l'enfant, la loi de 2013 est restée au milieu du gué. Ce compromis, ce montage a été avalisé – et c'est heureux – par la Cour de cassation en 2014, dans un avis qui confirme l'idée que le mode de conception de l'enfant ne doit pas avoir de conséquence sur l'établissement de sa filiation. Bien qu'il ne s'agisse que d'un avis, ce dernier ouvre la possibilité d'adopter l'enfant de la conjointe lorsqu'il est né d'un don de gamètes.
À ce jour, le droit, porteur de certains inconvénients sur lesquels je reviendrai, permet en pratique d'établir une double filiation, mais il me semble que subsiste une incohérence juridique flagrante, puisque, d'un côté, on interdit alors que, de l'autre, on autorise, voire on encourage, en fermant les yeux, le contournement d'une interdiction. Notre droit est devenu illisible. La seule solution consiste à revoir la question de la conception de l'enfant et de permettre l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Tel est le volet qui intéresse strictement le droit de la bioéthique et qui suppose de modifier les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du code de la santé publique. Une fois ouverte la possibilité d'avoir un enfant par don de gamètes en France, il faudra s'intéresser au mode de filiation. Dès lors que l'on considère qu'il est possible pour une femme seule ou un couple de femmes d'avoir un enfant en France, via une technique légitimée et mise en oeuvre par les services d'assistance médicale à la procréation, on ne peut en rester à cette forme de compromis qu'est le recours à l'adoption. Si l'on considère que les deux femmes sont les mères, je ne vois pas pourquoi on imposerait à la seconde d'adopter l'enfant, dans la mesure où cette seconde femme a contribué à égalité, même si elle n'a pas porté l'enfant, au projet parental.
En rester à l'adoption serait incohérent – ce serait une sorte de dénaturation de l'adoption. Au surplus, l'adoption n'est pas sans risques ni insuffisances, on le voit bien au regard de la jurisprudence.
La procédure d'adoption suppose, d'une part, que le couple soit marié et, d'autre part, que le parent légal donne son consentement à l'adoption par son conjoint. Or, il arrive que le couple ne soit pas marié ou qu'il se soit séparé avant la procédure d'adoption. Dans la jurisprudence, on voit plusieurs configurations où les femmes se sont séparées avant le vote de la loi de 2013. Le risque subsiste qu'entre la naissance de l'enfant et l'introduction de la requête en adoption, le couple se dispute et qu'à la suite de tensions, la mère légale refuse de donner son consentement à l'adoption. Ce sont des hypothèses que les tribunaux commencent à rencontrer. L'adoption n'est donc pas une solution suffisamment respectueuse de la vie privée de l'enfant ni de son droit à l'établissement automatique d'une filiation à l'égard de ses deux parents.
Pour l'heure, il n'existe aucune solution pour les femmes qui se sont séparées et qui ne remplissent pas les conditions de l'adoption intrafamiliale ouverte en 2013. C'est ainsi que des tentatives ont été portées par des couples de femmes pour faire établir la filiation par possession d'état. Le Conseil d'État vient de rendre un avis négatif aux termes duquel la filiation de la seconde mère ne peut être établie par possession d'état après séparation du couple. Du point de vue de la cohérence du droit à la filiation, mais aussi sur un plan politique, il est indispensable de réfléchir au mode d'établissement possible de la filiation au regard de la seconde mère.
Le Conseil d'État a fait des propositions. Il a écarté l'idée du statu quo et s'en est tenu à l'adoption intrafamiliale. Il a proposé trois solutions, préférant, dans la première, ce que j'appellerai un régime sui generis propre aux couples de femmes, en élaborant un droit qui serait spécifique aux couples homosexuels. Cette solution ne me paraît pas la meilleure, car elle est attentatoire à l'égalité entre les modes d'établissement comme entre les couples.
Les deux autres solutions consistent à transposer ou à étendre les règles actuelles de la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Aux articles 311-19 et 311-20 du code civil, il conviendrait de substituer aux termes « père » et « mère » celui de « parents ». On pourrait ainsi transposer les règles actuelles de la filiation aux couples de femmes. Une telle formule serait juridiquement plus économique. Sans doute faudrait-il dissocier les articles 311-19 et 311-20 du titre VII dans lequel ils sont inscrits et ouvrir un titre VII bis qui s'insérerait entre le titre VII relatif à la filiation et le titre VIII relatif à l'adoption, car il est nécessaire d'opérer une distinction entre les modes de conception. Même si les règles sont les mêmes, elles sont étendues à un cas qui ne correspond pas aux règles de droit commun de la filiation, dont elles seraient en quelque sorte transposées. Une telle formule permettrait d'étendre la présomption de co-maternité ou de parenté. Tous les pays qui ont modifié leur droit avant nous, tels que le Québec, la Belgique ou le Royaume-Uni, ont choisi cette formule. Ils ont considéré que les règles du mariage et les règles de la reconnaissance pouvaient être transposées, avec quelques aménagements a minima, aux couples de même sexe.
Ce régime retient ma faveur car il me semble qu'en créant un titre VII bis on pourrait à la fois maintenir la cohérence des règles du droit commun de la filiation dite charnelle et distinguer les règles concernant la procréation médicalement assistée avec don de gamètes. Ce titre VII bis s'adresserait aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples constitués par deux femmes. Quant aux enfants, leurs actes de naissance seraient identiques. Cela permettrait d'opérer des distinctions sans tout mélanger et sans que figure sur l'acte de naissance aucune indication, laquelle est toujours traumatique, sur le mode de conception.
Le dernier mode d'établissement envisagé par le Conseil d'État serait un droit, non pas spécifique aux couples de femmes, mais s'appliquant aussi bien aux couples hétérosexuels qui ont besoin d'un don de gamètes qu'aux couples de femmes. Il ne s'agirait pas d'une transposition des règles de la présomption de paternité ou de la reconnaissance, mais d'un nouveau mode d'établissement de la filiation, d'une sorte de déclaration anticipée qui serait en partie constituée au moment où a lieu le don de gamètes et qui, au moment de la naissance, permettrait l'établissement de la filiation de manière directe.
Quelque chose me gêne dans cette solution. Sur l'acte de naissance figurerait un nouveau mode d'établissement de la filiation puisque cette déclaration n'est ni une reconnaissance ni l'application de la présomption de paternité ou de parentalité. Sur un acte de naissance figurent normalement les modes d'établissement de la filiation : par exemple, le fait que l'enfant ait été reconnu ou non entraîne une mention marginale sur l'acte de naissance. Or, tout ce qui figure sur un acte de naissance à propos de la physiologie et se rapporte au mode de conception ou à la corporalité, c'est-à-dire à la physiologie, est extrêmement troublant pour les parents et pour l'enfant. Peut-être suis-je influencée par le fait que je travaille actuellement sur la question des enfants intersexués mais, à mon sens, rien ne doit figurer sur l'acte de naissance – l'adoption exceptée, car l'enfant a une famille d'origine – qui indiquerait les conditions de la naissance de l'enfant ou distinguerait l'enfant né d'un don de gamètes d'un enfant né d'une relation charnelle de ses parents.
Ce régime spécifique qui consisterait en une déclaration anticipée me semble intéressant, car il s'inscrit dans la perspective d'un droit qui serait commun à tous les couples recourant à un don de gamètes, mais il m'inquiète en ce que figurerait sur l'acte de naissance le mode de conception via la mention de cette déclaration. Je sais que les actes d'état civil doivent être numérisés. Nous attendons depuis longtemps la mise en oeuvre d'une réforme qui a été votée, mais qui n'est pas encore appliquée, y compris dans les grandes maternités : les copies de l'acte de naissance ne seraient pas intégrales et tairaient le mode de conception. Or, ce n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle : pour un certain nombre d'actes de la vie courante, tels que l'adoption, le divorce, tout ce qui concerne les questions de nationalité, la copie intégrale de l'acte de naissance est requise. Je suis un peu soupçonneuse quant à la visibilité des modes d'établissement sur un acte de naissance.
Si l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes est autorisée par le droit, il faudra revenir sur la possibilité d'accéder aux origines pour les enfants nés d'un don de gamètes. Pour avoir visionné un certain nombre de vos auditions, bien des arguments ont déjà été développés devant vous. L'argument juridique est important. En effet, sur la possibilité d'accéder à ses origines, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est essentielle. Le droit d'un enfant d'accéder à des informations déterminantes de son identité est un droit aujourd'hui consacré par la CEDH. Il est impossible, surtout si l'on ouvre la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, de maintenir en l'état le principe absolu de l'anonymat du donneur de gamètes. Il me semble indispensable de l'ouvrir, en tout cas, de l'aménager pour non pas lever l'anonymat au moment où a lieu le don de gamètes, mais permettre à l'enfant majeur, de façon encadrée, sous certaines conditions, de demander à accéder à l'identité de son donneur de gamètes.
Monsieur le président, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde autour de la question de l'établissement du lien de filiation d'un enfant qui serait conçu par procréation médicalement assistée en France à partir du moment où la PMA, telle qu'elle existe aujourd'hui, serait ouverte aux couples de personnes de même sexe.
Nous connaissons l'hypocrisie du système actuel qui consiste à ce que des couples de femmes ou des femmes célibataires doivent se rendre dans l'un des quatorze pays qui ont ouvert la PMA aux couples de femmes ou dans l'un des vingt-six pays qui permettent aux femmes célibataires d'avoir accès à la PMA, revenir accoucher en France et engager ensuite un processus d'adoption.
Nous sommes en plein débat sur cette question de l'ouverture. Que nous disent les avis du Défenseur des droits, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et du Conseil d'État ? Ils nous disent à la fois que ces techniques médicales existent depuis plus de cinquante ans en France, qu'elles sont utilisées dans un cadre légal, qu'elles sont réservées aux couples hétérosexuels infertiles.
Ces avis nous disent aussi qu'aucun obstacle éthique ne s'oppose à l'ouverture de la PMA à des couples de femmes ou à des femmes célibataires. Ce point est essentiel car pendant longtemps l'argument nous fut opposé.
Dernier élément non négligeable : le Conseil d'État a rappelé qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques à une ouverture de la PMA.
Nous sommes soutenus par l'opinion publique. Se pose donc maintenant la question du choix et de la volonté politiques. Je pars du principe que cette volonté existe et que la PMA sera donc ouverte à tous les couples et aux femmes célibataires. Se pose alors la question de l'établissement du lien de filiation.
Le lien de filiation est toujours une construction juridique, toujours une construction sociale. Les règles de droit relatives à la filiation sont le fruit d'une élaboration du corps social à un moment donné, dans une société donnée. Au début du XIXe siècle, une femme qui n'était pas mariée avec le père donnait naissance à un enfant que l'on appelait un bâtard. La filiation à l'égard du géniteur de cet enfant marqué d'un opprobre ne pouvait absolument pas être établie car, de 1804 à 1910, la société admettait qu'un enfant n'ait pas légalement de père. Heureusement, les choses ont évolué et ce n'est plus possible aujourd'hui.
À partir de cet exemple, je veux démontrer que la question du lien de filiation n'est pas liée à la biologie ou à la génétique. La présomption de paternité en est un exemple, les règles relatives à l'adoption en sont un autre. Nous pouvons donc envisager des modes d'établissement du lien de filiation pour des couples de femmes qui ont recours à la PMA. Ce sont des constructions sociales qui deviendront des constructions juridiques, incluses dans notre code civil.
Vous l'avez rappelé, monsieur le président, la question de l'établissement du lien de filiation pour une femme célibataire qui accouche ne se pose pas, puisque la filiation de l'enfant sera parfaitement établie à partir de la déclaration de naissance. La question se pose pour les couples de femmes.
Pour les couples de femmes, nous pouvons envisager au minimum quatre possibilités. Bien sûr, on peut en imaginer d'autres.
La première possibilité serait de s'en tenir au statu quo, à savoir la possibilité pour la conjointe de la mère d'adopter l'enfant de la mère. Une telle possibilité, validée par la Cour de cassation dans deux avis du 22 septembre 2014, est appliquée par la quasi-totalité des tribunaux de grande instance de France. Cette solution, cependant, n'est pas satisfaisante pour au moins deux raisons.
D'une part, la requête en adoption ne peut pas être déposée dès la naissance de l'enfant. Aussi, existe-t-il un laps de temps, plus ou moins important, entre la naissance de l'enfant et le moment où la requête est déposée. Au cours de ce laps de temps, l'enfant n'est pas légalement protégé, c'est-à-dire qu'une réelle difficulté se pose si sa mère légale vient à décéder.
D'autre part, il arrive qu'après la naissance de l'enfant, le couple se sépare avant même d'avoir introduit la procédure d'adoption, auquel cas la protection de l'enfant est liée au bon vouloir de la mère qui accepte ou n'accepte pas cette adoption, ou bien qui accepte ou n'accepte pas un partage de l'autorité parentale. Et si elle n'accepte aucune de ces deux solutions, il faut alors que la mère sociale – celle qui n'est pas la mère légale – introduise une procédure pour maintenir les liens entre l'enfant et elle-même, procédure qui n'aboutit pas à l'établissement d'un lien de filiation et qui ne protège donc pas complètement l'enfant. Je rappelle que le lien de filiation consiste en la transmission du nom, le partage de l'autorité parentale et la possibilité pour l'enfant d'hériter de celui auquel il est affilié. La solution du statu quo n'est donc pas une bonne solution, me semble-t-il. Dès lors, quelle nouvelle solution pouvons-nous envisager ?
Dans un premier temps, nous pourrions transposer ce qui se fait pour les couples hétérosexuels qui ont eu recours à une procréation médicalement assistée avec un tiers donneur. Il me semble important de rappeler dans le détail comment cela se passe. Ce couple donne son consentement devant un juge qui, aux termes de l'article 311-20 du code civil, dresse un procès-verbal, lequel est un recueil des consentements. Au cours de l'entretien, qui dure généralement une petite demi-heure, le magistrat rappelle que le recueil des consentements vaut engagement à l'établissement du lien de filiation, qui sera irrévocable. Le juge informe le couple hétérosexuel qu'aucun des membres du couple ne pourra contester le lien de filiation qui sera établi selon les règles du droit commun. Quelles sont-elles ? Si le couple est marié, la femme qui a accouché est inscrite comme mère sur l'acte de naissance et le mari de cette femme est le père par effet de la présomption de paternité. Le mari n'a rien à faire : c'est la présomption de paternité qui le rend père. Telle est la règle de droit commun pour les couples mariés.
Pour les couples non mariés, la mère qui accouche est inscrite sur l'acte de naissance comme étant la mère. Le père, c'est-à-dire le compagnon de la mère et non pas le conjoint, procédera à une reconnaissance de paternité. Et si jamais il ne l'a pas fait, la mère peut agir en déclaration judiciaire de paternité. En raison de la procréation médicalement assistée, cette paternité sera établie judiciairement. C'est obligatoire. C'est ainsi cela que cela se passe aujourd'hui pour les couples hétérosexuels.
Si l'on transpose ce système aux couples de femmes, le couple de femmes donnera son consentement devant un juge qui le recueillera ; il leur indiquera que le recueil des consentements vaut engagement irrévocable à l'établissement du lien de filiation vis-à-vis de l'enfant à naître. À ce stade, il conviendrait d'introduire une petite innovation législative, peu importante d'un point de vue technique et extrêmement simple : le procès-verbal établi par le juge de recueil des consentements, qui est un acte judiciaire, serait remis à l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance.
En pratique, lorsque la femme accouche, la clinique ou l'hôpital établit un certificat d'accouchement qui est ensuite transféré à l'officier d'état civil, soit par la compagne de la mère, soit par les services de l'hôpital. Ce certificat conduit à l'établissement de l'acte de naissance, avec indication du nom de la mère. Y joindre le procès-verbal de recueil des consentements établi par le juge permettrait à l'officier d'état civil, si une disposition le précisait, d'établir un acte de naissance avec la mention de la femme qui a accouché et de celle qui s'est engagée à être la seconde mère, cet engagement étant certifié dans le procès-verbal de recueil des consentements.
Dès sa naissance, l'enfant serait juridiquement protégé par l'établissement de cet acte de naissance, dont je rappelle qu'il établit l'identité de l'enfant et son état civil. À ce point du débat, j'ai une petite divergence avec Laurence Brunet sur la question de la mention. Il existe deux types d'acte de naissance : l'extrait d'acte de naissance, qui peut circuler de façon relativement large, et la copie intégrale, qui porte un grand nombre de mentions, par exemple lorsqu'une personne a été légitimée par mariage – à l'époque où cela existait –, a changé de nom ou de prénom, est mariée, pacsée ou divorcée, ou a acquis la nationalité française – en cas d'adoption simple avec la mention de l'exequatur d'un jugement étranger.
La copie intégrale de l'acte de naissance, qui est réservée à la personne elle-même et qui est communiquée dans un nombre de cas très réduit, porte déjà la mention de diverses informations. Il ne me paraît pas gênant que l'acte de naissance de l'enfant indique qu'un procès-verbal de recueil des consentements de ses parents a été dressé par le juge à telle date. Cela me paraît cohérent, de surcroît, avec l'idée que l'anonymat des donneurs de gamètes devrait être levé. On ne peut pas à la fois vouloir la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes et ne rien inscrire sur l'acte de naissance. La mention dont il s'agit ne me paraît pas poser une difficulté majeure dans la mesure où il existe d'ores et déjà une grande diversité de mentions sur la copie intégrale de l'acte de naissance, y compris des mentions qui informent sur la façon dont les parents sont devenus parents. Ce n'est pas en soi quelque chose de honteux : ce qui compte, c'est d'avoir un acte de naissance mentionnant les deux parents.
Le système que je viens d'indiquer est le plus simple, mais on pourrait aller plus loin. Deux autres systèmes seraient possibles. On pourrait notamment envisager d'instaurer une présomption de parenté au lieu et place de la présomption de paternité. Aujourd'hui, pour les couples mariés, la présomption de paternité permet au mari de la mère de devenir père sans avoir rien à faire. Il est marié, il devient père légalement. Il est possible de « neutraliser » la terminologie « paternité » au bénéfice de celle de « parenté » qui renvoie aux règles relatives à la filiation et aux règles éducatives. Cela permettrait aux couples de femmes de bénéficier de cette présomption de parenté. Une telle mesure, assez simple à mettre en place, ne concernerait cependant que les couples mariés. Il conviendrait donc que le législateur introduise pour les couples non mariés une innovation que notre droit pourrait supporter sous la forme d'une reconnaissance de parenté pour la compagne, toujours sur la base du procès-verbal de recueil des consentements puisque ce dernier existe dans tous les systèmes. C'est une évidence : il faut bien, à un moment donné, recueillir le consentement des personnes qui s'engagent dans une PMA avec tiers donneur. On supprimerait donc la présomption de paternité au bénéfice d'une présomption de parenté qui permet d'inclure tout le monde. Utiliser le terme de « parenté » aboutirait à une forme d'universalisation de la terminologie.
Ce nouvel article 312 du code civil pourrait être rédigé ainsi : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour second parent le conjoint ou la conjointe de la mère. » Techniquement, c'est d'une grande simplicité. Je ne reviens pas sur la nécessité d'introduire parallèlement, pour les couples non mariés, une innovation qui permettrait une reconnaissance de parenté par le biais du procès-verbal de recueil des consentements. Nous aurions ainsi une sécurité juridique du début jusqu'à la fin, ce qui serait intéressant.
La dernière possibilité pour le législateur serait de procéder à une différence entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes. On garderait la présomption de paternité pour les couples hétérosexuels. Pour les couples de femmes mariés, on introduirait une présomption de co-maternité selon le même principe que la présomption de paternité. Dans la mesure où l'on est en présence de deux femmes, il s'agit d'une présomption de co-maternité. Tel est le choix qui a été fait par la Belgique et par le Québec. Pour prendre l'exemple du code civil belge, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage a pour co-parente l'épouse. Les dispositions sur le mariage s'appliquent.
Les Québécois et les Britanniques ont procédé à l'identique. En parallèle, ces législations, qui nous montrent que c'est techniquement faisable, ont également introduit pour les couples non mariés une déclaration de co-maternité sur la base déclarative. Je ne connais pas le détail de la technique, je ne sais pas s'il y a un procès-verbal de recueil des consentements – on peut l'imaginer. En tout cas, le législateur le prévoit et cela fonctionne sans difficultés particulières.
En conclusion, ce qui compte, c'est que vous, législateur, mettiez en place un ou plusieurs mécanismes juridiques acceptables par notre société afin que l'établissement du lien de filiation de l'enfant puisse intervenir dès sa naissance, car c'est ce qui le protège sur le plan juridique. Il aura deux parents ayant exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il pourra porter leur nom. Ses deux parents exerceront l'autorité parentale à son égard, il pourra hériter d'eux et, en définitive, le principal est que cette protection soit parfaitement établie.
La dimension juridique de l'ouverture de l'AMP ou PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est souvent occultée ou – ce qui revient au même – est abordée à travers le principe d'égalité et son corollaire, le principe de non-discrimination, avec l'idée que cette ouverture est légitimée par le souci de ne pas opérer une discrimination à l'encontre des couples de femmes par rapport à la situation que le droit positif réserve aujourd'hui aux couples hétérosexuels en cas d'infertilité.
Il s'agit en réalité d'un slogan, un slogan qui peut alimenter une rhétorique médiatique non dépourvue d'efficacité, mais un slogan tout de même, sans valeur juridique. Le Conseil constitutionnel l'a dit dès 2013, le Conseil d'État également dans son avis de juin 2018 – et l'a répété dans un arrêt la semaine dernière. La cause est entendue : c'est sur d'autres bases que cette extension peut être plaidée. Il faut, dès lors, accepter d'entrer dans une autre logique, une logique qui, de mon point de vue, conduit, loin, trop loin, et qui, au demeurant, est difficile, pour ne pas dire impossible, à concilier avec les engagements internationaux de la France. Telles sont les deux propositions que je voudrais très rapidement développer devant vous.
D'abord, il faut bien mesurer la portée de la réforme qui, à l'origine, devait concerner uniquement les couples de femmes, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) ayant émis des réserves sur la possibilité d'appliquer ces règles aux femmes seules. Dans son avis plus récent, ces réserves ont été levées. Sont donc également visées les femmes seules, ce qui, statistiquement parlant, n'est évidemment pas négligeable, mais, comme il a été dit – je crois que l'accord est général sur ce point –, on ne voit pas comment il serait possible de priver les couples hétérosexuels du « bénéfice » de cette réforme en continuant à les enfermer dans les conditions strictes qui sont posées actuellement par le droit positif, en sorte que c'est bien une généralisation de la PMA qui est en vue. Et cette généralisation ne peut pas rester sans incidence sur le droit de la filiation.
Déjà, en 1994, lorsqu'avait été édifié le dispositif qui figure aujourd'hui dans le code civil et dans le code de la santé publique, la question avait été posée de savoir s'il n'était pas judicieux d'en tirer les conséquences sur le plan du droit de la filiation. Peut-être ne l'a-t-on pas fait parce que l'on a considéré que l'entorse aux principes était mineure et que cela ne justifiait pas une réforme d'ensemble du droit de la filiation.
Au moment de l'adoption de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, le Conseil constitutionnel a eu à se pencher sur la question, puisque les députés qui l'avaient saisi ont fait valoir que la loi n'était pas intelligible en ce qu'elle n'avait pas tiré les conséquences du mariage entre personnes de même sexe sur le terrain du droit de la filiation. Le Conseil constitutionnel a répondu que tel n'était pas le cas dès lors qu'on n'avait pas touché au régime de la procréation médicalement assistée. Voyez l'argument a contrario que cela implique. Dès lors que l'on va plus loin, il est logique de s'intéresser aux conséquences qui en découlent sur le terrain de la filiation. Cette question ne peut plus être écartée.
Comment faire ? Une très mauvaise solution consisterait à modifier uniquement les articles qui régissent aujourd'hui la PMA en bricolant une extension à l'ensemble des personnes que j'ai énumérées. Ce serait incohérent et je ne crois pas que l'on puisse raisonnablement soutenir une telle solution.
Une autre idée consisterait à créer un titre VII bis entre le titre VII du code civil sur la filiation et le titre VIII relatif à la filiation adoptive. On intégrerait ainsi un titre dans lequel seraient insérées toutes les dispositions concernant la filiation des enfants nés de l'AMP. Ce serait difficile à gérer parce qu'il ne serait pas aisé d'articuler les dispositions du titre VII bis et les dispositions du titre VII. Au demeurant, cela conduirait à des différences de traitement dont certaines seraient très difficiles à justifier. Je prends un exemple tiré de la recherche de paternité. Imaginons une femme seule qui, pour satisfaire son désir d'enfant, recourt à la technique de l'AMP et une autre qui, pour satisfaire le même désir, recourt aux services d'un proche. Dans le premier cas, selon le système prévu, l'enfant ne jouit pas de l'action en recherche de paternité ; dans le second, en revanche, l'enfant jouit de l'action en recherche de paternité avec les conséquences qui y sont attachées, à savoir l'obligation alimentaire et l'ouverture à la succession. Comment justifier une telle différence de traitement ? Cela me paraît totalement incohérent.
La cohérence, si l'on veut pousser jusqu'au bout la logique, serait de reconstruire un autre droit de la filiation, ce qui n'est pas si différent de ce que vous venez d'entendre, et donc de réécrire, sur d'autres bases conceptuelles, le titre VII du code civil sur la filiation. C'est possible, le législateur en a le pouvoir. Le Conseil constitutionnel vous laisse, sur ce terrain, une très grande marge. Il n'en reste pas moins que ce serait une véritable révolution.
Bien sûr, c'est vrai, le droit de la filiation n'a jamais été fondé sur le « tout biologique ». Quantité de règles témoignent de tempéraments à ce principe. Il suffit de prendre l'exemple de la possession d'état, dont la loi du 3 janvier 1972 a accru le rôle, faisant apparaître que la filiation revêt aussi une dimension sociologique. La preuve de la filiation peut résulter de la possession d'état.
Reste, comme le CCNE le notait lui-même en 2005, que « la vérité biologique est au fondement de la filiation selon le modèle traditionnel. » C'est sur ce point qu'il faudrait revenir, mais cela aurait des conséquences dont certaines pourraient, de mon point de vue, se révéler dévastatrices ; je ne suis pas certain que l'opinion publique serait prête à les accepter.
Par exemple, revenir sur l'action en recherche de paternité postule l'éviction complète de cette action dans le code civil. Dans la mesure où la filiation serait fondée sur la seule volonté, il ne serait plus question de rechercher la paternité d'un homme, quelles que soient les circonstances. Est-on prêt à rayer du code civil cette action en recherche de paternité qui existe depuis 1912, dont la loi s'est employée depuis à faciliter l'exercice, et qui présente le double mérite de protéger l'enfant tout en responsabilisant le géniteur ? Voilà une interrogation ! En voici une autre : tant que ce projet parental concrétisant la volonté ne sera pas établi, acté, l'enfant, dans cette logique, n'aura pas de filiation. Est-ce bien ce que nous voulons ?
Si la volonté suffit à créer la filiation, si la volonté d'une ou de deux personnes suffit, pourquoi la volonté de trois personnes – le géniteur et les deux femmes, dans l'exemple des couples de femmes – ne le pourrait-elle pas ? La possibilité en est ouverte, par exemple, dans la loi de Colombie-Britannique ou dans celle de la province de l'Ouest canadien.
À ces interrogations qui me donnent le vertige s'en ajoutent d'autres concernant la compatibilité avec les engagements internationaux de la France. J'ai dit que le législateur pouvait tout faire. Oui, si ce n'est que nous sommes liés par des conventions internationales : la Convention européenne des droits de l'homme en premier lieu. En l'occurrence, elle n'est pas sans intérêt ici puisque l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit à la vie privée, revêt une conception très large.
La Cour européenne des droits de l'homme a indiqué à plusieurs reprises que l'enfant avait le droit d'accéder à ses origines, ce qui, soit dit au passage, menace l'anonymat qui fonde notre système. Mais la Cour ne s'est pas contentée de reconnaître le droit de l'enfant à connaître ses origines. Elle dit dans le même souffle, dans un arrêt de 2015 Canonne contre France, qu'il faut, aux termes de l'article 8 de la Convention, « garantir le droit de l'enfant à la reconnaissance juridique de sa filiation ». La façon dont la Cour lie l'accès aux origines, par hypothèse biologique, et le droit à la reconnaissance juridique de la filiation montre assez que la filiation ainsi visée dans sa jurisprudence ne peut être que la filiation biologique.
Surtout, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant. Deux dispositions retiennent l'attention. D'une part, l'article 3, paragraphe 1, qui considère que « dans toute décision le concernant, y compris les décisions prises par les organes législatifs… » – c'est vous qui êtes visés – « …l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale. » La phrase a une tournure quelque peu pléonastique, il faut bien le reconnaître. Cela vient renforcer l'idée que dans le contrôle de proportionnalité à opérer entre ce droit de l'enfant et d'autres libertés, par exemple la liberté de la femme de procréer, la balance devrait, au moins dans le doute, pencher en faveur de l'intérêt de l'enfant.
D'autre part, l'article 7, paragraphe 1, énonce : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. » Je sais que la portée du texte a été critiquée mais le texte ne prend sa réelle signification que si le terme « parents » désigne les parents biologiques.
Je n'utilise pas l'argument selon lequel, en 1989, lors de la rédaction de la Convention, les techniques d'AMP n'étaient pas très élaborées ; de toute façon, les rédacteurs n'y ont pas pensé. Je ne l'utilise pas car, après tout, il arrive dans bien des cas que l'on applique un texte à des situations qui n'avaient pas été spécialement visées par son auteur, mais que l'on considère comme normales de viser. Je dirai simplement que le texte perd toute signification si on l'applique à une filiation fondée sur la seule volonté. Quel sens aurait l'idée selon laquelle un enfant a le droit d'exiger de connaître des parents qui, dans l'hypothèse que j'envisage, de toute façon, l'ont créé et lui ont imposé d'une certaine manière le lien de filiation qui les unit ? C'est priver la disposition de tout effet utile. Il y a là un argument très sérieux qui vient limiter la liberté d'action du législateur français. On peut, certes, dénoncer la Convention internationale des droits de l'enfant. Je serais étonné qu'on se résolve à le faire compte tenu de la place qu'elle a prise ; elle irrigue, en effet, tout notre droit positif aujourd'hui. Je ne vois donc pas comment cette hypothèse pourrait être sérieusement envisagée.
Pour terminer, je voudrais rappeler le conseil que Montesquieu, dans les Lettres persanes, donnait au législateur de ne toucher aux lois – la formule est fameuse – que d'une main tremblante !
Au regard du nombre et de la gravité des objections que la réforme envisagée soulève, il me semble que le plus raisonnable serait de ne pas y toucher du tout ! Telle est en tout cas mon opinion ; je vous remercie de m'avoir permis de la défendre devant vous.
Je suis très honoré et très heureux d'être auditionné aujourd'hui, et ce en qualité de secrétaire général de l'Institut Famille et République, un think tank de juristes qui a vocation à faire des propositions en matière de droit familial et de droit des personnes.
Je souhaiterais me concentrer sur le projet d'extension de la PMA et évoquer avec vous deux questions fondamentales : d'une part, la causalité – le principe d'égalité qui justifierait la déréglementation ou la généralisation de la PMA ; d'autre part, les conséquences prévisibles – parce qu'il existe des obstacles éthiques, juridiques et politiques. Il suffit de lire avec une certaine attention les avis tant du CCNE que du Conseil d'État et de relire la synthèse des États généraux de la bioéthique pour se rendre compte qu'il n'y a pas véritablement de consensus sur ces sujets, quoi que l'on en dise.
La première question qui se pose est simple : peut-on justifier, au nom de l'égalité, l'accès à la PMA des couples de femmes et des femmes seules ? Autrement dit, la différence cause-t-elle une inégalité ? D'aucuns veulent voir une inégalité dans le critère thérapeutique qui réserve actuellement la PMA à un couple infertile, formé d'un homme et d'une femme, dès lors que cette infertilité a été médicalement diagnostiquée. Il s'agit là d'une conception erronée de l'égalité, et ce pour plusieurs raisons : tout d'abord, il n'y a pas de droit à la PMA pour les couples hétérosexuels. La PMA n'est accessible à un couple formé d'un homme et d'une femme que pour autant qu'il est infertile ou souhaite éviter une maladie grave à l'enfant. Un couple homme-femme fertile ne bénéficie pas d'une PMA, et pourtant il ne subit pas d'inégalité. Il n'y a pas de PMA possible pour un couple homme-femme âgé, et pourtant il ne subit pas d'inégalité.
Deuxième raison : l'égalité ne signifie pas qu'il faille traiter tout le monde de la même manière – ce qui, au contraire, serait très injuste – mais uniquement ceux qui sont dans la même situation ou qui sont dans une situation équivalente. Une femme seule, un couple de femmes, un couple âgé, ou encore un couple dont le mari est décédé, n'est pas dans une situation équivalente à un couple composé d'un homme et d'une femme en âge de procréer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Le professeur Lucas a rappelé certaines décisions, notamment un arrêt tout récent du 28 septembre 2018 du Conseil d'État, qui rappelle que la différence de situation justifie la différence de traitement et que les couples de personnes de même sexe sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples formés d'un homme et d'une femme. Autrement dit, selon les instances juridiques françaises et européennes, l'argument de l'égalité ne peut pas justifier l'extension de la PMA.
Bien évidemment, l'orientation sexuelle des intéressés n'est pas concernée par cette question. Une femme seule n'est pas forcément homosexuelle et pourrait très bien vouloir avoir un enfant alors même qu'elle est hétérosexuelle. Par contre, s'il n'y a pas d'inégalité entre les couples, il y en aurait une aux dépens de l'enfant. En effet, remédier à cette prétendue inégalité imaginaire instaurerait une inégalité bien réelle entre les enfants qui auraient la possibilité de connaître leur père ou d'avoir un père et ceux qui en seraient privés de par la loi.
Ensuite, cette conception erronée de l'égalité conduira, qu'on le veuille ou non, à la gestation pour autrui (GPA). À partir du moment où l'on suppose une prétendue inégalité au regard de la procréation entre les couples de femmes et les couples homme-femme stériles pour justifier l'extension de la PMA, cette prétendue inégalité sera également invoquée au profit des couples d'hommes pour justifier la GPA demain.
S'agissant des conséquences de l'extension de la PMA, la première d'entre elles – de loin la plus importante – est la suppression du père et de la lignée paternelle. La question est simple : est-il important d'avoir un père ? D'aucuns veulent relativiser l'absence du père en invoquant notamment que l'amour comblerait cette absence, mais l'amour ne justifie pas tout. En particulier l'amour ne peut pas justifier de priver de père un enfant, d'autant qu'il n'arrivera jamais à remplacer cette absence de père, reconnue par la société comme une blessure, quelle que soit d'ailleurs l'origine de cette absence : un abandon, un décès, un divorce.
Dans son avis de juin 2017, le CCNE constatait que s'il a toujours existé des enfants ne connaissant pas leur père et des enfants élevés par un seul parent dans un couple homosexuel, il y a une différence entre faire face à une telle situation survenant dans le cadre de la vie privée sans avoir été planifiée ni organisée par la société, et l'instituer ab initio.
Par ailleurs, la parenté ne se réduit pas à une relation d'éducation : elle permet de se situer dans une généalogie, elle indique une origine qui peut être soit biologique – le cas de l'enfant biologique –, soit symbolique – le cas des enfants adoptés. L'importance du lien biologique dans la filiation est révélée par l'application de la notion de préjudice juridiquement réparable. La justice française a eu maintes fois affaire à de tels drames, nés du préjudice qui résulte de l'échange accidentel d'enfants à leur naissance – tout le monde se souvient du film La vie est un long fleuve tranquille – et surtout du préjudice liés aux erreurs d'attribution de gamètes et d'embryons dans le processus de PMA. Si le lien biologique est indifférent en matière de filiation, dès lors, pourquoi le couple en processus de PMA sans tiers donneur peut-il invoquer un préjudice au motif que l'enfant attendu est en fait issu des gamètes d'autrui ?
Qui peut nier que l'absence d'un père constitue un manque ? Qui peut nier qu'il est préférable d'avoir un père que de n'en avoir pas ? Qui peut prétendre que l'amour qui donnera vie à un enfant comblera cette absence de père ?
Enfin, la conception sans père serait également une violation des droits de l'enfant au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le professeur André Lucas l'a indiqué, je n'y reviens donc pas. J'ajouterai d'autres conséquences prévisibles qu'il me semble important d'évoquer. Elles figurent dans le rapport du Conseil d'État intitulé Révision de la loi bioéthique, quelles options pour demain ? de juillet 2018. Je citerai notamment les effets nocifs du projet parental qui serait uniquement fondé sur la volonté parce que la volonté, qu'on le veuille ou non, est versatile : je peux vouloir être parent aujourd'hui et décider de ne plus l'être demain. On peut donner son consentement, soi-disant sans possibilité de revenir en arrière, mais que se passe-t-il si le consentement a été vicié ?
La parenté fondée sur le projet parental aboutira à la multiparenté. Je peux citer des exemples au Canada d'enfants qui ont trois parents. Deux décisions, l'une émanant de la cour d'appel de l'Ontario, l'autre de la cour d'appel de l'Alberta, font état de cas d'enfants qui ont désormais trois parents. La loi de Californie et la loi de la Colombie-Britannique ont été modifiées pour prévoir elles aussi la multiparenté.
La PMA post mortem pose question. En raison de la pénurie de gamètes, on s'achemine vers une marchandisation du sperme et donc des éléments du corps humain. Si l'on vend son sperme, pourquoi ne pas vendre son oeil, son rein ou son bras si cela peut aider à réparer une personne blessée ?
Mesdames, messieurs, nous pouvons être fiers, aujourd'hui, en France, d'être dotés de règles bioéthiques qui préservent du marché le corps et la procréation. Quoi que l'on en dise, nous ne sommes pas à la traîne : nous sommes, au contraire, en avance en garantissant le respect des droits de tous, en particulier de l'enfant.
Cette révision de la loi de bioéthique, en particulier concernant la PMA, doit être à la hauteur de notre philosophie des droits de l'homme, en cherchant à faire valoir l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier, l'intérêt du plus faible, l'enfant, plutôt que celui du plus fort, l'adulte, et à faire valoir la raison plutôt que l'application d'une idéologie ou la réalisation de désir, quel qu'il soit. Je vous remercie.

Mesdames, messieurs, merci pour vos contributions.
Je reviens sur le thème de la multiparenté. L'argument a été évoqué d'abord par le professeur Lucas. Il a pu choquer au départ. Il a été repris par maître de Vries. Si l'on évacue les réalités corporelles et que l'on s'attache à la volonté des individus, qu'est ce qui empêche, en effet, d'avoir plus de deux parents ? Quand on se réfère aux réalités corporelles, on s'appuie sur la reproduction à deux ; quand on se réfère aux notions de volonté de parenté et de filiation, qu'est ce qui empêche d'avoir plusieurs parents parce que « deux, finalement, c'est ringard » ? Qu'est-ce qui permet d'ancrer une filiation limitée à deux si on ne fonde pas ce principe sur la réalité corporelle ?
Je formulerai trois observations.
Premièrement, il existe déjà en droit français une parenté qui dépasse le couple. Cette multiparenté résulte de la possibilité de mettre en place une adoption simple. Un enfant peut déjà avoir, en droit français, ses parents d'origine qui sont ses parents légaux et un troisième lien de filiation, puisque l'adoption simple n'efface pas le lien de filiation d'origine mais s'y ajoute. Notre droit connaît déjà cette situation, au demeurant relativement rare, mais qui existe. Conceptuellement, c'est méconnaître le droit français que d'agiter devant vous le spectre de la multiparenté comme cela vient d'être fait.
Deuxième observation : avoir trois parents, à mon sens, est une richesse ; c'est un facteur de protection pour l'enfant. Mais il s'agit là d'une opinion personnelle, elle n'est pas très intéressante.
Ma troisième observation est plus importante : dans la société française de 2018, des associations sollicitent-elles une multiparenté ? Non. C'est une espèce de chiffon rouge que l'on agite devant vous, mais aucune demande ne va en ce sens. Peut-être, un jour, une demande sera-t-elle formulée : je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée. Le droit français permet d'ores et déjà d'y répondre grâce à l'adoption simple qui autorise d'ajouter un troisième, voire un quatrième parent quand l'enfant est adulte. La demande actuelle porte sur l'ouverture plus large aux techniques d'assistance médicale à la procréation et d'en tirer les conséquences sur le plan de la filiation. Aucun couple de femmes ne demande qu'il y ait trois parents. C'est une fausse crainte. À supposer qu'elle émerge, je pense qu'un enfant peut avoir légalement trois parents sans que cela soit un drame. Cela existe déjà en droit français.
Il faudrait dédiaboliser la figure de la pluriparenté. Caroline Mécary vient de souligner qu'elle existe déjà au titre de l'adoption simple, mais il existe également quelques rares cas où l'enfant est né dans ce qu'on appelle des organisations de coparentalité. Deux personnes de même sexe ont recours à une femme pour avoir un enfant à deux ou à trois. Parfois, donc, l'adoption est prononcée, mais souvent les juges ont été sensibles à ces situations et ont prononcé des délégations d'autorité parentale à trois. Certes, la situation n'est pas courante, mais cette configuration existe et cela se passe bien.
Les cas où il y a trois parents, au sens strict du terme, sont rares. Le modèle existe toutefois en droit français au travers de l'adoption simple. Vous l'avez formulé comme s'il s'agissait de quelque chose de choquant, d'un épouvantail que l'on brandirait. Je voudrais vous ramener à ce qui existe dans les faits. Une forme de parentalité divisée entre trois adultes a été mise en place par les juges de manière apaisée parce que trois adultes avaient envie de prendre leurs responsabilités, de s'engager au quotidien dans la vie de l'enfant. Je ne dis pas que c'est simple. En effet, gérer à trois rend les choses encore plus compliquées parce que les adultes, parfois, se disputent. En tout cas, ce n'est pas une figure totalement inconnue du droit français.
L'exemple de l'adoption me paraît peu probant dans la mesure où, précisément, il s'agit d'une adoption simple dont les effets juridiques sont finalement assez limités, en tout cas par rapport à l'adoption plénière. Je ne pense pas que cet exemple puisse être utilement versé au débat. Il est bien possible, en l'état, qu'aucune demande ne soit formulée en France, mais l'argument est très souvent utilisé qui se fonde sur les lois étrangères. Dès lors, on peut très bien imaginer que ces exemples fassent germer des idées.
Sur le fond, j'ai cité un exemple pour montrer qu'en poussant la logique jusqu'au bout, nous n'avions aucun argument à opposer. Monsieur le président, vous avez demandé ce que nous pouvions opposer à cette demande. Je vous réponds : rien, en logique, absolument rien ! En opportunité, peut-être. Après tout, le législateur peut décider de limiter le nombre des parents à deux. Mais il faut bien se mettre d'accord sur l'idée que la décision serait arbitraire.
Trois remarques.
Pourquoi deux parents ? Tout simplement parce que le modèle parental est limité à deux. Le nombre n'a de signification que par référence à l'engendrement : il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre, c'est l'altérité, mais à partir du moment où on supprime l'altérité et où l'on base tout sur la volonté, pourquoi limiter le nombre à deux ?
J'ai évoqué la loi californienne et la loi de Colombie-Britannique. J'ajoute deux décisions du Canada. La cour d'appel de l'Ontario, dans une décision du 2 janvier 2007, a déclaré une femme partenaire de la mère, parent de l'enfant au même titre que la mère et le père biologique.
Encore au Canada, la cour d'appel de l'Alberta, dans une décision du 5 juillet 2013, a déclaré comme deuxième père l'ancien compagnon du père, contre la volonté de la mère biologique, car ce compagnon s'était investi dans le projet parental.
En Europe, une décision du 19 février 2013 de la CEDH a condamné l'Autriche, au nom de l'égalité, pour avoir refusé d'envisager l'adoption d'un enfant par la femme, compagne de la mère, alors que le père, qui payait une pension alimentaire et voyait régulièrement son enfant, s'opposait à cette adoption.
Il n'y a pas que la multiparenté, il peut y avoir aussi le changement d'avis sur la parenté. Aux États-Unis, dans le cas de la PMA et de la GPA, des parents, pour une raison ou une autre, ne veulent plus de leur enfant. C'est ainsi que l'on voit se développer un marché appelé le rehoming. Vous trouverez de nombreux sites internet qui proposent de racheter des enfants âgés de quatre à dix ans qui ont été rejetés par leurs parents d'origine. Une telle situation naît de l'idée que la volonté fait la filiation et de la disparition du lien biologique.
Comme le disait ma consoeur précédemment, le droit français n'appréhende pas uniquement le lien biologique, mais ce n'est pas faire un cours de droit que de dire qu'il y a, en droit, le principe et les exceptions. Or il ne faut pas tout réduire à l'exception. Le principe repose sur la filiation biologique, l'exception sur la filiation symbolique, qui est parfois nécessaire. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, en faire un principe pour répondre à certaines attentes.

Merci pour l'éclairage que vous apportez.
Vous avez cité la célèbre maxime de Montesquieu qui nous impose d'avoir la main tremblante. Heureusement, elle n'est pas que tremblante depuis l'Antiquité, sans quoi le père aurait encore aujourd'hui droit de vie et de mort sur ses enfants ! Il faut bien écrire de temps à autre de nouvelles dispositions.
La situation actuelle présente un fort contraste. D'une part, l'idée est assez largement répandue selon laquelle les vrais parents ne sont pas ceux qui donnent les gamètes, mais ceux qui s'engagent à procurer à l'enfant l'environnement matériel, affectif, intellectuel qui lui permettra de se développer et de s'épanouir. J'en veux pour preuve que nous ne recherchons pas le parent biologique de l'enfant adultérin. Le père est celui qui élève l'enfant.
D'autre part, notre droit ne considère pas toujours que la mère soit celle qui accouche et que le père soit le père – voir le cas d'une GPA effectuée à l'étranger, ou de la « seconde mère » lorsqu'une PMA concerne un couple homosexuel.
D'un côté, le parent est celui qui s'engage ; de l'autre, notre droit n'est pas en conformité avec les réalités d'aujourd'hui. Dès lors, il nous faut modifier le droit. Pour ce faire, il existe deux solutions. Soit on le change en le corrigeant à la marge, soit on décide de totalement le réécrire. Cela aura du sens dans un avenir plus ou moins proche, car si nous traitons des questions qui se posent aujourd'hui, d'autres se poseront dans le futur. Un jour adviendra l'utilisation de l'utérus artificiel. Cela déplaît à certains et plaît à d'autres. Qu'importe : cela existera. La « femme » qui accouchera sera une couveuse et on ne pourra pas décréter que la couveuse est mère. Il faudra accepter de sortir de nos règles d'antan : nous y serons naturellement conduits. Peut-être le temps est-il venu de faire aboutir cette réflexion pour déterminer qui sont les parents, en nous détachant de la loi de la nature, c'est-à-dire la façon traditionnelle de procréer. Les arrangements avec la tradition existaient déjà dans la Bible : souvenez-vous de Sarah et d'Agar. Par ailleurs, dans les campagnes, lorsqu'un couple était infertile, il était procédé à des échanges d'enfants. L'intérêt de l'enfant est prioritaire. L'enfant a intérêt à avoir un, deux, trois parents qui s'engagent formellement dans son éducation et son épanouissement, et cela même après ses dix-huit ans – mais c'est là une autre histoire !
Après vous avoir entendus, je me demande s'il ne conviendrait pas d'être plus ambitieux en essayant de prévoir les innovations à venir. Bien sûr, nous n'inscrirons rien dans le marbre et il restera du travail pour les générations futures. Il n'empêche qu'il serait intéressant de marquer que nous sommes conscients du fait que le don de gamètes, le lien génétique n'a d'aucune façon la priorité : ce qui importe, c'est l'engagement fort envers l'enfant.
Il nous faut respecter également le fait – à vous de le confirmer – que l'enfant ne doit en rien être stigmatisé par son mode de procréation. Ce n'est pas lui qui l'a choisi. Déjà, il n'a pas choisi de naître. Il arrive que des enfants disent à leurs parents qu'ils n'ont rien demandé, que ce sont eux qui les ont fait naître. Que répondons-nous à nos adolescents lorsqu'ils nous le reprochent ? En général, nous passons à la question suivante. Il ne conviendrait pas qu'ils nous demandent au surplus pourquoi on les a fait naître par un tiers donneur. Il faut éviter toute stigmatisation.
Mesdames, vous avez dressé la liste complète de l'ensemble des possibilités.
J'ai tendance à dire que la solution la moins stigmatisante serait celle où l'acte de naissance affiche le moins d'indications, ce en quoi je m'écarte légèrement de la recommandation du Conseil d'État, et ce pour éviter toute différence et discrimination. C'est vers cela qu'il nous faut tendre, pour que l'enfant trouve son intérêt et sa capacité à se développer sans jamais avoir l'impression d'être différent. Tous les pédopsychiatres nous le disent : il est un âge où l'adolescent ne supporte pas d'être différent. On le note même dans le code vestimentaire. Ils ont besoin d'être identiques. Celui qui est marginalisé par ses camarades en souffre. Il convient de respecter ce besoin des jeunes et de les placer dans la condition commune. Quel que soit le mode de procréation – auquel il n'a pas participé –, il doit être une reconnaissance de ses parents, d'un état normal et habituel. Je suis très à l'écoute de tout ce que vous dites qui nous permet d'établir une filiation en parfait respect avec ce principe.
Je suis sensible à votre propos selon lequel l'enfant ne doit pas être stigmatisé, ni aucune précision figurer à l'état civil. Lorsque l'on est adopté, quand on est légitimé, il est normal que l'état civil fasse état d'une forme d'historique. En revanche, s'agissant du mode de conception et des aspects corporels, moins l'on en sait, mieux l'on se porte.
Pour avoir beaucoup discuté de cette question avec des couples de même sexe ou hétérosexuels, je pense que les parents sont responsables et matures. Bien sûr, il faut lever le secret du mode de conception de l'enfant. Cela se passe entre les parents et les enfants. La société doit accompagner ce mouvement de transparence, mais une pression par la voie de l'état civil me semble aller trop loin. Peut-être suis-je influencée, comme je vous l'ai dit, par mes travaux actuels. J'ai lu les travaux produits en Grande-Bretagne où ces mêmes questions se sont posées en 2008 lorsqu'a été ouverte la procréation aux couples de même sexe. La possibilité de la levée de l'anonymat a été envisagée en 2004 et 2005. Le respect du droit à la vie privée des parents l'a finalement emporté.
Le législateur britannique a encouragé la levée du secret, écarté l'anonymat en permettant de manière graduelle et en accompagnant cette levée possible des origines par la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), mais il a décidé de ne pas inscrire ces informations sur les documents d'état civil. Je souligne que la Grande-Bretagne n'a pas d'actes d'état civil équivalents aux nôtres. Inscrire des informations serait trop attentatoire aux rapports liants parents et enfants.
La solution la meilleure, me semble-t-il, passerait par ce qu'on appelle la présomption de co-maternité ou la présomption de parenté. Il me semble essentiel de maintenir la cohérence du droit de la filiation faisant l'objet du titre VII du code civil. Le droit français de la filiation est parcouru par des tensions entre la filiation biologique et la filiation fondée sur la volonté. La reconnaissance est fondée sur la volonté. Mais le titre VII a toute sa cohérence parce que la filiation repose sur une vraisemblance d'engendrement. Cela ne se constate pas dans les modes extrajudiciaires d'établissement de la filiation, mais lorsqu'on se rend dans les prétoires en raison d'un contentieux, la preuve qui règne aujourd'hui est celle qui repose sur l'expertise biologique.
Ce droit s'est construit depuis 1804 en se fondant sur la volonté, mais, en cas de contestation, le soubassement le plus profond repose sur la biologie. Le droit est ainsi construit. Je ne sais s'il faut tout réformer, je n'irai pas jusque-là. Avec l'ordonnance de 2005, ce droit a accédé à un certain équilibre entre la paix sociale et l'importance de la biologie. Peut-être conviendra-t-il de procéder à des aménagements parce que la Cour européenne des droits de l'homme estime que les délais de prescription sont trop courts.
La solution la plus simple consisterait à reprendre les modes extrajudiciaires d'établissement de la filiation, c'est-à-dire la présomption de parenté, la co-maternité et la reconnaissance, à les ôter du titre VII pour ne pas abîmer sa cohérence et à créer un titre VII bis relatif à la procréation par don de gamètes, peut-être un jour par GPA ou par greffe d'utérus. Il faudra, en effet, anticiper.
Nous reprendrions des modes habituels qui n'apparaîtraient pas sur l'acte de naissance. Il ne faut cependant pas tout mélanger car la cohérence du droit est essentielle. Elle a déjà été mise à mal en 1994 quand on a introduit de force les articles 311-19 et 311-20 du code civil dans le titre VII. En relisant les débats parlementaires, les partisans militaient plutôt en faveur de leur insertion dans le titre relatif à l'adoption. On n'osait pas encore créer un titre VII bis, mais prévalait l'idée qu'il s'agissait d'un mode spécifique et qu'il fallait le distinguer, sans pour autant discriminer ou stigmatiser. L'idée a été débattue, même si elle a été écartée au nom d'une sorte de « ni vu ni connu », comme dirait Irène Théry.
Aujourd'hui, nous sommes en train de nous saisir de la question dans son entier, et il nous faut basculer ces articles dans un autre titre pour donner une cohérence à ces modes d'établissement de la filiation. Cela dit, je souhaite qu'ils restent assez traditionnels. Les modes extrajudiciaires d'établissement sont aujourd'hui adéquats, la plupart fondés sur l'acte de volonté. La présomption de paternité est une façon de donner par avance son consentement aux enfants qui naîtront du mariage. La place de la volonté est déjà présente. Il suffit de transposer. La spécificité du titre VII bis tiendrait dans le fait que la preuve biologique ne serait pas recevable. Les filiations seraient verrouillées comme cela figure aux articles 319 et 320 du code civil. Il s'agit de faire sortir ces deux articles du titre VII et de les insérer dans un titre VII bis, en l'aménageant pour que son contenu s'applique à tous les couples, les couples de femmes en particulier.
Cette façon de faire traduirait un changement symbolique très fort et serait facile à réaliser d'un point de vue juridique.
Je rappelle en préambule cette phrase de Françoise Héritier : « Rien de ce qui nous paraît naturel n'est naturel. » Cela pour dire que le législateur a tout pouvoir d'organiser l'établissement du lien de filiation dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Je rejoins Laurence Brunet sur la mise en place de ce titre VII bis concernant les procréations médicalement assistées.
Je formulerai maintenant quelques observations.
J'ai indiqué dans mon exposé les différentes modalités que j'ai envisagées, notamment les trois dernières visant à ne pas toucher au mode d'établissement de la filiation via la présomption de paternité grâce au procès-verbal de recueil des consentements qui serait utilisé à l'établissement de l'acte de naissance. Ce n'est qu'une des possibilités. La mise en place d'une présomption de parenté ou de co-maternité avec en parallèle une déclaration est parfaitement envisageable. Au législateur de choisir.
Ce n'est pas parce qu'il y a des différences que ce sont des discriminations. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes et des hommes qu'il y a une discrimination sur le plan juridique. Ce n'est pas parce que figurerait sur la copie intégrale de l'acte de naissance la mention d'un procès-verbal de recueil des consentements que l'enfant serait discriminé. Il s'agit de mettre en accord un élément de son histoire et un élément de son identité. Éventuellement, la discrimination résiderait dans le fait que l'enfant n'aurait pas connaissance de cette situation, que ses parents ne la lui auraient pas révélée. Pour le reste, ce n'est pas une différence discriminante pour l'enfant. Les jumelles Mennesson savent pertinemment qu'elles ont été conçues grâce à une mère porteuse. Elles savent que leur mère est Mme Mennesson et leur père M. Menesson, et qu'il a fallu une mère porteuse pour qu'elles viennent au monde – ce qu'elles n'ont pas demandé, ni aucun d'entre nous. Elles ne vivent pas la situation comme une discrimination, car elles en sont informées. Il ne faut pas considérer que toute différence entre des situations de fait soit une discrimination. L'analyse ne me paraît pas juste, du moins sur le plan juridique. Cela dit, il revient au législateur de trouver la meilleure solution, au regard des enjeux qui sont posés aujourd'hui.
Vous avez évoqué la gestation pour autrui (GPA) et la situation des enfants aujourd'hui conçus à l'étranger par gestation pour autrui. À l'étranger, un acte de naissance est établi au nom des parents d'intention : un couple hétérosexuel, un couple d'hommes, parfois une femme ou un homme célibataire. L'acte de naissance est établi conformément à la loi nationale du pays étranger, que ce soit le Portugal, qui a ouvert la gestation pour autrui, la Grèce, Israël, etc.
L'identité n'est pas un problème sur le plan juridique. Il n'y a pas non plus un problème d'établissement du lien de filiation, lequel est établi par l'acte de naissance étranger, normalement valable en France dès lors qu'il est traduit et apostillé.
Le problème réside dans le refus idéologique opposé par la Cour de cassation à une transcription totale de l'acte de naissance. La transcription n'est pas l'établissement du lien de filiation : elle permet à un enfant d'avoir un acte de naissance français. Si l'on peut vivre sans transcription, il n'en reste pas moins qu'il est très pratique d'avoir un acte de naissance français. La Cour de cassation, le 5 juillet 2017, a considéré que l'on ne pouvait le transcrire que partiellement. C'est une position incohérente parce qu'elle est politique. Je m'explique : la Cour de cassation a considéré que l'acte de naissance devait être retranscrit uniquement à l'égard du mari de la femme qui figure sur l'acte de naissance. Or, comment la présomption de paternité peut-elle jouer à l'égard d'un homme dont on sait que la femme n'a pas accouché ? C'est une première incohérence, mais l'on relève surtout la dimension politique de la position de la Cour de cassation, qui considère que la mère est toujours celle qui accouche. En droit, c'est faux. La mère n'est pas toujours celle qui accouche : elle peut être une mère adoptive qui n'a jamais accouché ; dans l'accouchement sous X, la femme qui a accouché peut ne jamais être la mère. Il y a là un problème de cohérence interne à la Cour de cassation.
La Cour de cassation reconnaît la transcription uniquement à l'égard du père supposé être le père biologique, alors que l'on n'a jamais demandé à un homme marié de fournir un test de paternité. Mais, surtout, elle explique qu'une transcription partielle protège mieux l'intérêt de l'enfant. Il serait pourtant très étrange que l'intérêt de l'enfant soit mieux protégé par une transcription partielle que par la transcription complète. C'est totalement incohérent.
Une transcription partielle protégerait censément la femme porteuse, qui n'est pas dans la cause et qui n'a rien demandé. Selon son droit national, elle a même renoncé à tout droit sur l'enfant, qu'elle ne considère pas comme étant son enfant. On comprend la motivation de la Cour de cassation qui formule textuellement que cela empêche le recours à la GPA à l'étranger. À cet égard, le rôle de la Cour de cassation est bien étrange. Au reste, elle sait très bien que sa position est bancale puisque, le 5 octobre dernier, elle a demandé un avis à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce faisant, elle ne prend pas ses responsabilités. Comprenant que sa position est bancale, elle demande à la CEDH si elle doit reconnaître intégralement l'acte de naissance en fonction ou non d'un don de gamètes, ce qui ouvre une boîte de Pandore terrifiante. C'est la raison pour laquelle le législateur pourrait rappeler que la transcription de l'acte de naissance étranger doit être faite dès lors qu'est fourni un acte de naissance étranger valablement établi selon les formes du droit étranger. Cela réglerait la question et mettrait fin à seize ans de procédure judiciaire, car cela fait seize ans que cette histoire n'est pas réglée et que cela occupe le tribunal de grande instance de Nantes, la cour d'appel de Rennes, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme ! Sans compter que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant…
Il conviendrait donc de régler cette question qui, au demeurant, est fort simple dans la mesure où il suffit d'accepter la transcription complète, tout en ne légalisant pas la GPA en France, où elle reste interdite.
La réforme envisagée passe par une refonte totale et radicale du droit de la filiation. Aussi suis-je en parfait accord avec ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, en évoquant la nécessité d'une réflexion aboutie. J'oserai un bémol, mais je suis sûr que tout le monde sera d'accord sur ce point : ce n'est pas parce que des techniques sont disponibles qu'elles ont nécessairement vocation à être retenues par le droit. Y compris à l'avenir, il conviendra d'opérer un tri entre les différentes techniques.
À mon avis, il n'est pas possible de concrétiser cette réflexion dans un titre VII bis où seraient concentrées toutes les dispositions sur la PMA ; du moins cela s'avérerait-il extrêmement difficile car des problèmes de cohérence se poseront, qui émergeront immédiatement.
Si l'on veut véritablement fonder la filiation sur le consentement, il faut le dire et en tirer toutes les conséquences, accepter une révolution. Je ne défends pas cette position, mais au moins a-t-elle une cohérence. J'insiste sur le travail considérable que représenterait une refonte complète du droit de la filiation fondée sur cette inversion totale de perspective.
Quand je suis devenu professeur de droit, j'ai enseigné le droit de la filiation, peu de temps après la grande loi du 3 janvier 1972, une loi importante qui a établi l'égalité entre la filiation naturelle et la filiation légitime. Nombre de ses grands principes figurent encore dans notre droit, mais elle ne réalisait pas une révolution à la mesure de celle qui est envisagée. Or, cette loi de 1972 avait été précédée de travaux extrêmement abondants, bien plus abondants sur le plan sociologique et sur d'autres plans que ceux qui sont versés aujourd'hui au débat et qui sont destinés à vous éclairer. D'éminents juristes s'étaient attelés à la tâche. Je ne peux pas ne pas citer le doyen Jean Carbonnier, probablement l'un des plus grands juristes français du XXe siècle. Je dis donc : pourquoi pas ? Cette refonte répondra à une logique. Ce ne sera pas une mince affaire, mais je vous souhaite beaucoup de courage !
Monsieur le rapporteur, la question n'est pas tant de savoir si l'enfant doit ou non être stigmatisé. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il ne doit pas l'être : il doit être protégé, quelles que soient les situations rencontrées en France.
Le sujet de l'extension ou de la déréglementation de la PMA n'est pas un sujet juridique. C'est d'abord un sujet anthropologique, sociologique et politique. Le droit ne vient qu'après. Avant donc d'imaginer des solutions juridiques, dont les faiblesses pour certaines ont été évoquées, il conviendrait de tirer le fil rouge de la PMA et de ses conséquences.
En vous entendant, une question m'est venue à l'esprit. Vous parliez d'utérus artificiel, vous parliez de GPA, vous auriez pu parler de mariage à plusieurs. Des demandes sont formulées à cet égard. Dès lors que l'on peut se marier entre personnes de même sexe, pourquoi, là aussi, se limiter à deux ?
La question fondamentale est de savoir s'il faut tout accepter au prétexte que cela existe ou existera. Oui, l'utérus artificiel existera, mais faut-il pour autant l'accepter ? Oui, la GPA existe, mais faut-il pour autant l'accepter ? L'esclavage existe aussi. L'accepte-t-on ? Non. Des conventions internationales sont intervenues – trop tard sans doute – et nous ne l'acceptons plus. Les crimes existent. Les accepte-t-on ? Non. Ce n'est pas parce qu'une chose existe qu'il faut l'accepter : sinon, monsieur le rapporteur, on accepte tout, et dans ce cas-là, si, comme vous le souhaitez, il faut être ambitieux, ne prévoyons plus de règles ! La meilleure façon d'être ambitieux, c'est de ne rien prévoir ! On fait tout ce que l'on veut, c'est le progressisme, le libéralisme abouti à l'extrême, les individus fixant en conscience leurs propres limites. Telle n'est pas ma position.

Le sujet est éminemment politique et il est aujourd'hui de la responsabilité du législateur de trancher et de procéder à un choix politique. Pour ce faire, nous avons besoin d'être éclairés. Il me semble que ce choix a déjà été opéré puisque le Président de la République actuel a été élu au suffrage universel démocratiquement et qu'au cours de sa campagne l'un de ses engagements était d'ouvrir l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Il me semble que, démocratiquement, le choix politique a déjà été en partie opéré. Désormais, il appartient, en effet, au législateur de traduire ces engagements dans tous les domaines, celui-là comme les autres, et de le faire de manière éclairée, notamment d'un point de vue juridique, en garantissant que la loi soit appliquée dans la société sans créer de souffrances, de déchirures et de clivage, puisque tous les points de vue peuvent être entendus et sont légitimes.
À cet égard, messieurs, il me semble extrêmement important de vous entendre, de dialoguer avec vous, même si je distingue votre expression à chacun. Je voudrais réagir en tant que femme politique. Vous prenez l'enfant en compte, vous souhaitez le protéger, je l'entends. Toutefois, vous pouvez avoir tenu des propos susceptibles de causer une douleur à ces familles construites en dehors du modèle traditionnel que vous souhaitez maintenir coûte que coûte.
Messieurs, j'ai entendu dans vos propos un refus de reconnaître que le législateur puisse s'adapter aux évolutions de la société, notamment vous, monsieur de Vries. Dès lors, j'interroge : devons-nous revenir sur le droit au divorce ? Sur le droit pour les femmes à disposer de leur corps via la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse ? Sur le droit au mariage pour les couples de même sexe ? Ce sont des lois qui ont été votées, parfois à la suite de débats houleux, certes, mais démocratiquement.
Aujourd'hui, notre société ne me paraît pas en danger de décadence ou de perdition : nous continuons à y vivre et à élever des enfants. Faudrait-il revenir sur ces avancées qui ont consacré des avancées sociétales dans la loi ?
Je vous poserai quelques questions en réaction à vos propos. L'un et l'autre dites que l'AMP serait réservée aux couples hétérosexuels en situation d'infertilité. On sait que ce n'est pas toujours le cas. Vingt pour cent des couples hétérosexuels ne sont pas infertiles, mais sont fatigués, surmenés, stressés. Voilà ce que disent les gynécologues qui prescrivent l'AMP. Qu'en pensez-vous ? Faudrait-il sanctionner les praticiens qui prescrivent l'AMP à des couples hétérosexuels ne souffrant pas d'infertilité médicalement constatée, ou bien rester dans l'hypocrisie en disant que cela n'existe pas alors que nous savons pertinemment que c'est faux ?
Monsieur Lucas, vous avez indiqué qu'il fallait peut-être réserver l'AMP aux couples en âge de procréer. Je voudrais savoir ce qu'est un couple en âge de procréer. Faudrait-il inscrire dans la loi un âge au-delà duquel les femmes ne peuvent plus procréer ? Pour le moment, aucune limite n'est fixée. Je ne sais pas comment faire pour réserver l'AMP aux couples en âge de procréer.
Vous dites qu'il ne faut pas toucher au droit de la filiation, ce qui aurait pour conséquence de ne pas permettre l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Si nous permettons l'ouverture mais que nous ne touchons pas au droit de la filiation – ce qui entraînerait, selon vous, une révolution trop importante – que faisons-nous des enfants qui naîtront ? Pour le coup, cela signifie que les enfants sont traités différemment, mais si jamais on n'ouvre pas l'AMP, que faisons-nous des femmes qui continueront à y avoir recours à l'étranger ? Faut-il prévoir de les sanctionner pénalement, puisque la pratique continuera d'exister ? Ce n'est pas parce que cela existe qu'il faut le faire, mais si cela existe, faut-il l'empêcher et comment l'empêcher ?
Vous venez de nous dire que l'enfant ne doit pas être stigmatisé et qu'il doit être protégé, mais que faisons-nous pour les enfants déjà nés par PMA à l'étranger ? Que faisons-nous pour les protéger et garantir leur droit supérieur à être protégés ? Lorsqu'on dit que l'amour ne fait pas tout – et c'est en cela que votre propos peut être ressenti comme douloureux par les parents –, que fait-on de ces projets parentaux qui ont déjà donné lieu et qui continueront de donner lieu à la naissance d'enfants ? Sur quoi se basent ces projets parentaux, plus forts que tout, si ce n'est sur l'amour et la volonté de créer une famille ? Ne pourrait-on consacrer, non pas un droit à l'enfant, mais un droit fondamental à avoir une vie familiale normale ?

Merci, mesdames, messieurs, de vos interventions, toutes très intéressantes.
Je rejoins ma collègue sur un certain nombre de ses propos. Nous sommes confrontés à de nombreuses questions : une volonté politique clairement affichée quant à l'extension de la PMA et un constat sur l'évolution de notre société. Ce qui fait famille aujourd'hui n'est pas ce qui faisait famille il y a quelques années. Cette évolution est un signe de modernité de la société, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Toutefois, il me semble important de préserver un équilibre entre cette modernité et la tradition auxquelles certaines et certains d'entre nous sont très attachés.
Cela ouvre un certain nombre de questions juridiques, mais aussi philosophiques et sociétales sur lesquelles nous avons besoin d'un éclairage. Vos contributions viennent nourrir cette réflexion.
La question juridique a animé les débats d'aujourd'hui. Le constat est très nettement établi sur la nécessité de faire évoluer le droit en matière de filiation : c'est une nécessité absolue. Je ne suis pas juriste, mais je mesure très bien, au fil des nombreuses auditions auxquelles nous avons assisté, la complexité à laquelle se heurte la nécessité de le faire évoluer. Vous avez exposé plusieurs hypothèses, dont celle de la présomption de parenté qui viendrait en remplacement de la présomption de paternité. Cette formule semble en effet assez bien répondre à la situation de la PMA pour les couples de femmes.
Ma question porte sur l'équilibre entre les couples de femmes et les couples constitués d'un homme et d'une femme. En droit, doit-on imaginer qu'il faille être deux pour qu'il y ait présomption de parenté et présomption de paternité, afin que celles et ceux qui sont très attachés à la notion d'altérité puissent s'y retrouver et retrouver dans le droit une expression qui leur convienne, sans que ce soit discriminant pour l'enfant ? Dans l'évolution des textes, cet équilibre doit toujours être présent. Si l'évolution de la société est à intégrer, il ne faut pas pour autant que ceux qui sont attachés à une forme de tradition se sentent niés dans l'expression du droit.
Les questions de Mme Fajgelès ne nous étant pas adressées, je répondrai à celle de Mme Vidal.
J'entends bien, madame, votre propos : symboliquement, le droit doit maintenir l'expression de l'altérité, qui est uniquement maintenue dans le titre VII puisque l'article 6 – l'article « balai » – de la loi 2013 l'a effacée partout ailleurs.
Si nous appliquions l'idée de détacher les articles 311-19 et 311-20 du titre VII pour les insérer dans un titre VII bis qui serait applicable à tous les couples ayant besoin d'un don de gamètes pour avoir un enfant, et si nous étions très attachés à la présomption de la paternité, nous pourrions maintenir le premier alinéa de l'article 320, relatif aux règles de présomption de la paternité, et ajouter un alinéa précisant que la conjointe de la mère sera désignée comme la seconde mère. Au lieu de ne faire qu'une formule en « dégenrant » les termes « mari », « femme », « père », « mère », nous pourrions laisser le texte actuel tel quel et ajouter pour les couples de femmes : « la conjointe de la mère sera désignée comme la seconde mère ». C'est ce qu'ont fait le droit québécois et le droit belge, qui par ailleurs n'ont pas « dégenré » ni privé de toute référence au père ou à la mère le reste des articles. Un article équivalant au nôtre demeure, qui précise que le père est celui que désigne le mariage, du fait de la présomption de paternité. C'est une option possible, l'autre étant d'introduire un libellé où l'altérité des sexes disparaît, en indiquant « parent », « conjointe de la mère », car le terme de mère restera toujours. Le droit belge et le droit québécois ont procédé ainsi : ils n'ont rien effacé, ils ont ajouté.
Dans mon exposé, j'ai indiqué que l'on pourrait supprimer la présomption de paternité au bénéfice d'une présomption de parenté, « neutralisant » ainsi la notion de paternité. L'idée était d'englober tous les couples de façon à supprimer toute différence dans les vocables, sachant que les droits et les devoirs seraient les mêmes vis-à-vis de l'enfant et que les enfants auraient les mêmes droits vis-à-vis des parents.
La dernière possibilité que j'ai envisagée était de ne pas modifier la terminologie, de conserver la présomption de paternité et d'ajouter pour les couples de femmes une présomption de co-maternité ayant exactement la même fonction que la présomption de paternité, si ce n'est que le terme de paternité renvoie à un couple hétérosexuel et que le terme de co-maternité évoque un couple de femmes.
Je peux entendre le fait que les couples existants n'aient pas envie que l'on dénomme autrement la réalité qui les concerne. On peut tout faire juridiquement mais qu'importe la dénomination puisque dans les deux cas, les droits et les devoirs sont identiques. Dans la mesure où la situation de fait peut être différente, on la dénommera différemment. Pour les couples hétérosexuels, s'appliquera la présomption de paternité ; pour les couples de femmes, la présomption de co-maternité ou de co-parenté. J'ai lu l'article 312, calqué sur celui relatif à la paternité, pour les conjoints de même sexe. Oui, on peut le faire ; en tout cas, il n'y a pas d'obstacle technique. Ce qui compte, ce sont les conséquences juridiques qu'on y attache : les conséquences juridiques doivent être les mêmes pour tous les couples et, surtout, pour les enfants que la loi protège.
Il est possible d'écrire que, dans l'un et l'autre cas, la filiation ne sera pas contestable. Il est inutile d'alourdir l'article ; il suffit de distinguer les deux hypothèses pour maintenir la filiation. Bien sûr, il faudra réécrire les conséquences de la filiation, l'impossibilité de contester et l'obligation pour la seconde mère comme pour le compagnon de faire une reconnaissance sous peine d'une déclaration forcée de paternité.
Madame la députée, je ne reconnais pas du tout la teneur de mes propos dans les questions qu'ils vous ont suggérées. À aucun moment, je n'ai évoqué l'idée de revenir sur une disposition du droit positif.
C'est vrai, j'ai plaidé pour le statu quo et je vous ai dit pourquoi. Je vous ai dit que vous ne pouviez entreprendre cette réforme que moyennant une refonte radicale, dont il faut bien mesurer les conséquences car le droit n'est pas une variable d'ajustement. Il faut mettre en musique juridique une décision politique en voie d'être prise, je le comprends bien, mais il s'agit une phase importante et j'ai voulu attirer l'attention sur la difficulté de rédiger un dispositif cohérent. Par conséquent, je ne propose rien qui viserait à revenir en arrière, selon les termes que vous avez utilisés.
Je n'ai pas évoqué la critique du droit existant. Vous me demandez ce que je pense de la condition actuellement posée par le législateur concernant l'âge de procréer. C'est une difficulté, j'en suis bien d'accord. J'ai envie de répondre que je ne sais pas très bien que répondre, mais tel n'est pas le sujet que je voulais aborder. Peut-être est-il possible d'améliorer la loi existante, car je crois qu'il y a des difficultés à cerner le périmètre exact de l'AMP, telle qu'elle existe aujourd'hui dans le code civil et dans le code de la santé publique.
S'agissant des enfants nés d'une PMA pratiquée à l'étranger, vous me demandez si je serais favorable à une sanction pénale. Évidemment, non. D'ailleurs, le droit pénal ne permet pas de sanctionner tous les délits commis à l'étranger : des conditions particulières sont nécessaires qui, en l'occurrence, ne sont pas remplies. À votre question, j'apporte donc une réponse négative, tout simplement.
Le statu quo ne consiste pas à revenir sur la législation en vigueur. La réforme envisagée conduirait trop loin si on voulait lui garder une certaine cohérence. Voilà comment je peux résumer le propos que j'ai tenu.
Je trouve intéressante l'idée de conserver deux niveaux. Il y aurait deux droits de la filiation. Si je trahis votre pensée, dites-le moi.
Je suis désolé, dans ce cas, de déformer votre propos. J'ai compris votre suggestion comme visant à créer deux niveaux : le droit commun de la filiation qui aurait vocation à s'appliquer aux couples hétérosexuels et des règles particulières qui seraient indépendantes de l'altérité sexuelle. S'il en allait ainsi, je pense qu'une telle configuration serait très difficile à mettre en oeuvre et que s'y attacherait un risque d'incohérence que j'ai déjà dénoncé. Si je me suis trompé sur la teneur de votre propos, je vous prie de m'en excuser.
Madame, avant que vous n'interveniez, j'avais posé la question : faut-il accepter tout ce qui existe au motif que cela existe ? Je n'ai pas parlé de revenir sur ce qui existe déjà. Faudra-t-il autoriser demain l'utérus artificiel ou la GPA ? Je pose la question. Pour ma part, je n'en suis pas certain mais je n'ai pas évoqué la question de l'avortement ou du divorce. Revenons au sujet qui nous intéresse, qui est la PMA.
Vous avez indiqué que mes propos pourraient être douloureux pour les familles. J'en serais désolé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Nous sommes à l'Assemblée nationale pour débattre d'un sujet politique et juridique. Vous êtes des parlementaires. Nous ne sommes pas là pour faire du sentimentalisme. J'ai simplement rappelé le droit existant, la jurisprudence du Conseil d'État concernant l'égalité, qui ne peut justifier l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, ou encore la jurisprudence de la CEDH.
Je rappelle qu'en droit français, la PMA n'est pas ouverte aux couples de femmes et que celles qui se rendent à l'étranger pour ce faire le font en violation du droit français. Il en est de même pour la GPA. Il faut être responsable et aller au bout de sa logique. Certes, le texte peut être modifié, mais les personnes qui pratiquent une GPA le font aujourd'hui en violation du droit français.
Vous me reprochez d'avoir dit que l'amour ne pouvait pas tout justifier. En effet, l'amour ne peut tout justifier. Par exemple, l'amour ne peut pas justifier de commettre un délit ou un crime. Il existe des limites. Plus que de droit, il s'agit de philosophie. On ne peut tout faire au nom de l'amour. En l'occurrence, l'amour ne pourra pas combler l'absence d'un père. Revenons à l'essentiel : même si elle répond à des demandes sociétales, à un désir d'enfant que l'on peut comprendre, la généralisation de la PMA aura pour effet, si elle devait être ouverte aux couples de femmes ou aux femmes seules, la suppression du père et de toute lignée paternelle. C'est là une question à laquelle il convient de profondément réfléchir !

Merci de vos contributions respectives. Nos débats se poursuivront ici et dans la société.
L'audition s'achève à dix heures quarante-cinq.
Membres présents ou excusés
Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique
Réunion du jeudi 18 octobre 2018 à 8h30
Présents. – M. Xavier Breton, Mme Élise Fajgeles, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal
Excusée. – Mme Bérengère Poletti